LOUIS XVI - ROI DES FRANÇAIS (1791 - 1792)

L'ordonnance de 1778 partageait le corps de la maréchaussée en 6 divisions, chacune composée de 5 à 7 généralité (1). Le complet de la Maréchaussée de France était en 1780 de 4.609 hommes, dont 368 officiers. Le ressort territorial d'une compagnie de maréchaussée était la généralité. La résidence du prévôt était fixée au chef-lieu de la province.
Suivant l'étendue de la généralité, la compagnie était subdivisée en un certain nombre de lieutenances dont le ressort territorial correspondait à celui des cours prévôtales. Chaque lieutenance était constituée de petites unités appelées brigades qui furent installées au niveau des paroisses dès 1720.
En 1791, l'Assemblée nationale examina l'intérêt de maintenir le corps de la maréchaussée et conclu de son utilité. Le résultat de ces discutions fut sanctionné par la loi du 16 février 1791 qui réorganisa le corps nouvellement dénommé Gendarmerie Nationale, suivant le nouveau découpage territorial : les départements. L'Arme fut restructurée en vingt-huit divisions, comprenant chacune trois départements à l'exception de la cinquième qui en compta quatre et de la Corse formant seule une division. Chaque division était commandée par un colonel.
Cette même loi supprima les compagnies à la suite des Maréchaux de France, celle de la Connétablie, des monnaies, celle des voyages et chasses du roi, celles du Clermontois et de l'Artois et celle de la Robe-Courte. L'ensemble des cavaliers de ces formations furent versés dans la toute nouvelle gendarmerie.
La compagnie de Robe-Courte fut réorganisée au sein de la gendarmerie en deux unités dites compagnies des Tribunaux pour continuer son service à pied près des tribunaux de Paris et pour la garde des prisons. Le corps entier fut porté à l'effectif de 7.455 hommes.
(1) Généralité : c'était le territoire qui formait le ressort de la juridiction d'un bureau des finances établi pour la perception des tailles et autres droits du roi. Ces bureaux ou chambres étaient dirigés par les trésoriers de France qui avaient ajouté à leur titre celui de généraux des finances. Ainsi ces territoires prirent le nom de généralité.

Décret du 23 octobre 1790
Dans un décret du 23 octobre 1790, concernant l'avancement aux grades militaires, l'Assemblée nationale fixa pour chaque arme les différents grades militaires. Pour les troupes à cheval, le corps des sous-officiers comprenait : les maréchaux des logis en chef, les maréchaux des logis, les brigadiers-fourriers, les brigadiers ; pour l'infanterie les sergents-majors, les sergents, les caporaux-fourriers, les caporaux.
Pour toutes les armes, les grades du corps des officiers comprenait : les sous-lieutenants, lieutenants, capitaines, lieutenants-colonels, colonels, maréchaux de camp, lieutenants généraux et maréchal de France.
Le grade de major fut supprimé.
LOI DU 16 FÉVRIER 1791
Création des grades de chef de division, lieutenant-colonel, capitaine

Loi du 16 février 1791
Titre premier : la maréchaussée est supprimée et reconstituée sous le nom de Gendarmerie nationale. Le complet de l'arme est porté à 7455 hommes. Elle est organisée en 28 divisions ; chaque division comprenant trois départements formés chacun de deux compagnies (sauf la Corse).
- Le titre de prévôt disparaît. Il est remplacé par celui de chef de division (ils ont rang de colonel)
- le titre de gendarme se substitue à celui de cavalier.
- Chaque département est commandé par un lieutenant-colonel
- Chaque compagnie par un capitaine et trois lieutenants.L'organisation de la gendarmerie nationale étant différente des autres armes montées, les emplois d'officiers et de sous-officiers diffèrent également. Ainsi la division est commandée par un colonel ; chaque département par un lieutenant-colonel qui a sous ses ordres deux compagnies commandées chacune par un capitaine et trois lieutenants.
La hiérarchie dans l'arme est ainsi établie : officiers : colonel, lieutenant-colonel, capitaine, lieutenant ; Sous-officiers : maréchal des logis, brigadier ; hommes du rang : gendarme.
Création d'un officier général

Loi du 16 février 1791
Une place d'officier général (art. 14) est attachée pour la première fois au corps de la gendarmerie. Elle est attribuée au plus ancien des prévôts généraux qui reçoit du roi une commission de maréchal de camp. Il concerve néanmoins son service à la tête de sa division.
Suppression des compagnies particulières de maréchaussée
Dans un rapport général sur l'organisation de la force publique, M. de Noailles, au nom des comités de Constitution et militaire exposait, le 22 décembre 1790, à l'assemblée nationale les motifs qui les ont engagés à proposer la conservation et l'augmentation du corps de la maréchaussée et a supprimer certaines compagnies portant le nom de maréchaussées mais dont le service n'était point analogue au service général de ce corps.

Loi du 16 février 1791 (titre VI) :
- La compagnie des chasses et voyages(1) du roi
- créée par ordonnance royale du 24 mars 1772 sous le nom de maréchaussée à la suite de la cour, cette compagnie ne faisait que secondairement des fonctions civiles. Durant les voyages, elle accompagnait le roi ; dans l'intervalle des voyages ses brigades étaient incorporées dans celles de la maréchaussée à qui elles remettaient leurs captures. Les comités de constitution et militaire ont pensé que cette compagnie ainsi distinguée par des fonctions particulières, ne pouvait pas faire partie du corps de la maréchaussée.
- La compagnie à la suite des maréchaux de France
- cette compagnie à la suite des maréchaux de France n'avait de la maréchaussée que le nom et ne faisait aucun service ; ses membres n'étaient pas réunis et leurs places, données par les maréchaux de France ou par ceux qu'ils autorisaient à les donner, et qui étaient dans le commerce durant la vie de celui qui les avait accordées, n'étaient que des titres de faveur ou de privilège.
- La compagnie de la connétablie
- La compagnie de la Connétablie était instituée pour instruire auprès des tribunaux des maréchaux de France sur les affaires du point d honneur. Les tribunaux d'exception étant tous supprimés, cette compagnie devient inutile. Elle faisait aussi le service à l'armée ; ce service sera rempli selon l'ancien usage par la maréchaussée. Il est juste que les officiers, cavaliers et gardes qui ont acquis les charges de la connétablie soient remboursés.
- La compagnie des monnaies
- Le prévôt et les lieutenants de la compagnie des monnaies connaissaient les délits commis en matière de monnaie par les justiciables sur l'ensemble du royaume et relevaient de la cour des monnaies. Sa compétence sur toute l'étendue du royaume étant incompatible avec le système général des maréchaussées circonscrites à un territoire et la juridiction d'exception de la cour des monnaies ayant été supprimée, cette compagnie sera à son tour supprimée.
- La compagnie du Clermontois et de l'Artois
- Cette compagnie, appelée du « prince de Condé » du nom de son fondateur qui l'avait créée pour son service et qui portait un uniforme particulier, fut maintenue après sa disparition. À la demande des habitants du pays elle revêtit l'habit de la maréchaussée et en assura les fonctions. La valeur des services de cette troupe d'une vingtaine d'hommes ayant été reconnue, elle sera incorporée dans la nouvelle gendarmerie. Un décret du 14 mai 1791 porte qu'elle sera payée à partir du 1er novembre 1791, par le trésor public sur le même pied que les brigades de gendarmerie nationale du département de la Meuse.
- Enfin, la compagnie de maréchaussée dite de robe-courte
- créée de longue date et mise au service du parlement et autres tribunaux et dont les fonctions consistaient à garder les prisons, transférer les prisonniers, veiller à la sûreté de la capitale et arrêter les délinquants en flagrant délit, cette compagnie sera conservée sous le nom de garde-judicielle.
Les personnels des compagnies supprimés versés dans le corps de la gendarmerie nationale conservèrent leur grade et leur rang, les autres étaient remboursés des charges qu'ils avaient acquises. Le complet de la toute nouvelle gendarmerie fut porté à 7455 hommes, formant 1560 brigades et 20 divisions.

(1) Au début de 1790, cette compagnie comptait 4 officiers, 5 maréchaux des logis, 16 brigadiers et 137 cavaliers répartis en 27 brigades, dont 20 en Seine-et-Oise, 4 dans l'Oise et 3 en Seine-et-Marne.
Création des nouvelles unités de gendarmerie
La gendarmerie spécialement attachée
au service de la nation

Loi du 15 mai 1791
La compagnie de la prévôté de l'hôtel, qui faisait partie de la Maison du Roi fut supprimée est recréée sous le titre de gendarmerie spécialement attachée au service de la nation. Dans la réalité, avec cette troupe monarchique, l'Assemblée nationale s'était constituée la première une force militaire à ses ordres. Sous l'autorité d'un lieutenant-colonel, ce nouveau corps était composé de deux compagnies. L'effectif de chaque compagnie commandée par un capitaine était de trois lieutenants, trois maréchaux des logis, six brigadiers et trente-six gendarmes. La force totale du corps étant de 100 hommes. Les gardes réformés par la nouvelle organisation étaient conservés en surnuméraires avec droit au replacement.
Ce corps fut chargé de remplir près de l'Assemblée nationale les mêmes fonctions qu'il exerçait dans l'hôtel du roi. Il devait « maintenir l'ordre et la police dans les issues et aux portes de la salle du corps législatif concurremment avec les gardes nationales » et était « autorisé à repousser par la force toute violence ou voie de fait qui serait employée contre eux dans les fonctions qu'ils exercent au nom de la loi ».
Il devait également fournir un officier et deux gendarmes auprès du ministre de la Justice pour l'honneur et la sûreté du sceau de l'État et remplir auprès des tribunaux de Paris et le tribunal de cassation les mêmes services que la compagnie de robe-courte effectuait avant son licenciement.
Grenadiers-gendarmes

L'article VII du titre IV du décret du 15 mai 1791 précise que : « L'uniforme des officiers, sous-officiers et gendarmes nationaux composant ce nouveau corps sera en tout semblable à celui de la gendarmerie nationale en y ajoutant la distinction que portent les grenadiers de cavalerie ».
Composition de l'habit
- L'habit en drap bleu de roi avec retroussis écarlates est conservé,
- le revers des manches s'orne d'une patte de parement écarlate comportant trois boutons,
- la veste est en drap couleur chamois boutonnée par douze petits boutons uniformes placés sur un seul rang,
- la culotte chamois est confectionnée dans le même drap que la veste,
- l'aiguillette est supprimée,
- la fleur de lys gravée sur les boutons en étain est remplacée par l'inscription : « Force à la loi »,
- la cocarde tricolore remplace la blanche sur le chapeau qui s'orne d'un plumet rouge.
- le baudrier et la banderole sont en cuir blanchi,
- les bottes à l'écuyère sont noires et les manchettes jaunes.
![]() Une loi du 11 septembre 1792 portait l'effectif de ce corps qui conservait la dénomination de Grenadiers(1) de la gendarmerie nationale à cent quatre-vingts hommes formant deux compagnies. Un décret du 30 septembre 1792 lui accorda un drapeau. Ce corps renommé « Grenadiers pour la Représentation Nationale » le 9 thermidor An III (27 juillet 1795) cessa alors de faire parti de la gendarmerie.
Une loi du 11 septembre 1792 portait l'effectif de ce corps qui conservait la dénomination de Grenadiers(1) de la gendarmerie nationale à cent quatre-vingts hommes formant deux compagnies. Un décret du 30 septembre 1792 lui accorda un drapeau. Ce corps renommé « Grenadiers pour la Représentation Nationale » le 9 thermidor An III (27 juillet 1795) cessa alors de faire parti de la gendarmerie.

(1) On fait remonter l'invention de la grenade au règne de François Ier, mais c'est sous celui de Louis XIV que l'usage de cette arme prit une place de plus en plus importante dans les batailles. La grenade se jetait à la main et les soldats chargés de cette opération prirent le nom de grenadiers qu'à partir de 1667. Les premiers furent choisis parmi les volontaires auxquels on donna le nom d'enfant perdu, mais bien vite on confia cette mission à des soldats d'élite auxquels on attribua une haute paye. Ils devaient avoir une certaine taille, de la force, une bonne conduite et beaucoup de courage.

L'introduction de ces combattants dans les armées se fit au nombre de quatre ou six par compagnie d'infanterie, mais bien vite leur nombre parut insuffisant notamment au moment de l'assaut. Ils furent alors réunis en compagnie d'une cinquantaine d'hommes et marchèrent à la tête des bataillons. À partir de 1670, les grenadiers commencent à exister dans l'armée française en compagnie d'élite à raison d'une par régiment d'infanterie, d'abord dans celui du roi puis dans les trente premiers régiments.
En 1691, chaque bataillon avait sa compagnie de grenadiers. En 1749, le ministre de la guerre d'Argenson institua un régiment complet de grenadiers soit environ 2400 hommes, mais les abus de ce régiment et son indiscipline obligèrent le roi à le licencier en 1771. On en revint aux compagnies par régiment que l'on réunissait en un seul corps pour les besoins de la guerre seulement sous le nom de grenadiers royaux de France. Ce corps qui acquit un grand renom de bravoure périclita dès lors qu'il fut réuni en un corps permanent. Le 4 août 1789, il fut dissous.
Le prestige de cette arme et celle de la gendarmerie étaient tels que la convention nationale décida de donner au corps de la maréchaussée le nom de gendarmerie nationale et afin d'asseoir leurs pouvoir et autorité, d'honorer du titre de grenadiers-gendarmes l'unité de gendarmerie d'élite chargée de la protection du corps législatif constitué par les anciens gardes de la prévôté de l'hôtel. C'est à cette occasion que le symbole de la grenade fut introduit dans l'arme. La loi de germinal An VI (1798) l'officialisera sur les plaques de ceinturon et sur le retroussis de l'habit.
La gendarmerie à la suite de l'armée

Décret du 18 mai 1792
Pour perpétuer sa mission d'accompagnement des armées, mission qu'elle exerçait avant la révolution lorsqu'elle était constituée en prévôté, l'assemblée nationale établit à la suite de chaque armée un détachement de gendarmerie pour prêter main forte à l'éxécution des jugements rendus par les cours martiales et par les tribunaux de police correctionnelle et pour veiller au maintien de l'ordre intérieur dans les camps. Forts de 33 hommes, officiers compris, ces détachements devaient également réprimer les désertions. L'effectif de ces compagnies fut porté à 150 hommes par décret du 30 avril 1793.
L'uniforme des gendarmes détachés aux armées était semblable à la gendarmerie des départements.
La gendarmerie de la Corse
Avec l'Ordonnance du 27 décembre 1769 Louis XV avait établi en Corse une compagnie de maréchaussée composée de soixante-cinq hommes répartis en quatorze brigades. Cette maréchaussée avait les mêmes fonctions que celles établies en France et jouissait des mêmes privilèges et avantages. 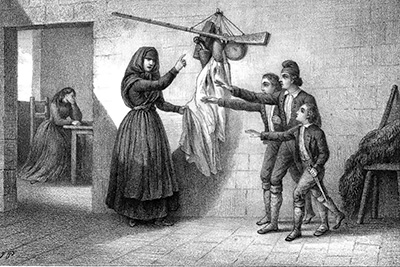
Son installation ne fit pas disparaître le grande criminalité de l'île. L'esprit de parti, les inimitiés de famille et les haines transmises en étaient les sources principales. L'impunité des auteurs par leur fuite aux maquis ne faisait qu'envenimer la situation. Pour la combattre, le roi par édit d'août 1772 créa en Corse quatre juntes nationales et une juridiction prévôtale. Afin que soit exécuté et respecté les décisions de ces tribunaux, Louis XV créa par ordonnance du 23 août 1772 un nouveau régiment provincial (le quarante-huitième) qui prit le nom de régiment provincial de l'île Corse. Il était composé de deux bataillons, chaque bataillon subdivisé en huit compagnies, dont une de Grenadiers royaux, une de Grenadiers provinciaux et six de Fusiliers.
Les cavaliers de la maréchaussée furent bientôt réduits à l'inaction. L'effectif de cette compagnie fut d'abord ramené à vingt hommes en 1778, puis la compagnie fut supprimée par un édit de mai 1789.

Décret du 3 - 8 juin 1791
L'Assemblée nationale crée sur l'île trente-six brigades de gendarmes à pied divisées en trois compagnies de gendarmerie. Les officiers, sous-officiers et soldats ayant servi dans le régiment provincial de l'île Corse furent prioritairement recrutés pour cette première formation.
Leurs uniforme et armement étaient identiques à ceux utilisés par la gendarmerie des départements.
La gendarmerie des départements
Augmentation du nombre de brigades

Décret du 14 - 29 avril 1792
Un décret du 5 janvier 1792 avait définitivement fixé et maintenu la gendarmerie nationale à 1 560 brigades de 5 hommes chacune. Elle fut augmentée de 40 brigades par décrets des 14 et 29 avril suivant portant organisation de ce corps. La gendarmerie demeura placée sous la surveillance et les ordres de huit inspecteurs généraux. Les inspections étaient formées de 83 départements et de 28 divisions. La force totale du corps s'élevait à 8784 hommes.
Ce décret précisait (article 2 du titre IV) que l'uniforme resterait tel qu'il a été fixé par le décret du 16 février, néanmoins les manches d'habit et parements seront coupés comme ceux de la cavalerie.
Création de la gendarmerie à pied

Décret du 16 juillet 1792
Afin de repositionner les troupes de ligne stationnées dans Paris sur les frontière de l'empire et ne pas laisser la capitale sans force armée pour assurer le maintien de l'ordre, l'Assemblée nationale crée des unités miliraires dont les effectfs sont tirés des gardes françaises ayant servi la révolution, pour être organisées en gendarmerie à pied. L'organisation de ces nouvelles compagnies fut fixée par décret du 17 août suivant.

Uniforme
- L'habit en drap bleu de roi retroussis écarlates est conservé,
- Un passe-poil blanc est rajouté au collet, au revers et au parement,
- les manches sont coupées comme celles de la cavalerie,
- le revers des manches s'orne d'une patte de parement écarlate comportant trois boutons,
- l'habit est garni de deux pattes d'épaule semblables au lieu d'une précédemment,
- la veste est en drap couleur chamois boutonnée par douze petits boutons uniformes placés sur un seul rang,
- la culotte chamois est confectionnée dans le même drap que la veste,
- l'aiguillette est supprimée (du moins en théorie),
- la fleur de lys gravée sur les boutons en étain est remplacée par l'inscription : « Force à la loi »,
- la cocarde tricolore remplace la blanche sur le chapeau(1) qui s'orne d'un pompon sphérique rouge.
- le baudrier et la banderole sont en cuir blanchi,
- les bottes sont identiques à celles des dragons.
(1)Sous la révolution, les dimensions du chapeau augmentent et les ailes s'allongent ; la coiffure qui est encore souple oscille entre une forme allongée sur les épaules et une forme plus étroite, mais plus haute. Il sera porté tantôt à plat (pointes parallèles aux épaules) tantôt en colonne (pointes perpendiculaires aux épaules).
 Calendrier : le 22 septembre 1792 est déclaré premier jour de la république. Il débute à minuit (décret du même jour).
Calendrier : le 22 septembre 1792 est déclaré premier jour de la république. Il débute à minuit (décret du même jour).
LA CONVENTION NATIONALE
(1792 - An IV ) (1792 - 1795)
Avec le décret du 21 février 1793 relatif à l'organisation de l'armée, aux pensions de retraite et traitements des militaires de tous grades, la convention nationale substitua au nom de régiment, celui de demi-brigade et modifia l'appellation des grades. Les dénominations de lieutenant-colonel, colonel, maréchal de camp, lieutenant général et maréchal de France furent supprimées.
| Ancienne appellation | Nouvelle appellation |
|---|---|
| Général d'armée | Général en chef |
| Lieutenant général (1) | Général de division |
| Maréchal de camp (2) | Général de brigade |
| Colonnel (3) (toutes armes ) | Chef de brigade (4) |
| Lieutenant-colonel d'infanterie | Chef de bataillon (5) |
| Lieutenant-colonel de cavalerie | Chef d'escadron (6) |
(1) Le titre de lieutenant général des armées du roi remonte au règne de Charles VII vers 1430. Ce n'était qu'une qualité temporaire. Le grade fut créé en 1638 sous Louis XIII. Il devint une charge permanente. Louis XIV augmenta leur nombre, car il s'agissait de créer un grade intermédiaire entre le maréchal de camp et le maréchal de France, mais également de multiplier les officiers généraux en proportion de la multiplication des troupes.

Lorsque plusieurs lieutenants généraux étaient réunis, le plus méritant était chargé du titre de « lieutenant général commandant en chef » et commandait tous les autres « lieutenants généraux des armées du roi ». Ces derniers avaient alors la direction d'une division de l'armée ou du corps d'armée que commandait le général en chef. La charge de lieutenant général était la plus élevée de l'armée après celle de maréchal de France.
(2) À l'origine cet officier était chargé du campement et du logement des armées afin que les troupes soient en sûreté. Sous le règne de François Ier, ce titre n'est qu'une commission passagère. Sous le règne d'Henri IV, il devient permanent, mais la charge est unique. Ce titre sera multiplié à la fin du règne de Louis XIII et au commencement de celui de Louis XIV.
(3) C'est sous le règne de Louis XII qu'on voit apparaître pour la première fois le titre de colonel associé à celui de capitaine pour désigner les chefs des bandes dont se composait l'infanterie française. En 1544 fut créée la charge de colonel général. Les chefs de corps furent alors appelés mestres de camp puis successivement colonels de 1661 à 1721, mestres de camp de 1721 à 1730, colonels de 1730 à 1780, mestres de camp de 1780 à 1788.
Cette variation dans les titres employés pour désigner les chefs de corps était occasionnée par la suppression ou le rétablissement de la charge de colonel général. Ainsi ces officiers étaient appelés mestres de camp lorsqu'il y avait un colonel général et reprenaient le nom de colonel toutes les fois que la charge de colonel général était supprimée.
Une ordonnance du 17 mars 1788 en supprimant les mestres de camp en second rendit aux mestres de camp commandant le titre de colonel que ces officiers supérieurs n'ont plus quitté jusqu'au décret du 21 février 1793.
(4) On s'adressait à cet officier en l'appelant « citoyen-chef » au lieu de se servir de la formule « mon colonel ». En gendarmerie, le titre de cet officier était chef de division.
(5) C'est en décembre 1734 que l'on songea à créer un emploi intermédiaire entre le lieutenant-colonel et le capitaine. On donna alors au titulaire de ce grade la dénomination de « commandant de bataillon », mais ce nouveau titre n'était qu'honorifique. Il appartenait de droit au plus ancien capitaine qui n'en restait pas moins le chef de sa compagnie. L'emploi de commandant de bataillon fut supprimé en 1762. Recréé en 1772 et de nouveau supprimé en 1776, ce grade fut définitivement rétabli sous le titre de chef de bataillon par décret du 21 février 1793.
(6) Comme les commandants de bataillon dans l'infanterie, « commandants d'escadron » n'était qu'un titre honorifique qui revenait, sous Louis XIV, au capitaine le plus ancien. Il faut attendre le décret du 21 février 1793 pour que ce titre devienne un grade à part entière sous la dénomination de chef d'escadron.
BATAILLE DE HONDSCHOOTE 21 FRUCTIDOR AN I (France - 8 septembre 1793)
Bataille inscrite au drapeau de la gendarmerie départementale.
Nouveaux départements
- 29 novembre 1792 : réunion de la Savoie à la France sous le nom de département du Mont-Blanc.
- 4 janvier 1793 : réunion du comté de Nice à la France sous le nom de département des Alpes Maritimes.
- 23 janvier 1793 : création du département du mont Terrible sur l'ancien duché de Dôle.
![]() Les subdivisions de la gendarmerie nationale :
Les subdivisions de la gendarmerie nationale :
La gendarmerie de cette époque était subdivisée en quatre grandes formations recevant chacune des soldes différentes. Il y avait :
- la gendarmerie à pied formée à Paris et employée aux armées,
- la gendarmerie à cheval employée aux armées et divisée en :
- gendarmerie à cheval formée à Paris,
- gendarmerie à cheval constituée de gendarmes prélevés dans les brigades,
- la gendarmerie pour la garde des prisons de Paris (un décret du 6 janvier 1795 porte son effectif à 736 hommes),
- la gendarmerie a cheval employée dans les départements.
LE DIRECTOIRE (An IV - An VIII ) (1795 - 1799)

Lorsque l'Assemblée constituante renversa les multiples institutions judiciaires qui couvraient le sol du royaume, elle en conserva la plus grande partie des principes qui dirigeaient ces institutions. En ce qui concerne la police judiciaire, elle ne fit à peu près que transférer aux juges de paix les attributions des juges royaux et seigneuriaux et restituer aux capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale les pouvoirs des prévôts et lieutenants de la maréchaussée.
Le poids de la police judiciaire pesait alors presque en totalité sur les juges de paix suivant le Code criminel de 1791. En concentrant entre les mains de ce magistrat l'ensemble des actes de procédure, on atteint bien vite les limites du possible. Cette considération conduisit l'Assemblée nationale à associer les officiers de la gendarmerie nationale à une grande partie des fonctions de police attribuées aux juges de paix. Ainsi, la loi du 29 septembre 1791 portait :
- article 1er : Le juge de paix de chaque canton sera chargé des fonctions de la police de sûreté ;
- article 2 : Il y aura de plus un ou plusieurs fonctionnaires publics chargés d'exercer concurremment avec les juges de paix des divers cantons les fonctions de la police de sûreté ;
- article 3 : Cette concurrence sera exercée par les capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale.
Cette aide ne faisait pas de ces officiers de gendarmerie des officiers de police judiciaire et le juge de paix conservait toutes ses prérogatives. Pour soulager leur action, le Code criminel du 3 brumaire an IV créa de nombreux officiers de police judiciaire au nombre desquels figuraient les lieutenants et capitaines de la gendarmerie nationale.

Code du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795)
Dans ce code des délits et des peines, les capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale reçoivent les attributions d'officier de police judiciaire. Ils sont placés sous la surveillance générale de l'accusateur public.
C'est la première fois que les fonctions d'officier de police judiciaire sont attribuées à la gendarmerie.
![]() Une loi du 25 pluviôse an V (13 février 1797) réorganise la gendarmerie en 25 divisions, subdivisées en 100 compagnies formant 1500 brigades. Chaque division est formée de deux escadrons et chaque escadron de deux compagnies à raison d'une compagnie par département. Chaque compagnie comprend de douze à dix-huit brigades de cinq gendarmes montés ou de sept dont deux à pied. L'effectif du corps en officiers, sous-officiers et soldats est fixé à 8475 hommes.
Une loi du 25 pluviôse an V (13 février 1797) réorganise la gendarmerie en 25 divisions, subdivisées en 100 compagnies formant 1500 brigades. Chaque division est formée de deux escadrons et chaque escadron de deux compagnies à raison d'une compagnie par département. Chaque compagnie comprend de douze à dix-huit brigades de cinq gendarmes montés ou de sept dont deux à pied. L'effectif du corps en officiers, sous-officiers et soldats est fixé à 8475 hommes.
Création des grades de chef d'escadron(1) et de maréchal des logis en chef(2)

loi du 25 pluviose an V
La réorganisation de l'arme par cette loi introduit dans l'arme deux nouveaux grades, celui de chef d'escadron et de maréchal des logis en chef à pied. Ainsi, chaque division est commandée par un chef de division inspecteur ayant rang de chef de brigade ; chaque escadron par un chef d'escadron; chaque compagnie par un capitaine et un, deux ou trois lieutenants; un maréchal des logis en chef à pied, réunissant les fonctions de quartier maître, de trésorier et celles de secrétaire-greffier, est attaché à chaque état-major de compagnie ; les brigades sont commandées un tiers par un maréchal des logis et les deux autres tiers par un brigadier.

(1) L'introduction des grades de chef d'escadron et de maréchal des logis-chef découle du décret du 21 nivôse an II concernant l'organisation de la cavalerie. Ce texte est appliqué à la gendarmerie qui est une arme principalement montée (8475 hommes, dont 8000 à cheval). Pour la cavalerie, la force d'une compagnie est fixée à 85 hommes, ce qui correspond approximativement aux nombres de gendarmes formant un département. La compagnie est commandée par un capitaine. Deux compagnies forment un escadron, pour la gendarmerie, deux départements forment un escadron, d'où la création du grade de chef d'escadron pour la gendarmerie.
(2) On ne trouve pas dans l'organisation de la cavalerie de maréchal des logis chef avant I776 et ce grade ne paraît pas remonter au delà de cette date. Avant cette époque le plus ancien maréchal des logis commandait aux autres sous-officiers de sa compagnie et n'était chargé que des détails de service, de police et de discipline ; le fourrier ayant ceux qui se rapportaient à la comptabilité et aux distributions de toute nature.
LOI DU 7 GERMINAL AN V
Sous le Directoire, la loi du 7 germinal an V (27 mars 1797) concernant le mode d'admission et d'avancement dans le nouveau corps de la gendarmerie rétablira l'aiguillette aux trois couleurs. Elle précise dans son titre que :
« le nouveau corps de la gendarmerie nationale portera le même uniforme que l'ancien : il y sera ajouté l'aiguillette aux trois couleurs, et sur le baudrier sera appliqué une plaque de cuivre argenté portant ces mots : Respect aux personnes et aux propriétés.
Le Directoire exécutif est chargé d'en déterminer les formes et les dimensions».
L'aiguillette tricolore comportait deux brins nattés en blanc, les deux cordons ronds étant l'un bleu et l'autre rouge.
![]() Une loi du 16 frimaire an VI ( 6 décembre 1797 ) crée une division de gendarmerie pour la Corse à 2 escadrons, ayant chacun trois compagnies de 18 brigades, dont 2 à cheval et 16 à pied. Effectif total 573 officiers et gendarmes.
Une loi du 16 frimaire an VI ( 6 décembre 1797 ) crée une division de gendarmerie pour la Corse à 2 escadrons, ayant chacun trois compagnies de 18 brigades, dont 2 à cheval et 16 à pied. Effectif total 573 officiers et gendarmes.
LOI DU 28 GERMINAL AN VI
La loi du 28 germinal an 6 est une loi fondamentale pour la gendarmerie nationale. Elle rappela le corps de la gendarmerie au véritable but de son institution dont plusieurs des lois précédentes l'avaient détourné et réunit en un seul code les dispositions législatives qui la concernaient. Cette loi conservait aux officiers de gendarmerie les fonctions d'officier de police judiciaire. Les lois et ordonnances qui lui succèderont maintiendront cette disposition. Voici quelques points particuliers :

Loi du 28 germinal an VI
- Art. 1 : « Le corps de la gendarmerie nationale à cheval, établi par les lois des 25 pluviôse an V et 22 brumaire an VI sera augmenté de cent lieutenants et de quatre cent cinquantre-trois brigades. » L'arme est composée de 25 chefs de division, 50 chefs d'escadron, 100 capitaines, 300 lieutenants, 100 maréchaux des logis-chefs, 500 maréchaux des logis, 1500 brigadiers, 7900 gendarmes et 100 trompettes représentant une force totale de 10 575 hommes.
- Art. 85 : dans les lieux des résidences des brigades où il ne se trouve ni maison de justice ou d'arrêt ni prison, il y aura, dans la caserne de la gendarmerie, une chambre de sûreté particulièrement destinée à recevoir les prisonniers qui doivent être conduits de brigade en brigade.
- Art. 131 : défend à la gendarmerie d'entrer de nuit dans les maisons des citoyens, sauf les exeptions établies par cette loi.
Cette loi fixe d'une façon complète et détaillée l'uniforme de la gendarmerie. C'est un texte important pour l'uniforme de l'arme qui servira de référence pendant 20 ans. Il est le premier à introduire pour la gendarmerie un grand et un petit uniforme.
Le grand uniforme pour les officiers, sous-officiers et gendarmes nationaux :
Composition de l'habit

- Habit de drap bleu national, parement, revers et collet de drap écarlate avec un passe poil blanc et une petite patte bleue sur le parement. Il est doublé en serge garance pour les sous-officiers et gendarmes et en drap casimir même couleur pour les officiers.
- Veste est de drap couleur chamois doublée de serge blanche pour les sous-officiers et gendarmes et en toile de coton blanche pour les officiers ;
- la veste est boutonnée par douze petits boutons uniformes placés sur un seul rang,
- la culotte est du même drap que la veste ;
- le surtout est en drap bleu,
- la grenade en argent pour les officiers et en drap bleu pour les sous-officiers et gendarmes remplace la fleur de lys sur les retroussis,
- les gants dits à la crispin sont en peau de daim naturelle et enveloppent le parement de l'habit,
- les boutons sont de métal blanc et portent pour empreinte deux branches de chêne dans le pourtour et au milieu sont gravés ces mots « force à la loi » avec au-dessus le n° de la division et au-dessous celui de l'escadron,
- les officiers, sous-officiers et gendarmes portent la culotte de peau de daim toutes les fois qu'ils sont à cheval en grande tenue,
- le manteau est de drap bleu national,
- la coiffure des sous-officiers et gendarmes est composée d'un chapeau tricorne bordé d'un galon d'argent et orné de la cocarde nationale.
Le chapeau de grand uniforme est surmonté d'un plumet rouge en plumes de coq, - les bottes sont équipées d'éperons en fer ou acier bronzé pour les cavaliers.
Grades et distinctions :
L'habit uniforme ne permettant pas de distinguer les grades, de nouveaux éléments vont être introduits dans la composition de la tenue. Désormais, c'est par le jeu des épaulettes et des aiguillettes que l'on va parvenir à cette reconnaissance.

- Le chef de division ne porte pas d'aiguillette, mais porte deux épaulettes tressées en argent, ornées de franges à graines d'épinard avec noeud de cordelier et cordes à puits.
- Les chefs d'escadron portent une seule épaulette à droite en argent garnie de franges à graines d'épinard, noeud de cordelier et cordes à puits. Ils portent sur l'épaule gauche une aiguillette dont les pendants nattés sont tout argent, l'un des deux pendants est de soie bleu clair et l'uatre est écarlate, les ferrets sont en argent,
- capitaines et lieutenants portent à droite l'épaulette d'argent ornée de franges comme celle des capitaines de cavalerie, l'aiguillette est de soie bleue, écarlate et argent.
- Les maréchaux des logis-chefs et maréchaux des logis portent l'aiguillette de soie blanche. Les pendants sont bleu pour l'un et écarlate pour l'autre. Les maréchaux des logis-chefs portent une contre-épaulette.
- Les brigadiers ont leurs manches galonnées d'un chevron d'argent, deux pour les maréchaux des logis et trois pour les maréchaux des logis-chefs.
Équipement
- Une giberne et une banderole de giberne en cuir blanc,
- un ceinturon de buffle blanc pour le sabre,
Armement
- un mousqueton avec grenadière en buffle,
- une baïonnette,
- une paire de pistolets,
- un sabre à lame droite et plate (non évidée), longueur de la lame 32 pouces 6 lignes (87,95 cm) avec les n° de division et d'escadron gravés sur la partie extérieure de la coquille, fourreau en cuir de vache noirci, poids total 2 livres 6 onces (1, 162 kg).
- la house et les chaperons sont en drap bleu garnis d'un galon de fil blanc.
Le petit uniforme
Le petit uniforme se compose dans ses grandes lignes d'un surtout en drap bleu ayant les mêmes retroussis que l'habit, du gilet à manche en drap bleu, du pantalon en drap bleu basané en cuir noir et du chapeau bordé d'un galon noir avec pompon et macaron en laine rouge.
À compter de ce texte, l'uniforme de la gendarmerie ne devait plus subir pendant près de quinze ans de notables modifications. C'est au général Wirion, chargé de l'organisation de la gendarmerie nationale dans la 25e division (départements nouvellement conquis de la Roër, de la Moselle, du Mont Tonnerre et de la Sarre) que nous devons, dans un règlement sur le service de la gendarmerie dans ces départements, la description de l'uniforme qu'il imposa aux gendarmes de cette division.
LE CONSULAT (An VIII - An XII) (1799 - 1804)
Avec l'arrêté du 12 thermidor an IX (31 juillet 1801) le Premier Consul donnait à la gendarmerie une nouvelle organisation. L'arme était divisée en 27 légions, dont une légion d'élite.

Les légions départementales faisaient le service sur quatre départements. Elles étaient formées chacune de deux escadrons et chaque escadron de deux compagnies, une compagnie par département(1). Le corps de la gendarmerie était alors composé de 1 750 brigades à cheval et 750 à pied ; chaque brigade était à l'effectif d'un sous-officier et de cinq gendarmes.
Six compagnies supplémentaires furent créées pour les légions qui renfermaient dans leur arrondissement de grands ports et des arsenaux maritimes (Le Havre, Brest, Lorient, Rochefort, Anvers, Toulon). Ces compagnies formaient 48 brigades, dont 6 à cheval et 42 à pied, pour un effectif total de 300 hommes, officiers compris. Elles étaient chargées de l'exécution des règlements relatifs à la surveillance, la garde et la police desdits ports et arsenaux. Elles étaient placées sous les ordres des préfets maritimes.
C'est à l'occasion de cette réorganisation que fut créée la légion d'élite. Placée sous les ordres d'un chef de légion elle était forte de 600 hommes, officiers compris. Les 66 brigadiers et 484 gendarmes, formant cette légion, étaient fournis par les légions départementales. Ils continuaient de faire partie des brigades dont ils étaient extraits et comptaient pour mémoire dans les revues et contrôles. Cette formation était spécialement chargée du maintien de la sûreté publique et de la police dans les lieux où résidait le gouvernement. Cette formation était désignée sous le nom de gendarmerie d'élite. Elle était commandée par un aide de camp du Premier Consul : le colonel Savary, qui ne recevait ses ordres que du Premier Consul.
Avec un état-major général composé d'un général de division, Ier inspecteur général et de deux généraux de brigade, inspecteurs généraux, la force totale de la gendarmerie s'élevait alors à 15 689 hommes.
(1) Excepté en Corse, où il y avait 2 compagnies par département, et dans la 19e légion où la gendarmerie du département du Mont-Terrible avait été fondue avec la compagnie du Haut-Rhin.
La Garde consulaire
L'arrêté du 7 frimaire an VIII (28 novembre 1799) organisa la Garde des Consuls avec l'ancienne Garde du Directoire. Elle était composée de deux escadrons de cavalerie tirés des ex-grenadiers à cheval du Directoire. Cette unité fut renforcée d'une compagnie de chasseur à cheval par arrêté du 13 nivôse an VIII (3 janvier 1800) qui fixait son effectif à 4 officiers et 113 hommes. Son chef fut le capitaine Eugène Beauharnais.
L'arrêté du 18 vendémiaire an X, sur l'organisation de l'armée (10 octobre 1801), précise que le corps de cavalerie destiné à la Garde des Consuls comprendra un état-major, trois escadrons de Grenadiers et deux escadrons de Chasseur. Avec l'arrêté du 1er octobre 1802, le régiment est porté à quatre escadrons. L'effectif total est de 56 officiers, et de 959 hommes. Le 13 octobre Eugène de Beauharnais est promu Chef de Brigade.

Arrêté du 29 pluviôse an VIII (18 février 1800)
Par arrêté du 29 pluviose an VIII, le premier consul établit, dans les départements de l'ouest, 200 brigades de gendarmerie à pied supplémentaires qu'il place sous les ordres des officiers de la gendarmerie. Chaque brigade est composée d'un maréchal des logis, d'un brigadier et de huit gendarmes. L'uniforme est identique à celui de la gendarmerie à cheval et l'armement est semblable à celui de l'infanterie légère.

Suivant l'arrêté du 8 germinal an VIII (29 mars 1800) portant création d'un inspecteur général de la gendarmerie nationale :
Le général Bon-Adrien JEANNOT de MONCEY est nommé, par le premier consul, inspecteur général de la gendarmerie nationale à compter du 1er décembre 1801.
![]() L'arrêté du 8 germinal an VIII, qui crée un inspecteur général de la gendarmerie nationale, précise qu'il portera l'uniforme de chef de division de gendarmerie avec des étoiles sur les épaulettes.
L'arrêté du 8 germinal an VIII, qui crée un inspecteur général de la gendarmerie nationale, précise qu'il portera l'uniforme de chef de division de gendarmerie avec des étoiles sur les épaulettes.

Loi du 7 pluviôse an IX (27 janvier 1801)
La loi relative à l'organisation de la gendarmerie du 28 germinal an 6 (article 194) n'avait admis aux fonctions de la police judiciaire que les capitaines et les lieutenants conformément à la loi du 3 brumaire an 4, mais la loi du 7 pluviôse an 9, conféra ces fonctions à tous les officiers de gendarmerie et par conséquent aux chefs d'escadron et de division. Le nouveau Code (articles 9 et 48) se sert des mêmes expressions officiers de gendarmerie, en sorte que les sous-lieutenants sont appelés à remplir les fonctions de police judiciaire tout comme les capitaines et les lieutenants de l'arme.
Création des légions de gendarmerie

Arrêté du 12 thermidor an IX (3l1 juilet 1801) :
Avec cet arrêté, la dénomination de « division » est remplacée par celle de « légion ». Les chefs de division prennent le titre de chefs de légion.
L'état-major général de la gendarmerie est composé d'un général de division, premier inspecteur général, et de deux généraux de brigade, inspecteurs généraux. Les fonctions du premier inspecteur géneral de la gendarmerie sont celles qui lui ont été attribuées par l'arrêté du 8 germinal an 8. Les deux généraux de brigade ont pour mission d'inspecter les légions et veiller à la cohésion du corps de la gendarmerie et à l'uniformité de son service.
Le corps des officiers est composé des grades suivants : chefs de légion (ayant rang de colonel), chef d'escadron, capitaine, lieutenant est sous-lieutenant.
Le corps des sous-officiers est composé des grades suivants : maréchal des logis et brigadiers.

Loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) : création de la Légion d'honneur pour récompenser les services militaires et civils.
Gendarmerie des départements
La réorganisation territoriale de la gendarmerie sous le consulat n'apporta aucune modification notable à l'uniforme des gendarmes à pied ou à cheval des départements.
| Gendarme à cheval - An IX Grande tenue |
Gendarme à pied - An IX Grande tenue |
|---|---|
 |
 |
| Armement : sabre de cavalerie de ligne - mousqueton |
Armement : fusil Mle An IX baïonnette de 15 pouces (406 mm) et sabre-briquet |
Gendarmerie d'élite
La gendarmerie d'élite était composée d'un chef de légion, trois chefs d'escadron, dont un chargé de la police, un lieutenant quartier-maître; un chirurgien-major, un artiste vétérinaire, deux sous-lieutenants adjudants, cinq capitaines en premier, dont un major, deux capitaines en second, huit lieutenants en premier, quatre lieutenants en second, douze maréchaux des logis à cheval, dix maréchaux des logis à pied, trente-six brigadiers à cheval, trente brigadiers à pied, deux cent soixante-quatre gendarmes à cheval, dont quatre trompettes, deux cent vingt gendarmes à pied, dont deux tambours.
Un arrêté du 28 ventôse an X (19 mars 1802) complétait l'organisation comprenant un état-major avec deux escadrons de deux compagnies à cheval chacun et un demi bataillon de deux compagnies. Son effectif fut fixé à 608 hommes officiers compris. Cette gendarmerie, casernée aux Célestins, avait pour mission de veiller continuellement sur le chef de l'État pendant ses voyages et aux armées. Elle participait à assurer le maintien de l'ordre dans Paris.
Pour servir dans la gendarmerie d'élite, les gendarmes devaient mesurer un mètre soixante-seize au moins et avoir servi en tant que sous-officier dans les corps de troupe avant leur admission dans l'arme.
Arrêté du 21 pluviôse an X
Sur le rapport du ministre de la Guerre, les consuls fixèrent par arrêté du 21 pluviôse an X (10 février 1802) l'uniforme de la gendarmerie d'élite. Pour intégrer cette unité, il fallait être âgé de 25 ans minimum et 40 maximum. Il fallait savoir lire et écrire, mesurer 1.75m , avoir servi cinq ans dans les troupes à cheval pour les gendarmes à cheval et quatre ans soit dans les troupes à cheval soit dans l'infanterie pour les gendarmes à pied et justifier de quatre campagnes au moins dans les armées actives depuis la révolution.
| Gendarme et sous-officier à pied | Officier de gendarmerie à pied | Gendarme à cheval |
|---|---|---|
 |
 |
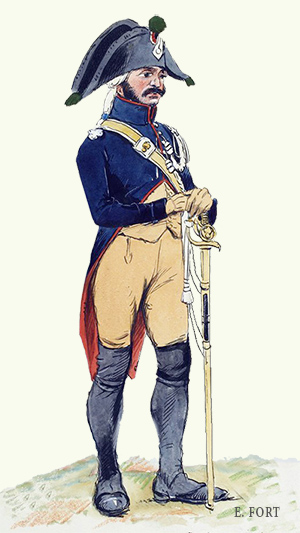 |
| - Grande tenue d'été - | - Grande tenue d'été - | - en petite tenue (1805) - |
Habillement

- Cavalerie
- Habit bleu national, revers, parements et retroussis écarlates, patte de parement et collet bleu ; poches figurées en travers avec un passepoil écarlate; grenades de drap bleu aux retroussis (argent pour les officiers).
- Veste en drap chamois et culotte de peau daim.
- Boutons blancs avec une grenade au milieu et pour légende : gendarmerie d'élite.
- Trèfles et aiguillette à gauche en fil blanc pour les gendarmes, en poils de chèvre bleu et argent pour les maréchaux des logis, et en argent pour les officiers avec épaulette de leurs grades respectifs.
- Manteau bleu national à manches avec des brandebourgs de fil blanc pour les gendarmes, en poils de chèvre bleu et argent pour les maréchaux des logis, et en argent avec un galon sur le collet pour les officiers.
- Chapeau orné de macarons à franges d'argent. La ganse est retenue par un gros bouton, il est bordé d'un galon dont la largeur varie avec le grade et garni d'un plumet en plumes de coq rouge.
- Chapeau de petite tenue, un bonnet de police.
- Bottes à l'écuyère, éperons noirs, manchettes de bottes, souliers à boucles avec guêtres noires.
- Paire de gants en daim.
- Infanterie
- L'infanterie sera habillée comme la cavalerie. Les brigadiers et gendarmes auront deux épaulettes en poils de chèvre rouge bordées d'un petit galon d'argent, bleu et argent pour les maréchaux des logis. Les officiers seuls portent l'aiguillette.
- Bottes à retroussis jaunes ; souliers à boucle avec guêtres noires et blanches pour les sous-officiers et gendarmes.
- Capote bleu national à manches avec des brandebourgs de fil blanc pour les gendarmes, en poils de chèvre bleus et argent pour les maréchaux des logis, et en argent pour les officiers.
- Le chapeau et les buffleteries sont semblables à ceux de la cavalerie.

Équipement
- Buffleterie jaune bordée d'un petit galon de fil blanc pour les gendarmes et en argent pour les officiers.
- La plaque de baudrier est blanche avec une grenade jaune sur la giberne et la plaque de ceinturon.
Armement
- Sabre droit de cavalerie, monture en cuivre jaune pour les sous-officiers et gendarmes en métal blanc pour les officiers.
- Dragonne en buffle pour les brigadiers et gendarmes, en poils de chèvre bleu et argent pour les maréchaux des logis et argent pour les officiers.
Les modèles d'arme à feu

À cette époque, il n'existait que cinq modèles d'armes à feu légères pour l'armée française qui étaient toutes produites dans les manufactures d'état.
- Le fusil modèle 1777 corrigé pour toute l'infanterie. Canon de 42 pouces (1,1366m) de longueur, calibre 7 lignes, 9 points (1,75 cm), baïonnette à fente à virole, lame de 15 pouces (40,59 cm),
- le fusil modèle an IX pour les dragons, l'artillerie de ligne et les compagnies de voltigeurs. Canon de 38 pouces (1,0283 m) de longueur,calibre 7 lignes, 9 points (1,75 cm), les accessoires (baïonnette, baguette, mécanisme) sont identiques au fusil précédent,
- Le mousqueton modèle an IX pour les chasseurs et les hussards. Canon de 28 pouces (75,77cm) de longueur, calibre 7 lignes, 4 points (1,71 cm), équipé d'une baïonnette de 18 pouces (48,73 cm) de lame,
- le pistolet de cavalerie modèle an IX pour les troupes à cheval. Canon de 5 pouces, 7 lignes (20,07 cm) de longueur, même calibre que le mousqueton,
- le pistolet gendarmerie modèle an IX. Canon de 4 pouces, 9 lignes (12,85 cm) de longueur à 5 pans, calibre 6 lignes, 9 points (1,52 cm), platine ronde, bassinet en cuivre, baguette d'acier à tête-de-clou, garnitures en fer, exclusivement fabriqué à la manufacture de Maubeuge.
![]() Avec l'arrêté du 14 prairial an XI (3 juin 1803) la gendarmerie d'élite appartient plus à la garde consulaire qu'à la gendarmerie. La solde de ses officiers, sous-officiers et gendarmes sont alignées sur celles des grenadiers à chaval de la garde des Consuls ; les chevaux, leur harnachement et équipement ainsi que l'habillement des hommes n'appartiennent plus aux gendarmes venus des départements, mais sont fournis par le gouvernement. En 1806, les deux compagnies à pied disparaîtront et le décret du 15 avril qui réorganisa la garde impériale prescrit que : « La quatre compagnies de gendarmerie d'élite auront la même organisation et seront de la même force que la compagnie d'un régiment de cavalerie de la Garde ». L'effectif fut dès lors fixé à 456 cavaliers et son organisation ne changea plus jusqu'en 1813.
Avec l'arrêté du 14 prairial an XI (3 juin 1803) la gendarmerie d'élite appartient plus à la garde consulaire qu'à la gendarmerie. La solde de ses officiers, sous-officiers et gendarmes sont alignées sur celles des grenadiers à chaval de la garde des Consuls ; les chevaux, leur harnachement et équipement ainsi que l'habillement des hommes n'appartiennent plus aux gendarmes venus des départements, mais sont fournis par le gouvernement. En 1806, les deux compagnies à pied disparaîtront et le décret du 15 avril qui réorganisa la garde impériale prescrit que : « La quatre compagnies de gendarmerie d'élite auront la même organisation et seront de la même force que la compagnie d'un régiment de cavalerie de la Garde ». L'effectif fut dès lors fixé à 456 cavaliers et son organisation ne changea plus jusqu'en 1813.
Règlement du 1er vendémiaire an XII
(22 sept. 1803)
L'uniforme des officiers réformés est composé de l'habit, la veste et la culotte en drap. L'habit est sans revers, botonne sur la poitrine et ont pour seule distinction les parements et le collet en velours cramoisi. Il conservent le bouton d'uniforme du corps. Le chapeau uni sans panache, plumes ni plumet est orné de la cocarde nationale, d'une gance en or arrêtée par un bouton. Ils conservent les épaulettes, la dragonne des grades respectifs et l'épée de l'arme.
Avec l'arrêté du 1er vendémiaire an XII ( 22 septembre 1803 ), les Consuls changent l'appellation des unités militaires. La hiérarchie militaire est modifiée de la manière suivante :
Infanterie : le nom de régiment est substitué à celui de demi brigade. Les chefs de brigade reprennent le titre de colonel. Le grade de chef de bataillon est maintenu. Création d'un major par régiment, grade intermédiaire entre celui de colonel et celui de chef de bataillon.
Troupes à cheval : les chefs de brigade prennent le titre de colonel comme dans l'infanterie. Le grade de chef d'escadron est maintenu. Création d'un major comme dans l'infanterie.
Les majors avaient à peu près les mêmes fonctions que les lieutenants-colonels institués avant leur suppression en 1793.
Création du titre de colonel de gendarmerie

arrêté du 1er vendémiaire an XII
La gendarmerie nationale étant une arme à cheval, les chefs de légion de gendarmerie prennent le titre de colonel.
Ier EMPIRE (An XII (18/05/1804) - 06/04/1814)
Avec la décision du 24 brumaire an XIII (15 novembre 1804) la gendarmerie prend le titre de « gendarmerie impériale ».
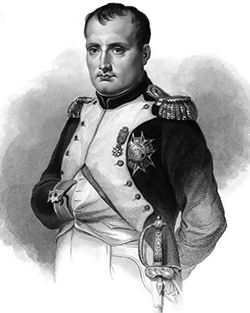
L'uniforme ne subit pas de transformation. Les modifications qui suivront seront légères et étalées dans le temps. Ainsi les galons des sous-officiers se portent en chevron, l'aiguillette redevient blanche, les boutons portent l'aigle, le numéro de la légion et l'inscription : gendarmerie impériale. L'aigle orne la plaque du ceinturon et du baudrier.
Avec l'extension de l'empire, le nombre de légions augmente et passe en 1808 à 29 légions. Le complet de la gendarmerie sera successivement augmenté pour atteindre en 1808 environ 18.000 hommes puis près de 30.600 réparti en 34 légions formées de 68 escadrons et 144 compagnies.
Placée sous l'autorité du Maréchal de l'Empire Moncey, Duc de Conégliano, premier inspecteur général, les trente-quatre légions sont réparties comme suit :
- 26 légions de France,
- les 27e, 28e, 29e et 30e légions en Italie ayant respectivement pour chef-lieu de légion : Turin, Gênes, Florence et Rome,
- la 31e légion à Laybach en Slovénie,
- les 32e et 33e légions au Pays-Bas à Amsterdam et Groningue.
Avec la campagne d'Espagne (1807 - 1814) on comptait au 1er juillet 1813 six légions supplémentaires employées à l'armée d'Espagne. Sous les ordres du général de brigade Buquet, les légions sont constituées progressivement suivant le décret du 12 décembre 1811, à partir des 20 escadrons formés pour cette campagne.
La garde impériale
Par un ordre du jour du 28 floréal an XII (18 mai 1804), la Garde des Consuls prend l'appellation de Garde Impériale. Un décret du 10 thermidor an XII (29 juillet 1804) confirma ce titre et fixa sa composition. Le régiment de chasseurs était toujours commandé par Eugène Beauharnais qui avait été promu colonel et qui sera nommé général de brigade de 6 mars 1805 ; général de division quelques jours après avant de devenir, le 13 mars 1805, vice-roi d'Italie .
Création de la dignité de maréchal d'Empire
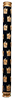
Décret organique du 28 floréal an XII (19 mai 1804)
Création de dix huit maréchaux d'Empire : Berthier, Murat, Moncey, Jourdan, Masséna, Augereau, Bernadotte, Soult, Brune, Lannes, Mortier, Ney, Davoust, Bessières, Kellermann, Lefèvre, Pérignon, et Serrurier.
Leur insigne distinstif est le bâton recouvert de velour bleu et semé d'abeilles d'or.
D.M. du 30 brumaire an 13
L'habit est garni de 13 gros boutons et de 16 petits. Les uns et les autres sont en métal blanc. Ils portent un écusson de la couronne impérial et autour le numéro de la division d'inspection, et au dessus le numéro de l'escadron auquel sont rattachés les officiers, sous-officiers et gendarmes.
BATAILLE D'AUSTERLITZ
2 décembre 1805.
Gendarmerie des départements

Habillement

Infanterie
- Grande tenue
- Habit de drap bleu, retroussis écarlate, collet et parements bleus,
- pantalon de tricot blanc,
- aiguillettes et trèfles en fil blanc, buffleterie jaune.
- Petite tenue
- la même que la grande sauf le pantalon qui est en cuir de laine bleu clair avec bande bleu foncé,
- pantalon d'été en coutil blanc,
- collet-manteau bleu foncé.
Cavalerie
- Grande tenue
- identique à celle de l'infanterie, mais chaussée de bottes dites demi-fortes.
- Petite tenue
- identique à celle de l'infanterie, mais avec un manteau-capote bleu foncé.
- Les coiffes
- gendarmerie des départements : chapeau à ganse bordé d'un galon d'argent.
- Gendarmerie de Corse : shako
La compagnie de la Seine
La compagnie de la Seine faisait partie de la première légion de gendarmerie départementale avec la compagnie de Seine-et-Oise et la compagnie de Seine-et-Marne. Attachée au service de la capitale, elle se distinguait des autres compagnies par quelques effets vestimentaires et sa coiffure.
La compagnie de gendarmerie de la Seine était équipée d'une grande et d'une petite tenue semblables à celles de la gendarmerie départementale, cependant l'habit de la grande tenue se portait avec un plastron écarlate. La cavalerie était coiffée d'un bonnet à poil et l'infanterie d'un shako.
La légion d'élite
Par arrêté du 10 thermidor an XII (29 juillet 1804), la compagnie de gendarmerie d'élite créée par l'arrêté du 12 thermidor an IX (31 juillet 1801) pour la garde des consuls sous le nom de « légion d'élite », prit rang dans la garde impériale sous le titre de « gendarmerie d'élite à pied et à cheval ». Elle était composée d'un état-major, de 2 escadrons formés chacun de 2 compagnies et d'un demi-bataillon ayant aussi 2 compagnies ; son effectif s'élevait à 632 hommes, officiers compris. Un décret du 15 avril 1806 portant sur la composition de la garde impériale fixait son effectif à 520 hommes officiers compris. Cette formation combattit jusqu'à la fin de l'empire sur les champs de bataille.
La gendarmerie d'élite porte dans ses grandes lignes l'uniforme de la gendarmerie des départements.

Habillement
- Même coupe d'habit que les grenadiers à cheval : revers, parements et retroussis rouges; poches figurées en travers; grenades blanches sur les retroussis, boutons blancs;
- veste et culotte en peau jaune; bottes à l'écuyère;
- trèfle et aiguillettes (placés à gauche) blancs (mélangés de soie bleue pour les gradés);
- entre 1804 et 1806 ils sont dotés d'un bonnet d'oursin(1) à visière en cuir verni, jugulaires blanches, cordon blanc, au sommet, une grenade blanche sur un fond rouge, plumet rouge et blanc les jours de parade;
- en 1807 ils prennent comme toute la cavalerie de la garde, l'habit bleu ciel à distinctive cramoisie.
Équipement
- giberne garnie d'une aigle de cuivre;
- porte-giberne et ceinturon jaunes, bordés d'un galon blanc;
- plaque de ceinturon blanche, ornée d'une aigle en cuivre;
- gants jaunes; les marques distinctives des grades en argent;
- les gendarmes à pied ont deux épaulettes rouges à franges sans aiguillette (les compagnies à pied seront dissoutes en 1806).
Armement
- Sabre droit, mousqueton et pistolets comme ceux des grenadiers à cheval ;
Harnachement
- Le harnachement du cheval était le même que pour les grenadiers à cheval à l'exception du galon qui était blanc;
- Les chaperons sont à trois étages.
(1) Le bonnet à poil fut introduit dans les armées françaises entre 1730 et 1740. C'est une invention de l'armée prussienne qui en avait équipé ses grenadiers pour leur permettre d'avoir plus d'aisance dans le jet de leurs grenades. En effet durant cette action le fusil qu'ils devaient porter en bandoulière ne cessait de s'accrocher à leur large chapeau. Frédéric-Guillaume, roi de Prusse les remplaça par des bonnets pointus garnis de plaques de cuivre et afin de donner à cette coiffure un air plus martial il y ajouta une garniture de peau d'ours. Cette coiffure fut introduite dans les armées françaises alors qu'elle avait perdu son utilité, car on ne lançait déjà plus les grenades. Les grenadiers à cheval adoptèrent les premiers les bonnets d'ourson et seront suivis par les grenadiers d'infanterie.

Décret du 22 fructidor an XIII
le calendrier grégorien est remis en usage dans tout l'Empire français à compter du 11 nivôse an XIII (1er janvier 1806).

Code d'instruction criminelle de novembre 1808
Les officiers de la gendarmerie nationale sont maintenus dans leur fonction d'officier de police judiciaire. Ils sont placés sous l'autorité des cours impériales. À ce titre, ils sont habilités à recevoir les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.
La gendarmerie d'Espagne

Décision impériale du 24 novembre 1809
L'Empereur décide de créer 20 escadrons de gendarmerie pour l'armée d'Espagne. Ils seront mis sur pied à compter de la décision ministérielle du 23 janvier 1810. L'effectif de chaque escadron est fixé à 7 officiers, 200 sous-officiers, brigadiers et gendarmes (80 à cheval et 120 à pied). La force totale des 20 escadrons était de 4.140 hommes et 1.740 chevaux. Les escadrons étaient formés d'un tiers de gendarmes et deux tiers de militaires venant des régiments.

Décret du 12 décembre 1811
La gendarmerie de l'armée d'Espagne est organisée en six légions commandées chacune par un colonel. Les états-majors de ces légions étaient implantés de la manière suivante : 1re légion à Burgos (Castille) ; 2e légion à Sarragosse (Aragon) ; 3e légion à Pampelune (Navarre) ; 4e légion à Vittoria (Biscaye) ; 5e légion à Burgos (Castille) ; 6e légion à Figuières (Catalogne).
C'est à l'occasion du renouvellement des effets d'uniforme de l'armée française qu'une importante modification dans la façon de tailler les vêtements va ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'uniforme. L'ensemble des textes élaborés par les commissions des différentes armes jusqu'en 1812 va être mis en application dès 1813.
LE RÈGLEMENT SUR L'UNIFORME DE 1812
L'habit à la française dont les revers se terminaient en pointe sur la poitrine laissant apparaître le vêtement du dessous disparaît au profit de l'habit-veste. Ce dernier se distingue du précédent par la coupe droite de ses revers qui couvrent intégralement le vêtement du dessous. Il est échancré au niveau des hanches pour dégager le haut des cuisses. Ses basques longues pour la gendarmerie (elles arrivent au niveau des genoux) et réduites pour l'infanterie (- 25 cm) sont tenues agrafées.
L'habillement des sous-officiers, brigadiers et gendarmes pour l'arme à pied et l'arme à cheval est composé d'un habit, d'une veste, d'une culotte, d'un surtout, d'un gilet à manches, d'un pantalon et d'une redingote capote.
Arme à pied
Habillement :

- L'habit est en drap bleu impérial, collet écarlate, revers écarlate, parements, pattes des parements, poches figurées en drap bleu bordé d'un passepoil écarlate, retroussis écarlate ornementés d'une grenade en drap bleu.
- Les boutons sont plats et blanc portant un aigle, le numéro de la légion et en exergue : Gendarmerie impériale.
- la veste et la culotte sont en drap chamois,
- le surtout est en drap bleu impérial doublé de cadis rouge; le collet bleu ainsi que les parements avec liseré écarlate;
- un gilet à manche bleu foncé, un pantalon de drap bleu, une redingote-capote en drap bleu complètent l'habillement de l'arme à pied,
- Chapeau de grande tenue est bordé d'un galon d'argent; un gros bouton à la hauteur des pointes latérales de la ganse; les cornes garnies de macarons en laine rouge; cocarde en laine; plumet en plumes de coq teintes en rouge, de 320mm de hauteur non compris la tige de baleine, de la forme d'un cône renversé et d'une largeur maximum de 20mm,
- le chapeau de petite tenue est pareil à celui de la grande tenue, mais bordé d'un bord en poil de chèvre noir uni, sans macarons.
- Le bonnet de police est en drap bleu, les quatre coutures garnies d'un cordonnet blanc, le bandeau garni d'un galon blanc, gland de fil blanc.
Marques distinctives
- les tambours et trompettes ne se distinguent que par leur galonnage,
- les officiers portent sur l'épaule gauche l'aiguillette en argent non plus montée en trèfle, mais surmontée d'une épaulette pour les colonels et d'une contre-épaulette pour tous les autres grades,
- les épaulettes des gendarmes sont identiques à celles des grenadiers (rouges); L'épaulette des brigadiers ont la tournante en argent, les maréchaux des logis également, mais leurs franges rouges sont couvertes de franges d'argent,
- Le maréchal des logis porte deux galons en argent placés en chevrons, le brigadier : un seul.
Armement
- mousqueton armé d'une baïonnette, avec bretelle en buffle blanc. Sabre-briquet du modèle de l'infanterie.
Équipement
- Baudrier portant une plaque représentant un aigle, autour duquel est inscrit Gendarmerie impériale.
- Giberne avec une grenade en cuivre, une banderole, un havre sac, une dragonne en laine écarlate.
- Un col noir, des guêtres façonnées en estamette noire, longues de manière à emboîter le genou, avec dix-huit boutons de cuivre jaune.
Particularités officiers
- Dans les cornes des chapeaux, les macarons ont des franges retenues par une tresse d'argent.
- Les bottes sont celles des officiers d'infanterie (en garnison ils faisaient usage de boucles).
- L'épée est celle de l'infanterie légère.
- Un ceinturon à plaque pour les officiers supérieurs; un baudrier d'épée pour les autres; un ceinturon de petite tenue pour les officiers de tout grade; un hausse-col. Epaulettes à franges d'argent. Galons de housses et chaperons en argent.
Arme à cheval


Habillement
- l'arme à cheval porte l'aiguillette de fil blanc à gauche avec ferrets en cuivre argenté, celle des sous-officiers en laine bleue et argentée en alternance, avec ferrets en argent,
- la patte d'épaule est en drap bleu avec un passepoil rouge à droite, attachée au collet au moyen d'un petit bouton, et fixée par le bas à la couture de l'emmanchure. Pas d'épaulette sur l'épaule gauche, mais un passant de 80mm de longueur sur 10 de largeur, doublé de drap rouge, pour fixer l'aiguillette,
- la culotte en peau de daim s'arrête au genou, le pantalon de cheval est en drap bleu. Pantalon de treillis,
- l'arme à cheval perçoit les mêmes surtout et gilet que l'arme à pied, une veste d'écurie en tricot bleu, un manteau trois-quarts en drap bleu sans manche et parementé de rouge.
- Pour les officiers : galons et aiguillette en argent.
Armement
- mousqueton armé d'une baïonnette,
- une paire de pistolets (de demi-arçon pouvant être portés dans les poches),
- un sabre (du modèle des carabiniers).
- Banderole de buffle blanc, ceinturon à plaque; bottes à l'écuyère du modèle des dragons.
Harnachement
- selle des dragons, bride, mors, filet, licol et coussinet en cuir noir ; filet de parade en fil blanc ; housse galonnée avec grenades en fil blanc ; portemanteau en drap bleu, semblable à celui des carabiniers, avec liserés en drap blanc, les fonds garnis, sur chaque côté de leur carré, d'un galon de fil blanc ; les brides de parade ornées d'une rosette en galon de laine ; une rosette au toupet du cheval et une autre à la naissance du culeron de la croupière sur la queue du cheval.
BATAILLE DE VILLODRIGO 23 octobre 1812 (Espagne).
Bataille inscrite au drapeau de la gendarmerie départementale.
La légion d'élite
Un décret du 1er mars 1813 réorganisait le régiment de gendarmerie d'élite à l'effectif de 1174 hommes (officiers compris). Pour cela on y incorporait 640 gendarmes-bis pris dans les conscrits recrutés pour la Garde. Le 16 janvier suivant, un décrét modifiait à nouveau la composition du régiment en réduisant le nombre de gendarmes-bis et en y introduisant des élèves-gendarmes. Avec l'état-major le complet du régiment était fixé à 1074 hommes.
Aprés la première abdication de Napoléon Ier le 6 avril 1814, le corps de la gendarmerie d'élite est dissous le 23 avril suivant. Il avait eu pour colonel jusqu'en 1810 le général Savary, duc de Rovigo, et de 1810 à 1814 le général Durosnel.
PREMIÈRE RESTAURATION
LOUIS XVIII (06/04/1814 - 20/03/1815)

Lorsque Louis XVIII accède à la couronne, la gendarmerie impériale prend le titre de gendarmerie royale.
Dans son ordonnance du 11 juillet 1814, le roi conserve la place de premier inspecteur général(1) et réduit l'effectif de l'arme à 13 358 hommes de tous grades. Il divise le corps de la gendarmerie en huit inspections, formant vingt-quatre légions et quatre-vingt-quinze compagnies. Chaque brigade est composée d'un maréchal des logis ou brigadier et de cinq gendarmes. Chaque compagnie fait le service d'un département ou d'un arrondissement maritime excepté dans la Ire et la 24e légion.
La première légion qui se recrute sur toute la gendarmerie est chargée plus particulièrement :
- du service de la ville de Paris(2), des arrondissements du département de la Seine,
- des voyages et chasses du roi(2) et de la garde et surveillance des résidences royales qui furent plus particulièrement attribuées à la première compagnie(3) de cette légion.
(1) Par ordonnance du 16 mai 1814, Louis XVIII donne aux généraux de brigade la dénomination de maréchaux-de-camp et aux généraux de division celle de lieutenants généraux. Leurs uniformes restent inchagés.
(2) Les services de la ville de Paris et celui des voyages et chasses du roi seront par la suite assurés par des corps constitués indépendants de la première légion.La compagnie des voyages et chasses du roi communément appelée « gendarmerie des chasses » fut composée avec une partie de la gendarmerie d'élite de la garde impériale.
(3) C'est le 24 mars 1772 que fut créée la compagnie des voyages et chasses du roi afin de ne pas détourner de leur service ordinaire les brigades de maréchaussée des compagnies des provinces. Cette compagnie qui comptait 4 officiers, 5 maréchaux de logis, 16 brigadiers et 137 cavaliers répartis en 27 brigades, fut supprimé par décrets des 18 août et 22 septembre 1790. En juillet 1814, Louis XVIII recréa cette compagnie sous l'appellation de compagnie des voyages et chasses du Roi communément appelée compagnie des chasses. Elle fut composée en partie par la Gendarmerie d'Élite et par la Garde Impériale.

Ordonnance du 16 mai 1814
Louis XVIII rétablit les anciens titres des généraux et des colonels qui avaient été modifiés par décret du 21 février 1793

Ordonnance du 11 juillet 1814
Louis XVIII modifie l'organisation de la gendarmerie royale. L'inspection générale du corps est composée d'un maréchal de France pour premier inspecteur général et huit inspecteurs généraux, dont quatre du grade de lieutenant général et quatre du grade de maréchal de camp. Le corps des officiers et celui des sous-officiers reste inchangé.
La gendarmerie des voyages et chasses
Comme l'avait fait son frère Louis XVI en 1772, Louis XVIII recréa, le 11 juillet 1814, la compagnie des voyages et chasses du roi que l'on désignait plus communément sous le nom de « gendarmerie des chasses ». Une partie de l'ancienne gendarmerie d'élite et de la garde impériale y entra.
LES 100 JOURS (20/03/1815 - 22/07/1815)
Lorsque l'empereur Napoléon remonta sur le trône le 20 mars 1815, la gendarmerie reprit momentanément le titre de gendarmerie impériale jusqu'en août 1815 où ce corps reparut sous le titre de gendarmerie royale. L'inspection générale de la gendarmerie créée le 5 janvier 1800 est supprimée le 25 juillet 1815.
La gendarmerie d'élite
Après son retour de l'Ile d'Elbe, Napoléon recréait par décret du 8 avril 1815, une compagnie de gendarmerie d'élite dans sa garde impériale reconstituée. Sous les ordres du général Dautancourt, l'effectif de cette compagnie fut fixée à 100 hommes. Après la bataille de Waterloo, les restes de ce corps, qui avait été porté à 250 hommes, fut licencié par une lettre du ministre de la Guerre du 15 septembre 1815.
| Trompette en tenue de corps de garde. (100 jours) |
Gendarme à cheval en tenue de campagne Waterloo (1815) |
Sous-officier de semaine (100 jours) |
|---|---|---|
 |
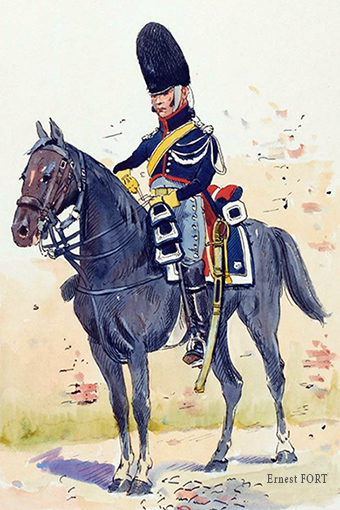 |
 |
|
|
|
![]() Par décret du 22 mars 1815, l'Empereur maintien dans l'armée les dénominations de lieutenant général et de maréchal de camp qui avaient été données aux généraux de division et de brigade par l'ordonnance du 16 mai 1814.
Par décret du 22 mars 1815, l'Empereur maintien dans l'armée les dénominations de lieutenant général et de maréchal de camp qui avaient été données aux généraux de division et de brigade par l'ordonnance du 16 mai 1814.
BATAILLE DE WATERLOO 18 juin 1815.
SECONDE RESTAURATION
LOUIS XVIII (08/07/1815 - 16/09/1824)
L'ordonnance du 10 septembre 1815 organise la gendarmerie en huit inspections , 24 légions et 46 escadrons. Les huit inspecteurs généraux du grade de lieutenant général ou de maréchal de camp, prennent rang selon leur ancienneté parmi les inspecteurs généraux de cavalerie et jouissent des mêmes honneurs, traitemens et indemnités. L'effectif du corps est fixé à 18 010 hommes, dont 650 officiers, répartis en 1550 brigades à cheval de huit hommes chacune et 620 brigades à pied au même effectif. La première légion faisait le service du département de la Seine, la première compagnie faisait le service des chasses et voyages du roi, et résidences royales, la seconde celui du département.

Une ordonnance du 18 novembre 1815 créa dans chaque département un jury chargé de présider à l'organisation des brigades de gendarmerie en exécution de l'ordonnance du 10 septembre précédent. Ce jury était composé du préfet, du procureur du roi, du général commandant le département et de deux officiers de gendarmerie. Il termina son travail dans le courant de 1816.
Une ordonnance du 23 octobre 1817 relative à la gendarmerie royale des départements prescrivait la suppression des chefs d'escadron placés à la tête des compagnies des départements. Seuls les départements où résidaient les chefs de légion et la compagnie des chasses et voyages seraient commandés à l'avenir par des chefs d'escadron. En 1819 le complet du corps est fixé à 13.985 hommes, dont 597 officiers. Le corps forme six inspections et vingt-quatre légions qui font le service des départements. Le service du département de la Seine, des voyages, chasses et résidences du Roi est affecté à la première légion. La Gendarmerie royale est divisée en 1600 brigades à cheval et 650 brigades à pied.
La seconde restauration se borna à changer les insignes des uniformes. C'est ainsi que la cocarde blanche succéda à la tricolore, les armes de France remplacèrent l'aigle sur les plaques de ceinturon et les boutons.
Cependant en l'absence d'un nouveau règlement, l'uniforme de la gendarmerie fit l'objet de fantaisies de toutes nature : le trèfle remplaça sur l'épaule droite la patte d'épaule réglementaire; les basques s'ornèrent de patte figurant des poches, les grenades bleues sur les retroussis cédèrent la place aux blanches...
Afin de mettre un terme à cette dérive parut le 5 février 1819 un nouveau règlement qui déterminait l'uniforme de la gendarmerie royale. Ce texte est le premier qui décrive les effets particuliers pour la gendarmerie de la Corse (17e légion).
Les Maréchaux de France
Le titre de maréchal de France est rétabli en 1815.
Leur insigne distinstif est le bâton recouvert de velour bleu et semé de fleurs de lys d'or comme sous l'ancienne monarchie.

Ordonnance du 30 août 1815
Louis XVIII crée dans chacun des régiments de cavalerie un lieutenant-colonel qui prend les marques distinctives et les appointements attribués en dernier lieu aux majors créés par l'Empereur. Il a le second rang dans le régiment. Les fonctions de lieutenant-colonel sont, conformément aux principes des ordonnances de constitution de 1776, 1788 et 1791, de commander le régiment sous les ordres du colonel en sa présence et en son absence et d'être ainsi son intermédiaire dans toutes les parties du service.
![]() Assimilées davantage aux marques distinctives des colonels, les effets de galonnage des lieutenants-colonels reprenaient le principe des galons à deux métaux fixés pour les majors créés sous le régime impérial. Ainsi, les épaulettes à torsades semblables à celles des colonels étaient en or et en argent. Les galons de shakos alternaient également l'or et l'argent.
Assimilées davantage aux marques distinctives des colonels, les effets de galonnage des lieutenants-colonels reprenaient le principe des galons à deux métaux fixés pour les majors créés sous le régime impérial. Ainsi, les épaulettes à torsades semblables à celles des colonels étaient en or et en argent. Les galons de shakos alternaient également l'or et l'argent.

Ordonnance du 2 août 1818
Sous-officiers : le grade de maréchal des logis-chef, créé par la loi du 25 pluviôse an V pour occuper l'emploi de trésorier est supprimé par ordonnance du 2 août 1818. Cet emploi est désormais confié à un lieutenant. Le corps des sous-officiers de la gendarmerie ne compte que deux grades : brigadier et maréchal des logis.
Officiers : les maréchaux des logis de gendarmerie appelés aux emplois de lieutenant sont initialement promus qu'au grade de sous-lieutenant. Après quatre ans d'exercice ils recevoivent leur brevet de lieutenant. Cependant, les emplois de sous-lieutenants n'existant pas en gendarmerie, ces derniers remplissent, pendant cette période transitoire, les mêmes fonctions que les lieutenants et leur sont assimilés pour la solde. Ce délais permettant au maréchal des logis de se former à son nouvel emploi de lieutenant.
Il en est de même pour les chefs d'escadron de gendarmerie appelés à occuper les emplois de chef de légion. Ils sont d'abord nommés au grade de lieutenant-colonel. Comme cet emploi n'existe pas en gendarmerie, ils remplissent les mêmes fonctions et reçoivent la même solde que les chefs de légion. Après quatre ans de grade de lieutenant-colonel, ils sont promus au grade de colonel.
RÈGLEMENT DU 5 FÉVRIER 1819
Les principales modifications apportées par ce règlement de février consistaient à échancrer davantage l'habit sur les côtés et à raccourcir ses basques d'une soixantaine de millimètres. Le collet devient bleu ainsi que le passepoil bordant le revers. Les poches restent figurées par une patte à trois pointes. Les grenades blanches des retroussis sont conservées (elles seront d'argent pour les officiers et argent et fil bleu pour les sous-officiers). Les gendarmes à cheval portent l'aiguillette blanche à gauche montée en trèfle et un trèfle blanc à droite (bleu et argent pour les sous-officiers, rouge et argent pour les trompettes), la culotte est supprimée.
La grande tenue est composée d'un habit de drap bleu-de-roi, ayant revers et retroussis en drap écarlate et d'un pantalon en drap chamois demi-collant. La petite tenue est composée d'un surtout de drap bleu-de-roi avec retroussis en drap écarlate et d'un pantalon en drap gris. Les bottes des cavaliers sont demi-fortes, les gendarmes à pied ont deux paires de guêtres noires, une longue pour la grande tenue et une courte pour la petite tenue.
Les inspecteurs généraux de la gendarmerie royale portent, suivant leur grade, l'uniforme déterminé pour les officiers généraux de l'armée.
Gendarmerie des départements
Composition de l'habit
- Effets communs à l'arme à cheval et à l'arme à pied
- l'habit est en drap bleu de roi. Le parement, jusqu'alors écarlate devient bleu comme la patte, il est à trois boutons, bordé d'un passepoil écarlate, collet du même drap est bordé du même passepoil. Les retroussis écarlates sont ornés d'une grenade en fil blanc pour les gendarmes, filet d'argent et bleu pour les sous-officiers, argent pour les officiers. L'habit est garni de 8 gros boutons et 22 petits. Ils sont en argent pour les officiers et en métal blanc argenté pour la troupe. Ilsportent un écusson à trois fleurs de lis couronnées, environnées de branches de laurier et d'olivier ; au pourtour de l'écusson sont inscrit lesmots Gendarmerie royale
- le pantalon est à petit-pont et demi-collant. Il est chamois pour la grande tenue et gris pour la petite tenue,
- la culotte en drap chamois (arme à pied) ou en peau de daim (arme à cheval) s'arrête au genou,
- un surtout bleu garni de 11 gros boutons et 8 petits, un gilet à manche bleu foncé.
- Effets particuliers pour l'arme à cheval
- l'aiguillette de fil blanc se porte à gauche et la patte d'épaule en drap bleu à droite,
- le manteau est à manche et grand collet doublé écarlate,
- l'arme à cheval perçoit les mêmes surtout et gilet, une veste d'écurie en tricot bleu fermant sur le devant au moyen de dix petits boutons d'uniforme, un pantalon de cheval en drap bleu, un manteau trois-quarts en drap bleu sans manche et parementé de rouge,
- Effets particuliers pour l'arme à pied
- l'épaulette des brigadiers a la tournante en argent, celle les maréchaux des logis également, mais leurs franges rouges sont couvertes de franges d'argent, les gendarmes portent deux épaulettes à franges rouges,
- la capote est coupée droit,
- les guêtres recouvrent les genoux,
- un pantalon de drap bleu, une redingote-capote complètent l'habillement de l'arme à pied. Le turban est bordé d'un galon argent pour les maréchaux des logis et brigadiers, d'un galon blanc pour les gendarmes. Il est orné
Coiffures
- Compagnies des départements et arrondissements maritimes
- un chapeau de grande tenue bordé d'un galon d'argent ; il est orné d'une cocarde de basin blanx et d'une ganse en argent comportant en son milieu une raie noire qui est fixée sur le côté gauche au moyen d'un gros bouton d'uniforme.
- un chapeau de petite tenue bordé d'un galon en poil de chèvre noir avec cocarde en basin blanc et ganse en argent,
- un bonnet de police façonné à la dragonne et composé d'un turban, d'une queue, d'un gland et d'une coiffe. Il est orné d'une grenade pareille à celle des retroussis de l'habit.
- Compagnies des chasses
- un casque à la dragonne composé d'un turban, de deux mentonnières fixées au turban par deux têtes de lion, d'une bombe, d'un cimier et d'une crinière. Il est orné d'un plumet blanc
- un bonnet de police identique au précédent.
Distinctions
- Pour les officiers
- Les épaulettes et les contre épaulettes des officiers sont en argent. Les franges sont à torsades dites cordes à puits pour les colonels, lieutenans-colonels et chefs d'escadron. Le corps des épaulettes des lieutenans-colonels est en or.
- Les capitaines, les lieutenans et les sous-lieutenans font usage que de franges en filé dites graines d'épinards. Ils portent sur l'épaule gauche, l'aiguillette en argent non plus montée en trèfle, mais surmontée d'une épaulette pour les colonels et d'une contre-épaulette pour tous les autres grades.
- Pour les maréchaux-des-logis
- les maréchaux des logis tant à pied qu'à cheval portent l'aiguillette 1/3 en fil bleu de roi et 2/3 en filé d'argent et un trèfle sur l'épaule droite bleu et argent. Ils portent deux galons d'argent disposé en chevron sur les manches de l'habit, du surtout et de la capote.
- Les brigadiers portent les mêmes accessoires, mais les proportions de fil bleu et argent sont inversées et un galon d'argent sur les manches.
- Les gendarmes portent les aiguillettes et les trèfles en fil blanc.
- les tambours et trompettes ne se distinguent que par leur galonnage,
Grand équipement
- Pour les officiers
- Ceinturon de buffle couleur chamois bordé argent avec bélières en cuivre doré.
- Pour l'arme à cheval
- Ceinturon de buffle couleur chamois bordé de fil blanc avec bélières en cuivre bruni.
- un baudrier et une banderole de giberne couleur chamois bordés de fil blanc,
- une giberne avec grenade de cuivre rouge à neuf flammes.
- Pour l'arme à pied
- Comme l'arme à cheval le ceinturon en moins.
- porte-baïonnette pour les brigadiers et gendarmes.
Le baudrier et le ceinturon sont ornés d'une plaque portant l'écusson aux trois fleurs de lis couronnées, environnées de branches de laurier et de chêne avec la légende Gendarmerie royale
Gendarmerie de la Corse
Ce règlement est le premier texte qui décrit les effets particuliers à la gendarmerie de la Corse (17e légion).
- Effets : Pendant l'été les gendarmes font usage d'un pantalon de toile blanche, celui de la gendarmerie à pied a les mêmes dimensions que le pantalon de drap gris, Celui de la gendarmerie à cheval est porté par dessus la botte.
- Coiffure : les gendarmes ne portent pas le chapeau, mais un shako en feutre noir, avec calotte de cuir noir et galon de pourtour en argent, jugulaire en cuir avec écailles et rosace en cuivre argenté, pompon rouge à flamme. Une plaque de cuivre argenté aux armes de France porte la légende « Gendarmerie royale ». Ils sont équipés du bonnet de police identique à celui des autres compagnies et d'un couvre-schako en toile cirée noire et son couvre-nuque.
Les gendarmes ne pouvant se remonter en Corse qu'avec des chevaux de très petite taille, les dimensions des pièces de harnachement sont diminuées.

Compagnie des chasses et voyages
Le service des chasses et voyages du roi fut initialement attribué à la première légion par l'ordonnance du 10 septembre 1815 (art. 2). Cette légion ne s'étendait que sur le département de la Seine. Cette compagnie est vêtue de la même manière que les gendarmes des départements, mais se distingue par :
- sa coiffure : qui est un casque à la dragonne. Il est composé d'un turban, de deux mentonnières fixées au turban par deux têtes de lion, d'une bombe, d'un cimier et d'une crinière. Il est orné d'un plumet blanc. Sur le turban sont placées les armes de France et l'inscription compagnies de gendarmerie des voyages chasses et résidences du Roi
Ils sont équipés du bonnet de police identique à celui des autres compagnies. - son équipement : son porte-carabine couleur chamois bordé d'un galon blanc.
Armement
- Officiers :
- un sabre(1) et une paire de pistolets(2), épée(3) en tenue de société (facultatif)
- Sous-officier et gendarmes à pied :
- un mousqueton(4) armé de sa baïonnette et un sabre-briquet des grenadiers des troupes de ligne (Mle 1816),
- Maréchaux des logis à cheval :
- un sabre(5) et une paire de pistolets(6)
- Brigadiers et gendarmes à cheval :
- un sabre, un mousqueton armé de sa baïonnette, une paire de pistolets (modèle court, spécialement conçu pour les porter dans la poche de l'habit).
Le changement des armes suivant le modèle retenu n'était pas uniforme pour toutes les unités. Les manufactures d'armes d'état n'étaient pas en mesure de fournir des volumes très importants. Les armes étaient façonnées à la forge. Leur remplacement se faisait petit à petit en prenant en compte l'augmentation des effectifs et l'usure des armes en service. À cette époque le prix moyen d'un fusil était de l'ordre d'une trentaine de livres.
(1) Le sabre modèle de l'an XI sera reconnu comme la seule arme réglementaire de la gendarmerie à cheval par le règlement du 5 mai 1819. Il avait une lame de Klingenthal évidée et légèrement courbe, longue de 900 millimètres portant pour légende en lettres d'or gendarmerie royale. La monture avait trois branches évidées et surdorées, la capote de la monture portait une fleur de lis en relief, la poignée était noire en peau de chagrin et garnie de filigrane doré. Le fourreau était en acier poli, les bracelets et anneaux en cuivre doré. Les branches de la monture du sabre des officiers supérieurs étaient ciselées.
(2) Les pistolets d'officiers étaient du même calibre et des mêmes dimensions que les pistolets de la troupe, mais de facture plus soignée. Le canon était à pans jusqu'au tiers de sa longueur, le reste arrondi jusqu'à son embouchure qui était en forme de trombe. Le canon était bronzé gris de cendre. La platine, la calotte, la sous-garde, la capuche et la baguette étaient en fer poli, le bassinet en cuivre.
(3) À pied et en tenue de société, les officiers pouvaient porter une épée avec poignée ciselée et dorée ayant une grenade sur le pommeau et les armes de France en relief sur la coquille. La lame carrelée fine avait 890 millimètres de longueur et 25 millimètres de largeur au talon.
(4) Le mousqueton pour la gendarmerie à pied et à cheval était du modèle de l'an IX (1801). Il avait un canon de 28 pouces de longueur à 5 pans raccourcis. Calibre 7 lignes 7 points. Platine ronde, bassinet en cuivre. Baguette d'acier à tête en cône tronqué renversé. Baïonnette à 18 pouces de lame pesant 11 onces.
(5) Le sabre de la gendarmerie à cheval était à lame demi-courbe avec fourreau en fer du modèle adopté depuis l'an XI (1803) pour les troupes légères à cheval. Celui de la compagnie des voyages et chasses était d'une dimension un peu plus longue.
(6) Le pistolet de la troupe était du modèle de l'an IX (1801). Il avait un canon de 4 pouces 9 lignes de longueur à 5 petits pans. Calibre de 6 lig. 9 points. Platine ronde. Bassinet en cuivre. Baguette d'acier à tête-de-clou. Garnitures en fer. Longueur totale 245mm.
| Pistolet de gendarmerie Mle 1816 | Caractéristiques |
|---|---|
 |
|
| Mis en service par le règlement de 1819, ce pistolet fut le dernier modèle à silex pour la gendarmerie | (Musée de la gendarmerie nationale) |
Le règlement du 5 février 1819 sera successivement retouché par les circulaires du 10 juillet 1821 portant modification des marques distinctives des grades, du 3 mai 1822 portant modifiant de certains éléments de la tenue et création d'une fonte en cuir pour l'arme à pied portée sur le coté gauche de l'homme afin d'y placer le pistolet au lieu de le mettre en poche enfin celui du 3 mai 1826 qui supprime le chapeau de petite tenue.
ORDONNANCE DU 16 MARS 1820
Gendarmerie d'élite

Par ordonnance du 16 mars 1820, la gendarmerie des voyages et des chasses reçut une organisation distincte et prit le nom de Gendarmerie d'élite. Forte de 240 hommes, elle était constituée de deux compagnies de 117 hommes chacune. Commandée par un colonel, elle était placée sous les ordres du major général de la garde royale. Le recrutement se fit exclusivement parmi les gendarmes des compagnies départementales.
Le 27 avril suivant, une ordonnance fixait les règles de service, la solde et le mode d'admission dans ce corps. Les généraux commandant les divisions militaires et les autres autorités civiles et militaires ne pouvaient disposer de la gendarmerie d'élite ni la distraire de ses fonctions spéciales. Un trompette et un artiste vétérinaire lui sont attachés sous les noms de trompette brigadier et maréchal vétérinaire.
Le corps de la gendarmerie d'élite faisait partie du corps royal de la gendarmerie et à ce titre les mêmes dispositions lui étaient applicables. Ainsi, les gendarmes d'élite pouvaient constater les délits et contraventions et verbaliser.
Par ordonnance du 17 octobre 1821, Louis XVIII l'incorpora dans la garde royale, mais lui conserva toutes les dispositions prévues par l'ordonnance de 1820.
À compter de cette date, cette troupe qui avait porté comme toute la gendarmerie l'aiguillette à gauche la porta à droite comme toute la cavalerie de la maison militaire du roi. La grenade qui ornait le tapis de selle fit place au chiffre royal (les deux L croisés de Louis XVIII).
En dehors de ce détail, l'uniforme de la gendarmerie des chasses était dans ces grandes lignes identiques à celui de la gendarmerie d'élite du 1er empire. Seul le casque à chenille à la minerve orné sur le devant des armes de France avait remplacé le bonnet à poil.
![]() Avec l'ordonnance du 31 mars 1820, Louis XVIII fixe à trois lieutenants généraux et six maréchaux de camp le nombre d'officiers généraux qui seront spécialement employés à l'inspection de la gendarmerie royale.
Avec l'ordonnance du 31 mars 1820, Louis XVIII fixe à trois lieutenants généraux et six maréchaux de camp le nombre d'officiers généraux qui seront spécialement employés à l'inspection de la gendarmerie royale.
Ordonnance du 5 avril 1820
Ce texte fixe une première mise d'habillement aux militaires passant dans la gendarmerie royale soit qu'étant libérés du service actif de l'armée ils obtiennent d'entrer dans ce corps ou qu'ils y soient appelés des différens corps de l'armée.

Ordonnance du 29 octobre 1820
À la suite de tous ces bouleversements, la gendarmerie ne marchait plus que par habitude au milieu d'un dédale de lois, de règlements et de circulaires. Le 29 octobre 1820, une ordonnance vint récapituler tous les droits et devoirs de l'arme. Sur l'avis des ministres de la Guerre, de l'Intérieur, de la Justice et de la Marine, elle réunit toutes les décisions qui formaient la législation de la gendarmerie. Elle réglait les droits à l'avancement de tous ceux qui la composaient, les fonctions attribuées à chacun, leurs rapports avec les différentes autorités, etc. Par cette ordonnance le corps de la gendarmerie fut composé :
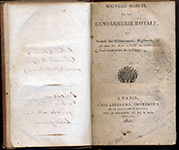
- de la gendarmerie d'élite instituée pour le service des résidences royales et celui des chasses. Cette compagnie était forte de 241 hommes de tous grades,
- de 24 légions divisées en autant de compagnies qu'il y a de départements et dont le nombre d'hommes officiers compris s'élevait à 14 086 répartis en 1600 brigades à cheval et 666 brigades à pied,
- de la gendarmerie de Paris forte de 1 528 hommes de tous grades.
Les corps de la gendarmerie d'élite et de la gendarmerie de Paris furent soumis aux règles établies pour la police et la discipline de la gendarmerie de France tout en conservant la constitution provisoire qui leur a été donnée à raison de la spécialité de leur service.
Ordonnance du 10 octobre 1821
Ordonnance qui établit dans chaque compagnie de gendarmerie un abonnement de remonte et de secours destiné à aider les sous-officiers et gendarmes dans leurs dépenses d'habillement et d'équipement.
ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE 1822
Bataillon de voltigeurs corses
Pour suppléer la gendarmerie royale dans ces différentes missions, Louis XVIII crée par l'ordonnance du 6 novembre 1822 (Mémorial, vol. 2, n° 591, p.216) dans la 17e division militaire (la Corse) un bataillon qui prend la dénomination de bataillon de voltigeurs corses. Ce bataillon composé d'un état-major (à Bastia) et de quatre compagnies (à Ajaccio, Corte, Sartène, Sainte-Lucie de Tallano) était à l'effectif de seize officiers et quatre cent cinq hommes de troupe. Ce corps fut soumis pour son service aux mêmes autorités et aux mêmes règlements que la gendarmerie royale.
Habillement
L'habillement des voltigeurs comprenait : un habit veste, un pantalon large avec demi-guêtres, une capote un shako pour coiffure.
Armement
Chaque homme de troupe était équipé d'une ceinture avec fontes de pistolets, de deux pistolets, d'une cartouchière en cuir noir, d'une carabine et d'un sabre d'infanterie fournis par les arsenaux de l'État.
![]() Le règlement du 21 novembre 1823 impose des règles pour la comptabilité de la gendarmerie qui jusqu'alors était livrée au caprice de ses comptables. Sa tenue est uniformisée et l'allocation des fonds est arrêtée.
Le règlement du 21 novembre 1823 impose des règles pour la comptabilité de la gendarmerie qui jusqu'alors était livrée au caprice de ses comptables. Sa tenue est uniformisée et l'allocation des fonds est arrêtée.
CHARLES X
(16/09/1824 - 02/08/1830)
Lorsque Charles X monte sur le trône, la gendarmerie est organisée suivant l'ordonnance du 29 octobre 1820. Elle fait partie de l'armée, prend rang après la garde et compte parmi les corps royaux. L'ordonnance définit la gendarmerie comme : Force pour veiller à la sûreté publique.

La gendarmerie se compose alors de la gendarmerie d'élite, de la gendarmerie des départements, de la gendarmerie de Paris.
— La première créée pour le service résidences royales est placée sous les ordres du major général de la garde royale ; elle est composée de 1 colonel, 1 capitaine adjudant major, 1 lieutenant trésorier, 1 chirurgien major, 1 adjudant sous officier, 1 trompette-brigadier, 1 vétérinaire, 2 chefs d’escadron, 6 lieutenants, 2 maréchaux des logis-chefs, 12 maréchaux des logis, 24 brigadiers, 184 gendarmes, 4 trompettes. La force totale de la gendarmerie d’élite est de 241 hommes.
— La gendarmerie départementale divisée en 24 légions subdivisées en compagnies, lieutenances et brigades est soumise à l’inspection de lieutenants généraux nommés chaque année comme les inspecteurs de l’armée. Elle est à l’effectif général de 14 086 sous-officiers et gendarmes répartis en 24 colonels, 24 chefs d’escadrons commandants de compagnie, 68 capitaines, 378 lieutenants, 92 trésoriers. Les sous-officiers et soldats sont divisés en gendarmes à cheval et gendarmes à pied. Les premiers comptaient 533 maréchaux des logis, 1 067 brigadiers, 8 000 gendarmes et trompettes ; les seconds : 216 maréchaux des logis et 434 brigadiers et gendarmes.
— Le corps de la gendarmerie royale de Paris était à l’effectif de 1528 hommes. Il se composait de 6 compagnies et d’un état-major, 1 colonel, 3 chefs d’escadron, 1 major, 1 capitaine adjudant-major, 2 lieutenants adjudants-majors, 1 trésorier civil, 3 chirurgiens civils, 3 adjudants sous-officiers, 1 vétérinaire, 1 maréchal des logis, trompette, 1 tambour-major, 4 maîtres ouvriers, 6 capitaines, 24 lieutenants, 6 maréchaux des logis-chefs, 36 maréchaux des logis à cheval, 60 maréchaux des logis à pied, 6 brigadiers-fourriers, 72 brigadiers à cheval, 120 brigadiers à pied, 12 trompettes, 12 tambours soit 432 gendarmes à cheval 720 gendarmes à pied.

Ordonnance du 26 janvier 1825
Ordonnance du Roi portant qu'à dater du 10 janvier 1826 le département de la guerre fournira des détachements de gendarmerie à pied et à cheval nécessaires au service militaire des colonies.
RÈGLEMENT DU 22 SEPTEMBRE 1826
Le renouvellement de la tenue demandé sous Charles X par le comité consultatif de l'arme fut une occasion pour modifier une nouvelle fois la tenue existante. Afin de faciliter la lecture de cet ensemble de prescriptions, tous ces textes furent réunis dans un même règlement, celui du 22 septembre 1826 qui fixa l'uniforme dans toutes ses parties. À compter de ce règlement, l'uniforme de la gendarmerie se déclina en grande et petite tenue.
Habillement
- Grande tenue pour les officiers, sous-officiers et gendarmes :
- habit de drap bleu de roi, avec les revers et retroussis en drap écarlate et d'un pantalon de drap chamois.
- petite tenue :
- surtout de drap bleu de roi avec retroussis en drap écarlate et d'un pantalon de drap gris.
- Officiers : effets complémentaires :
- Les officiers étaient dotés d'un manteau, dit manteau-capote, et d'un bonnet de police,
- les sous-officiers et gendarmes à cheval d'un manteau-capote, d'un bonnet de police et d'une veste d'écurie;
- les sous-officiers et gendarmes à pied percevaient une capote, un bonnet de police et une veste ronde semblable à celle de la gendarmerie à cheval.
- L'ensemble du personnel conservait le pantalon de coutil blanc pour la tenue d'été.

Coiffe
- La coiffure était composée pour la gendarmerie des départements et des arrondissements maritimes d'un chapeau bordé en galon d'argent et d'un bonnet de police du même drap que celui de l'habit. Le chapeau était orné d'une cocarde en basin blanc.
- Les gendarmes de la 17e légion de gendarmerie en Corse et du bataillon des voltigeurs corses recevaient un shako et un bonnet de police.
Chaussures
- bottes sont garnies d'éperons pour les cavaliers,
- chaussures pour les gendarmes à pied avec trois paires de guêtres. Une paire longue et une courte de couleur noire, la troisième longue et blanche pour être portées avec le pantalon d'été.
Signes distinctifs
- Les boutons (une cinquantaine environ) en argent pour les officiers et en fer blanc pour la troupe comportent une empreinte représentant un écusson à trois fleurs de lys, couronné et environné de branches de laurier et d'olivier sur lesquels sont inscrit : gendarmerie royale.
- Les officiers, sous-officiers et gendarmes portent l'aiguillette sur l'épaule gauche; les sous-officiers et gendarmes un trèfle sur l'épaule droite. Les aiguillettes des maréchaux des logis en des brigadiers sont en fil d'argent et laine bleu de roi. Celles des gendarmes sont en fil blanc.
- Les officiers supérieurs et subalternes portent l'épaulette du grade dont ils sont titulaires. Les franges sont à torsades pour les colonels, lieutenants-colonels et chefs d'escadron, à frange en filé (dit graine d'épinard) pour les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants.
- Les maréchaux des logis sont distingués par deux galons d'argent cousus en chevron sur l'avant-bras de chaque manche, un pour les brigadiers.
Accessoires
- Les officiers sont pourvus d'un ceinturon à bélières en buffle et d'un porte-épée ;
- Les maréchaux des logis à cheval, d'un ceinturon à bélières en buffle et d'une banderole avec sa giberne;
- Les brigadiers et gendarmes à cheval, d'un ceinturon à bélières, d'une banderole de giberne, d'une bretelle de mousqueton, d'une giberne et d'un fourreau de baïonnette;
- Les sous-officiers et gendarmes à pied, d'un baudrier de sabre, d'une banderole de giberne, d'une bretelle de mousqueton, d'une giberne et d'un fourreau de baïonnette.
Tous les objets en buffle seront entretenus en couleur chamois.
Armement
- Pour les officiers, d'un sabre(1) et d'une paire de pistolets ;
- Pour les sous-officiers et gendarmes à pied, d'un mousqueton(2) armé de sa baïonnette, d'un sabre-briquet et d'un pistolet ;
- Pour les maréchaux des logis à cheval, d'un sabre et d'une paire de pistolets;
- Pour les brigadiers et gendarmes à cheval, d'un sabre, d'un mousqueton armé de sa baïonnette et d'une paire de pistolets.
(1) C'est à cette occasion que la gendarmerie va adopter le sabre de cavalerie légère Mle. 1822 qui sera pendant plus d'un siècle l'arme de la gendarmerie à cheval et disparaîtra le 31 décembre 1937 lorsque les chevaux seront supprimés dans la gendarmerie départementale.
(2) Ce mousqueton Mle. 1825 en usage dans la cavalerie est une arme à silex. Il sera dénommé mousqueton de gendarmerie après quelques modifications minimes portant sur la conception de certaines pièces d'assemblage. La longueur de son canon est de 28 pouces (0,758m) et est au calibre de 7 lignes 7 points (17,1mm). Il est équipé de la même baïonnette que celle du fusil d'infanterie d'une longueur de 17 pouces (46cm).
| Sabre modèle 1822 | Caractéristiques techniques |
|---|---|
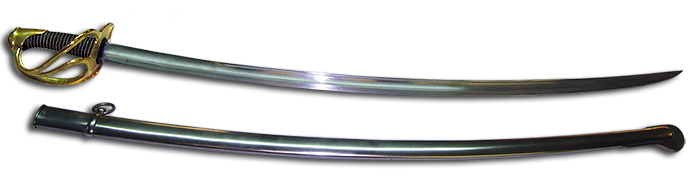 |
|
| (collection Tenue bleu-gendarme) |
Gendarmerie de la Corse
Avec ce règlement, la grande tenue est supprimée pour la gendarmerie de Corse. Elle n'est plus équipée de l'habit à revers, du pantalon chamois et des bottes à l'écuyère. Les cavaliers font usage uniquement des petites bottes garnies d'éperons fixés aux talons. La légion est dotée d'un pantalon d'été en toile blanche. Celui des cavaliers est ouvert sur le côté depuis le bas jusqu'au genou et fermé par neuf boutons. Le shako en carton imperméable est recouvert d'un tissu de coton noir.
Bataillon de Voltigeurs corses
Quatre ans après la création du bataillon, la tenue des voltigeurs corses est définie avec plus de précision dans ce texte.
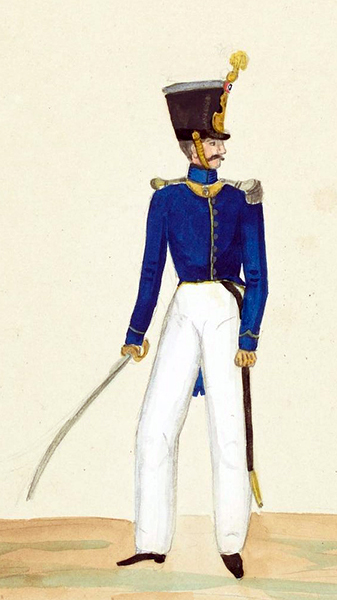

Habillement
- Habit court entièrement bleu de roi est orné d'un passepoil jonquille. Il est coupé droit sur la poitrine et fermé par une rangée de neuf boutons avec parement en pointe.
- Les retroussis sont ornés de boutons blancs et un corps de chasse en drap jonquille aux quatre angles des retroussis.
- Les trèfles sont en laine jonquille.
- Le pantalon en drap gris bleu, en coton bleu pour l'été.
- Capote bleu de roi avec une patte jonquille au collet.
- shako de la gendarmerie de la Corse, mais avec des garnitures en cuivre, pompon jonquille.
- Banderole, baudrier et ceinturon de giberne en cuir fauve. Cordon de sabre en laine jonquille.
- Le reste de l'équipement est identique à celui de la gendarmerie de la Corse.
![]() Une ordonnance du 21 décembre 1828 prévoit qu'à partir du 1er janvier 1830, la direction, l'administration et la comptabilite de tous les services militaires aux colonies ressortiront exclusivement au département de la marine, mais que nonobstant, les compagnies de gendarmerie royale qui y sont employées continueront d'appartenir à l'armée de terre.
Une ordonnance du 21 décembre 1828 prévoit qu'à partir du 1er janvier 1830, la direction, l'administration et la comptabilite de tous les services militaires aux colonies ressortiront exclusivement au département de la marine, mais que nonobstant, les compagnies de gendarmerie royale qui y sont employées continueront d'appartenir à l'armée de terre.
C.M. du 13 juillet 1830
Cette circulaire supprime la banderole de giberne et adopte le pantalon de coutil blanc pour l'été.
- MONARCHIE DE JUILLET -
LOUIS -PHILIPPE Ier (09/08/1830 - 24/02/1848)
Dès le début de la monarchie de juillet, la gendarmerie cesse d'être appelée « gendarmerie royale » pour devenir « la gendarmerie » tout court. Ce corps se compose :

- de la Gendarmerie d'élite instituée pour le service des résidences royales. Elle est composée d'un état-major et de 2 escadrons. La force du corps est de 3I7 hommes y compris 16 officiers. Une ordonnance du 11 août 1830 prononça la dissolution de la garde royale et de la maison militaire de l'ex-roi Charles X. La gendarmerie d'élite ne fut plus rétablie et son personnel fut versé dans la gendarmerie départementale.
- De 24 légions pour le service des départements et des arrondissements maritimes. Les 24 légions sont divisées en compagnies, lieutenances et brigades, la force totale de ces légions est de 12 100 hommes (9600 à cheval et 2500 à pied) et de 587 officiers.
- De la gendarmerie spécialement affectée au service de la ville de Paris. Elle est composée d'un état-major et 6 compagnies de 251 hommes chacune. La force totale de ce corps est de 42 officiers et de 1486 sous-officiers et gendarmes dont 569 hommes à cheval et 917 à pied.
- De 2 compagnies de Gendarmerie à cheval employées dans les îles de la Martinique et de la Guadeloupe. La compagnie de la Martinique est à l'effectif de 68 hommes et celle de la Guadeloupe compte 88 hommes.
- Du bataillon de voltigeurs corses auxiliaires de la Gendarmerie à l'effectif de 421 hommes officiers compris.
La gendarmerie est inspectée par des inspecteurs généraux du grade de Lieutenant général ou de Maréchal de camp.
Dans les premières années de son règne, Louis-Philippe Ier n'apporta que de modestes modifications à la tenue. Ce fut l'objet de l'ordonnance du 8 septembre 1830 qui détermina les dénominations et l'uniforme des corps de gendarmerie destinés à la surveillance des départements, des arrondissements maritimes et des colonies.
ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1830
Avec cette ordonnance, les corps de gendarmerie destinés à la surveillance des départements, des arrondissements maritimes et des colonies sont désormais désignés sous les dénominations suivantes savoir : 1) Gendarmerie départementale, 2) Gendarmerie des ports et arsenaux, 3) Gendarmerie des colonies.
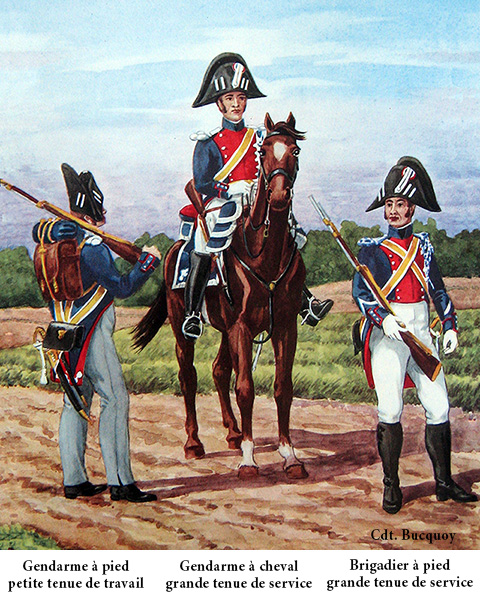
Principales modifications
- Sur la plaque du baudrier et du ceinturon ainsi que sur les boutons l'écusson aux armes royales est remplacé par le coq gaulois avec la légende « Gendarmerie départementale », « Gendarmerie des ports et arsenaux », « Gendarmerie des colonies » et l'exergue : Sûreté publique ».
- Les parements de l'habit et du surtout sont en drap écarlate et maintenus par une patte à trois pointes en drap blanc avec passe-poil écarlate.
- Le pantalon chamois est remplacé dans la grande tenue par un pantalon blanc en peau de mouton pour la cavalerie et en drap pour l'infanterie.
- La bordure du chapeau en galon d'argent est supprimée. Il y est substitué un galon noir en poil de chèvre uni. La corne du devant et la partie relevée du derrière sont ornées chacune de quatre passants en galons d'argent, à cul-de-dé, suivant le modèle qui sera adopté.
- Les trèfles, aiguillettes ainsi que les épaulettes et contre-épaulettes sont maintenus dans leurs formes et couleurs pour les officiers, sous-officiers et gendarmes.
- La buffleterie, l'armement et le havresac sont conservés.
- Les rubans de tête et de queue et la cocarde rouge pour l'ornement des chevaux disparaissent après 110 ans d'existence.
À l'issue de cette ordonnance, c'est par petites touches que les effets de la gendarmerie vont être modifiés. Ainsi, en 1831, les grandes bottes sont supprimées et remplacées par une petite botte dite à la Souvarov, le pantalon blanc est remplacé par un pantalon bleu de roi de la couleur de l'habit. Le parement de l'habit à passepoil écarlate, conforme à l'instruction de 1826 est rétabli.

Code d'instruction criminelle - ordonnance du 28 avril 1832
Dans ce nouveau code d'instruction criminelle, les officiers de la gendarmerie nationale sont maintenus dans leur fonction d'officier de police judiciaire. Ils sont placés sous l'autorité des cours royales. À ce titre, ils sont habilités à recevoir les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Gendarmerie maritime

Ordonnance du 19 juin 1832
À dater du 1er janvier 1833, la Gendarmerie des ports et arsenaux reprend son ancienne dénomination de gendarmerie maritime. Elle cesse d'appartenir au département de la Guerre et passe dans les attributions du ministre de la marine. Désormais son personnel est recruté parmi les sous-officiers et soldats des troupes de marine. Elle est spécialement affectée à la police judiciaire des ports et arsenaux, à l'exécution du service relatif à l'inscription maritime, à la police de la navigation, à la police des pêches ainsi qu'à toutes les opérations qui s'y rattachent, soit à l'intérieur des ports, soit à l'extérieur. Toutes les lois, ordonnances relatives au service, à la police, à l'avancement, aux allocations etc. concernant le corps de la gendarmerie départementale lui sont applicables. Son uniforme et son armement sont les mêmes que ceux de la gendarmerie départementale, cependant les compagnies portent le numéro de l'arrondissement auquel elles sont rattachées.
NOTE : la circulaire ministérielle du 6 novembre 1835, l'Instruction du 18 avril 1836 et l'instruction du 21 août 1846 lui sont applicables.

Loi du 23 février 1834
Cette loi qui ouvre des crédits pour l'accroissement temporaire de l'effectif de la gendarmerie, attribue les fonctions d'officier de police judiciaire aux maréchaux des logis et aux brigadiers de gendarmerie dans les départements des Côtes-du-Nord, des Deux-Sèvres, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, du Morbihan, de la Sarthe et de la Vendée.

Armement des officiers
Par décision ministérielle du 12 octobre 1835, l'armement des officiers de gendarmerie est composé :
1) du sabre de cavalerie légère (modèle de 1822) ;
2) de l'épée des officiers de cavalerie de réserve ;
3) d'un pistolet à percussion (modèle Poncharra).
C.M. du 6 novembre 1835
La capote est pourvue sur chaque épaule d'un passant de drap pour retenir la buffleterie. Les trèfles sont désormais montés sur cuir et rembourrés de coton prenant l'aspect qu'ils allaient garder près d'un siècle. Le comité consultatif de la gendarmerie ayant proposé de supprimer la grande tenue, le ministre décide de suspendre la distribution des effets. Cette mesure annonçait la parution d'un nouveau règlement.
| Sabre modèle 1816 | Caractéristiques techniques |
|---|---|
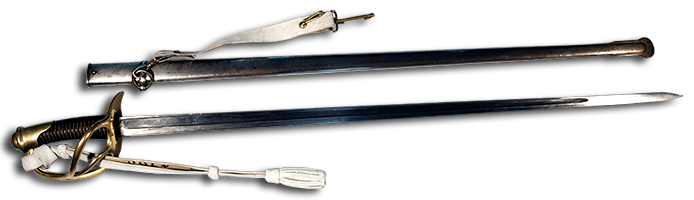 |
|
| Sabre et son fourreau | (Collection Tenue bleu-gendarme) |
Hiérarchie des militaires non officiers de l'arme

La loi du 14 avril 1832
Cette loi portant sur l'avancement dans l'armée de terre, fixe la hiérarchie des militaires non officiers. Elle comprend deux corps :
- Celui des gradés des hommes de troupe avec les brigadiers et les brigadiers-chefs
- celui des gradés sous-officiers dans lequel sont classés les maréchaux des logis, maréchaux des logis-chefs, adjudants(1), adjudants-chefs et aspirants.
La hiérarchie des militaires non-officiers de la gendarmerie comprend les grades suivant : gendarme ou garde correspondant au grade de maréchal des logis, maréchal des logis-chef, adjudant et adjudant-chef. Les grades de garde, maréchal des logis-chef, adjudant* et adjudant-chef ne sont utilisés que dans la garde municipale de Paris qui a une organisation régimentaire. La garde municipale de Paris faisant partie intégrante de la gendarmerie, les emplois de sergent, maréchal des logis, sergent-major, maréchal des logis-chef et d'adjudant correspondent à l'emploi de maréchal des logis de la gendarmerie des départements.
Hiérarchie des militaires officiers de l'arme

Ordonnance du 16 mars 1838
Cette ordonnance portant règlement, d'après la hiérarchie militaire des grades et des fonctions, sur la progression de l'avancement et la nomination aux emplois dans les armées, en exécution de la loi du 14 avril 1832 fixe la hiérarchie militaire de la manière suivante : brigadier, sous-officier, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, chef de bataillon ou chef d'escadron ou major, lieutenant-colonel, général de brigade, général de division, maréchal de France. Le grade de lieutenant-colonel est institué à titre définitif.
La hiérarchie du personnel officier(2) en gendarmerie se compose des grades suivants : lieutenant, capitaine, chef d'escadron, lieutenant-colonel et colonel.
(1) Le grade d'adjudant a été institué par le secrétaire d'État à la Guerre, le maréchal Du Muy, dans une ordonnance du 3 octobre 1774 concernant le corps royal d'artillerie. Ils étaient spécialement chargés de veiller à la tenue et à la discipline de leur compagnie. Ils étaient subordonnés aux sous-aides majors. Ils avaient rang de premier sergent major ou de premier maréchal des logis. On ne comptait alors qu'un seul adjudant par chaque régiment d'infanterie, mais une ordonnance de 1784 en créa un par bataillon. Lorsqu'en 1791, les adjudants-majors remplacèrent les aides et sous-aides majors, les adjudants prirent le titre d'adjudant sous-officier. Sous le gouvernement impérial, chaque bataillon eut deux adjudants sous-officiers (Décret de 1806). L'adjudant était le premier sous-officier d'un régiment. Il faisait partie de l'état major. À l'époque de la création de ce grade, il était spécialement chargé de l'examen des sujets propres a remplir les emplois de sergents et de caporaux. Ils passaient lieutenants après dix ans de service en temps de paix et cinq en temps de guerre. Pour se distinguer, les adjudants portaient toujours la canne. Le corps et la tresse de leurs épaulettes étaient mêlés de soie rouge (on retrouve cette particularité dans les galons actuels).
(2) Pour les sous-lieutenants voir l'ordonnance du 2 août 1818.
INSTRUCTION DU 18 AVRIL 1836
Le nouveau règlement sur l'uniforme qui parut le 18 avril 1836 abrogea entièrement celui du 22 septembre 1826. À cette époque, la gendarmerie ne porte pas la moustache et les favoris ne doivent pas dépasser de plus d'un centimètre le bas de l'oreille. Les différentes tenues des officiers, sous-officiers et gendarmes sont au nombre de trois : la petite tenue du matin, la tenue à pied d'été et d'hiver, la tenue à cheval. La tenue d'été se porte ordinairement du 1er mai au 1er octobre.
Dans cette instruction, il fut décidé que les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes à cheval de la compagnie de la Seine feraient usage, au lieu du chapeau des autres compagnies, d'un bonnet à poil, tandis que les brigades à pied porteraient un schako semblable a celui de la 17e légion.
Composition de l'habit
- Un surtout en drap bleu-de-roi, avec collet bleu échancré et retroussis en drap écarlate (les basques sont plus courtes et ne sont plus ornées de fausses poches),
- la culotte chamois est abandonnée au profit d'un pantalon à petit-pont de drap gris-bleu pour l'arme à pied et à cheval ;
- le pantalon de coutil blanc, dit coutil russe, pour la tenue d'été est maintenu.
- manteau et coiffe :
- Pour les officiers, d'un manteau-capote, d'un bonnet de police ;
- Pour les sous-officiers et gendarmes à cheval : d'un manteau-capote à manche et à rotonde, d'un bonnet de police et d'une veste d'écurie;
- Pour les sous-officiers et gendarmes à pied : d'une capote, d'un bonnet de police et d'une veste ronde semblable à celle de la gendarmerie à cheval ; ces effets sont en drap bleu-de-roi.
Particularités
- les boutons portent l'empreinte d'un coq gaulois, avec la légende : Gendarmerie départementale et l'exergue : Sûreté publique,
- le chapeau est bordé d'un galon en poil de chèvre et orné de huit passants en galon d'argent, il diminue de hauteur et la cambrure de sa corne avant est augmentée. Il ne se porte qu'en bataille,
- le bonnet de police dit à la dragonne est du même drap que le surtout. Il doit être placé de façon qu'il penche légèrement à droite (ordonnance du 2 novembre 1833, cavalerie),
- les gants sont en daim jaune,
- les bottes à l'écuyère dites demi-fortes sont équipées d'un porte-éperon pour les cavaliers, pour le service à pied les officiers et sous-officiers font usage de petites bottes sans éperons,
- les sous-officiers et gendarmes à pied sont équipés de deux paires de guêtres courtes (une noire et une blanche).
Distinctions
- L'aiguillette (elle est portée sur l'épaule gauche):
- argent pour les officiers
- 1/3 laine fine bleu-de-roi et 2/3 filet d'argent pour les maréchaux des logis
- 2/3 laine fine bleu-de-roi et 1/3 filet d'argent pour les brigadiers
- fil blanc pour les gendarmes
- les épaulettes :
- Les officiers portent l'épaulette du grade dont ils sont titulaires :
- les colonel, lieutenant-colonel et capitaine portent deux épaulettes à franges à torsades;
- les chefs d'escadron et les lieutenants portent une épaulette à gauche et une contre-épaulette à droite ;
- les sous-lieutenants une épaulette à droite et une contre-épaulette à gauche. Les sous-lieutenants ne peuvent faire usage que de franges en filé, dites graines d'épinard.
- Les officiers portent l'épaulette du grade dont ils sont titulaires :
- Les trèfles : les sous-officiers et gendarmes portent un trèfle sur chaque épaule.
- Les brides ou passants : tous les officiers, sous-officiers et gendarme portent les passants de même dimensions, ils sont argent pour les officiers et en fil blanc pour les gendarmes.
- Les galons :
- pour les maréchaux des logis à pied ou à cheval : deux galons argent cousus en chevron sur l'avant-bras de chaque manche,
- pour les brigadiers : un galon argent cousu en chevron sur l'avant-bras de chaque manche.
- Cordons de sabre (dragonne) : ils sont en buffle pour les officiers et sous-officiers et gendarmes à cheval, en fil blanc pour les sous-officiers et gendarmes à pied.
Buffleterie et giberne
- Les officiers sont pourvus d'un ceinturon à bélières en buffle, et d'un porte-épée.
- Les maréchaux des logis à cheval, d'un ceinturon à bélières et d'un porte-giberne en buffle; d'une giberne à martingale mobile.
- Les brigadiers et gendarmes à cheval d'un ceinturon à bélières et à porte-baïonnette en buffle, d'un porte-giberne et d'une giberne avec martingale mobile, d'une bretelle de mousqueton en buffle, d'un fourreau de baïonnette et d'un couvre-platine.
- Les sous-officiers et gendarmes à pied, d'un baudrier de sabre, d'une banderole de giberne, d'une giberne à martingale fixe, d'une bretelle de mousqueton, en buffle, d'un fourreau de baïonnette et d'une fonte de pistolet avec sa ceinture.
- Les cuirs sont jaunes, bordés de joncs blancs.
Gendarmerie de la Corse
Habillement
Le surtout, le pantalon de drap gris-bleu, le pantalon de coutil blanc, le manteau-capote, la capote, la veste, le bonnet de police, les effets de grand équipement et de petit équipement des sous-officiers et gendarmes de la 17e légion, sont semblables à ceux des autres légions.
Le pantalon de drap gris-bleu des sous-officiers et gendarmes à cheval est garni d'une peau de veau noire, depuis le bas de la jambe jusqu'au genou, en forme de botte, et il a un sous-pied en cuir noir. Les officiers, sous-officiers et gendarmes, sont autorisés à porter, pour le service journalier, le pantalon de coutil de coton bleu, dont les formes et dimensions sont semblables à celles du pantalon de coutil blanc. Les sous-officiers et gendarmes à cheval ne font usage que de petites bottes, portées sous le pantalon.
coiffure
Les sous-officiers et gendarmes font usage d'un schako en carton imperméable, recouvert d'un tissu en peluche de coton noir. La calotte est en cuir de vache noirci et ciré ; son bord est garni, au pourtour supérieur, d'un galon en argent tissu à points de Hongrie, large de 22 millimètres. La visière est en cuir verni noir, et bordé d'un cercle en cuivre doublé argent. La plaque, placée sur le devant, est en cuivre doublé argent ; elle est surmontée d'un coq gaulois entouré de lauriers. L'écusson placé au-dessous porte pour exergue : Sûreté publique, et pour légende ces mots : Gendarmerie départementale. Au-dessus de cette plaque est placée une cocarde en cuir estampé, peinte aux trois couleurs; Les jugulaires sont à seize écailles bombées, en cuivre doublé argent ; elles sont garnies d'une rosace estampée, ornée d'une grenade.
Le couvre-schako est en toile de coton cirée noire.

Règles générales sur le port des armes
- On ne porte jamais d'arme avec le bonnet de police, à l'inverse, le chapeau ne peut jamais être porté sans arme.
- Les officiers de gendarmerie n'ont pas de giberne et portent leur sabre au crochet de leur ceinturon (on dit qu'il est porté en ceinture).
- Les sous-officiers et gendarmes à pied portent le sabre suspendu à un baudrier (on dit qu'il est porté en baudrier).
- Si les brigadiers et gendarmes sont armés du mousqueton, ils portent obligatoirement la giberne.
- Les maréchaux des logis n'ont pas de mousqueton, mais ont une giberne.
- Les gendarmes à cheval portent la giberne et le sabre en ceinture.
- Lorsque les maréchaux des logis et brigadiers ne commandent pas leur troupe, ils peuvent porter l'épée conforme au modèle adopté (instruction du 18 avril 1936).
- Le baudrier (cuir soutenant l'arme, posé sur l'épaule droite) et la banderole (cuir soutenant la giberne, posé sur l'épaule gauche) sont toujours placés sous les trèfles et l'aiguillette.
| Pistolet gendarmerie Mle 1822 | Caractéristiques techniques |
|---|---|
 |
|
| (Col. Musée de la gendarmerie nationale) |

loi du 4 juillet 1837
Avec cette loi, toutes les anciennes dénominations de poids et mesures sont interdites dans les actes publics, affiches et annonces à compter du 1er janvier 1840. Les gendarmes doivent se servir dans leurs procès-verbaux des dénominations établies par la loi du 18 germinal an III.
D.M. du 16 août 1839
L'épaulette de l'adjudant sous-officier de toutes armes sera, en entier, de même métal que celle de l'adjudant-major, avec une seule raie ou bande distinctive, de 10 millimètres de largeur, tissée en soie ponceau dans le corps de l'épaulette. Elles est portée à droite et la contre-épaulette à gauche.

Compagnie de la Seine
Cette compagnie faisait le même travail que les autres compagnies de gendarmerie départementale, mais pour la distinguer, il fut décidé, dans l'instruction du 18 avril 1836, que les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes à cheval de cette compagnie feraient usage, au lieu du chapeau des autres compagnies, d'un bonnet à poil, tandis que les brigades à pied porteraient un schako semblable a celui de la 17e légion.
D.M. du 4 mai 1840
L'arme à cheval de la gendarmerie de la Seine adopte le pantalon de tricot blanc, le bonnet à poil prend une jugulaire en cuir verni et un plumet rouge.
C.M. du 26 septembre 1840
Le shako des hommes à pied est orné de chevrons en galons d'argent séparés par une tresse rouge.
D.M. du 28 mars 1840
Le bonnet de police confectionné en drap bleu à une hauteur de 15 cm. Sa hauteur prise au milieu est portée à 19 cm. Il comporte galon, gland et grenade.

Armement des officiers
L'armement des officiers se compose d'un sabre, d'une paire de pistolets à percussion, d'une épée.
- Le sabre est celui de la cavalerie légère, modèle 1822. Il est à lame évidée légèrement courbe, longue de 920mm. La monture a trois branches ciselées et surdorées, la poignée est noire en peau de chagrin et garnie de filigrane doré. Le fourreau, les bracelets et les anneaux sont en acier poli.
- Les pistolets du modèle 1835 sont des armes à percussion et canon rayé. Ils se chargent à balle forcée sans le secours du maillet. Le modèle a été établi par le lieutenant-colonel de Pontcharra. Ils se fabriquent dans les manufactures royales d'armes.
- À pied et en tenue de société, les officiers portent l'épée à lame ployante modèle 1822. La poignée est en filigrane doré, la coquille est ornée du coq gaulois, la lame, à côte, mesure 805 millimètres de longueur et 25 de largeur au talon, le fourreau est en cuir.
Suivant l'instruction du 18 avril 1836, l'épée et le sabre se fabriquent dans la manufacture de Châtellerault.
Bataillon de Voltigeurs corses
D.M. du 6 août 1840
Le schako en usage dans le bataillon des voltigeurs est remplacé par casquette dite d'Afrique avec les différences suivantes :
- turban et bandeau bleus, impériale vernie blanche (le 6 août suivant, le ministre décidait que l'impériale serait noire),
- couvre-nuque en toile cirée ou imperméable,
- cor de chasse en cuivre jaune.
Gendarmerie de la Corse
L'uniforme de la 17e Légion est semblable à celui des autres légions sauf les points suivants :
- Le pantalon de drap gris-bleu des sous-officiers et gendarmes à cheval est garni d'une peau de veau.
- La coiffure est toujours le shako avec plaque à soubassement : au-dessus le coq entouré de lauriers, dans le soubassement l'inscription : « Sûreté publique - Gendarmerie départementale ». Jugulaire à écailles en cuivre argenté, bourdalou en cuir (velours noir pour les officiers). Galon supérieur en argent (à crête, de dimensions variables ou doubles suivant les grades pour les officiers).
- Le harnachement est identique que précédemment.
C.M. du 28 janvier 1841
Les militaires de tout grade du corps de la gendarmerie doivent à l'avenir porter la moustache. Seuls les officiers généraux et les officiers supérieurs peuvent porter la mouche(1).
(1) suivant une décision ministérielle du 20 mars 1832, les moustaches (du grec μασταξ mustax, poil de la lèvre) et la mouche sont coupées en brosse ; une ordonnance du 2 novembre 1833 interdit de les cirer ou de les graisser.
 |
Bon-Adrien JEANNOT de MONCEY Décès le 20 avril 1842, à Paris, à l'âge de 88.Pair et maréchal de France(1), duc de Conégliano, Grand Croix des ordres de la Légion-d'Honneur, de Saint-Louis et du Saint-Esprit, gouverneur des Invalides, Premier inspecteur général de la gendarmerie nationale. |
(1) Soult, duc de Dalmatie s'éteignit en 1851. Il fut le dernier des maréchaux créés par Napoléon, le 19 mai 1804, le lendemain de la proclamation de l'Empire.
C.M. du 8 juillet 1842 :
La 17e légion adopte le shako de la gendarmerie à pied de la Seine (chevrons en galons d'argent séparés par une tresse rouge).
Augmentation des effectifs pour la gendarmerie
Dans la période de 1792 à 1820, le corps de la gendarmerie reçut une augmentation de 650 brigades à pied et fut porté à un effectif de 15 500 hommes, officiers non compris. Par mesure d'économie, cet effectif fut réduit en 1829 à 12 100 hommes. Dans l'intervalle de 1830 à 1843 fut promulguée la loi du 23 février 1834 qui autorisa un accroissement temporaire de 2 000 gendarmes à pied, spécialement affectés à la police des départements de l'Ouest. Dès 1835, la réduction du nombre de ces brigades eut lieu d'année en année jusqu'en 1840, époque à laquelle elle fut suspendue. En 1843, l'effectif total de l'arme comprenant les brigades temporaires encore existantes était de 13 760 hommes.
La loi du 10 avril 1843 ouvrant un crédit extraordinaire permit le maintien définitif de ces brigades temporaires et l'augmentation de l'effectif de la gendarmerie de 640 maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes, dont 455 à cheval et 185 à pied. La force totale de cette augmentation permit de créer 81 brigades à cheval et 37 à pied. La gendarmerie départementale se composait désormais de 1 950 brigades à cheval (dont 650 de 6 hommes commandées par des maréchaux des logis et 1 300 brigades de 5 hommes commandées par des brigadiers), 800 brigades à pied de 5 hommes (dont 266 commandées par des maréchaux des logis et 534 commandées par des brigadiers ). La force totale était de 2 750 brigades (1950 à cheval et 800 à pied) formant un effectif de 14 400 hommes, non compris les officiers dont le nombre s'élevait à 593.
BATAILLE DE TAGUIN 16 mai 1843 (Algérie).
Bataille inscrite au drapeau de la gendarmerie départementale.
N.Min. du 26 août 1844
Une jugulaire mobile en cuir verni est adaptée au chapeau. Elle est composée de deux parties dont une comporte une boucle. Quatre crochets disposés à l'intérieur au fond du chapeau destinés à recevoir la jugulaire mobile permettent de porter le chapeau en colonne ou en bataille.

Armement de la gendarmerie
Un règlement du 2 février 1845 sur la conservation et l'entretien des armes dans chaque corps, précise l'armement qui est fixé par décision ministérielle pour la gendarmerie.
- Troupe à cheval
- maréchaux des logis : deux pistolets de gendarmerie modèle 1822 transformés, ou modèle 1840 et un sabre de cavalerie de ligne modèle 1822,
- brigadiers et gendarmes : un mousqueton (Mle. 1825) à silex transformé à percussion(1) armé de sa baïonnette, deux pistolets(2) de gendarmerie modèle1822 transformés, ou modèle 1840, un sabre d'infanterie modèle 1831.
- Troupe à pied
- Maréchaux des logis, brigadiers et gendarmes : un mousqueton armé de sa baïonnette comme celui de l'arme à cheval, un pistolet, un sabre d'infanterie modèle 1816 (sabre-briquet),
- voltigeurs corses : un fusil double de voltigeur(3), un sabre d'infanterie modèle 1831.
- Garde municipale
- arme à cheval : comme la gendarmerie à cheval, un seul pistolet,
- arme à pied : un fusil de voltigeur, sabre d'infanterie (modèle 1816).
(1) Le mousqueton a été mis à percussion au cours de l'année 1842. Ses dimensions sont inférieures à celles du fusil, mais il est équipé de la même baïonnette. Son calibre est de 17,6mm. Les mousquetons fabriqués à partir de cette date et directement équipés du système percutant sont tout simplement appelés mousqueton de gendarmerie percutant Mod. 1842.
(2) Le pistolet gendarmerie est identique par ses formes à celui de la cavalerie. Il est cependant plus petit. Son canon de 13cm de longueur est au calibre de 15,2mm et sa balle est au diamètre de 14,7mm.
(3) Le fusil des voltigeurs corses est équipé de deux canons. Ses canons au calibre de 17,5mm tirent la cartouche d'infanterie avec une balle au diamètre de 16,7mm. Il est équipé d'une baïonnette quadrangulaire à douille. Sa baguette de chargement est à tête-de-clou. Par décision ministérielle du 8 mars 1845, cette arme équipera toute la gendarmerie de la Corse à la place du mousqueton jugé arme insuffisante pour le pays. Cette mesure sera étendue le 20 décembre suivant aux compagnies des départements de l'Ille-et-Vilaine, du Finistère et du Morbihan.

Ordonnance du 17 juin 1845
Avec cette ordonnance le roi réorganise le bataillon des voltigeurs corses. Il est formé de volontaires et sert d'auxiliaire à la gendarmerie en Corse. Il ne fait pas partie de l'arme et n'en dépend d'aucune manière. Il est exclusivement soumis à l'autorité militaire. C'est un corps d'infanterie légère, essentiellement mobile qui doit agir dans l'intérêt de la sécurité publique. Il est commandé par un chef de bataillon.
Cette troupe est composée : d'un état- major et d'un petit-état-major, d'une compagnie à cheval et quatre compagnies à pied est à l'effectif de 524 hommes. Lorsque la gendarmerie à besoin de ses services, elle doit s'adresser aux autorités administratives (art. 90 de l'ordonnance du 29 octobre 1820).
Bataillon de Voltigeurs corses
Dans cette ordonnance, l'uniforme du bataillon est ainsi fixé :

- Tunique et caban en drap bleu de roi (fond et passe-poil) ;
- épaulettes en laine verte ;
- shako bleu et galon de même couleur ;
- bonnet de police en drap bleu ;
- brodequins du cuir noir, lacet sur le cou-de-pied ;
- cartouchière en cuir noir ;
- fusil à double canon à percussion et sabre d'infanterie (ancien modèle).
Notification journal militaire du 7 août 1845
À l'issue de cette réorganisation, une notification insérée au journal militaire décrit avec plus de précisions le nouvel uniforme de ce bataillon qui avait été modifié le 13 juillet 1830 avec la suppression de la banderole de giberne et l'adoption du pantalon en coutil blanc pour l'été.
Composition de l'habit
- Une tunique de drap bleu fermant droit sur la poitrine au moyen de 4 agrafes et de 3 brandebourgs en laine bleue et garnis chacun de 2 olives. Collet bleu, parements en drap bleu en pointe, jupe courte à larges plis plats, tous les passepoils sont bleu ;
- épaulettes en laine verte, brides d'épaulettes en drap bleu ;
- pantalon de drap bleu sans bande ni passe poil ;
- shako en cuir léger recouvert d'un manchon en drap bleu garni au sommet d'un galon de laine bleu de 40mm, à la base d'un bourdalou en cuir verni noir de 25mm de largeur, sur le devant une cocarde. Sa jugulaire est en cuir verni noir, et possède un pompon ellipsoïdal bleu. Pour les officiers les tresses et le galon du shako sont en argent ;
- le ceinturon, la cartouchière et le porte-baïonnette sont en cuir noir non verni;
- bonnet de police de la forme d'une casquette en drap bleu à passe poils de drap bleu garni d'une visière cintrée en cuir noir verni. Pour les adjudants, le passepoil en drap bleu qui sépare le bandeau du turban est remplacé par une tresse plate en or. Pour les officiers, le passepoil est remplacé par des tresses en argent en nombre variable suivant le grade ;
- caban en drap bleu de roi à capuchon sans manches se fermant par devant au moyen de 3 brandebourgs ;
- brodequins de cuir noir, lacés sur le cou-de-pied.
Instruction du 21 août 1846
L'instruction sur l'uniforme de la gendarmerie du 21 août 1846 reprend pour l'essentiel l'uniforme décrit dans l'instruction d'avril 1836 en lui apportant l'ensemble des petites modifications qui ont été prescrites au cours de la décennie. Néanmoins, cette circulaire attribue aux officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes une petite tenue pour le service journalier et une grande tenue pour les dimanches et fêtes et les cérémonies publiques.
Désormais, la gendarmerie porte la moustache qui doit couvrir la lèvre supérieure et être coupée en brosse à la commissure des lèvres ; les favoris sont également tenus courts et ne doivent pas dépasser le bas de l'oreille de plus d'un centimètre.
Composition de l'habit
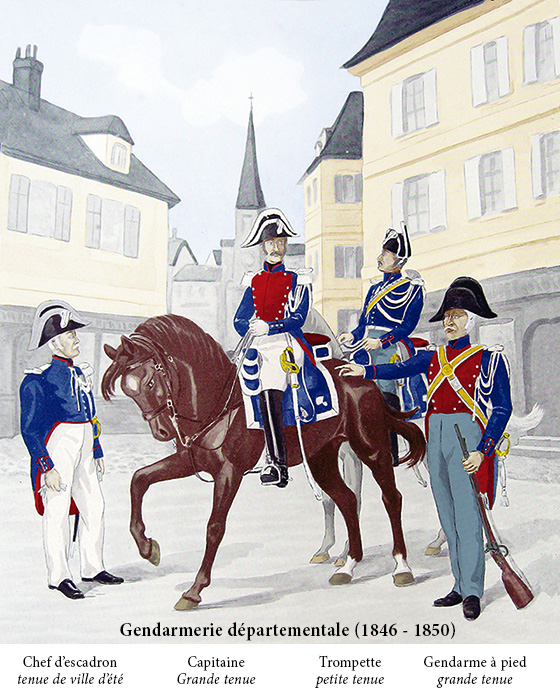
- Petite tenue
- D'un habit en drap bleu de roi, avec retroussis en drap écarlate et fausses poches en travers près de la taille,
- d'un pantalon gris bleu en cuir de laine (tissu croisé), et d'un pantalon de coutil blanc, dit coutil russe, pour la tenue d'été.
- Pour les brigadiers et gendarmes à cheval, d'une veste d'écurie.
- Pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes à pied, d'une capote.
- Pour les brigadiers et gendarmes à pied, d'une veste ronde, semblable à celle de la gendarmerie à cheval.
- Le manteau de la gendarmerie à cheval est à manches et à grand collet.
- Grande tenue
- Un habit avec plastron écarlate(1), et (pour l'arme à cheval seulement) d'un pantalon de tricot blanc.
- Pour les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes à cheval, d'un manteau capote.
Ces effets sont en drap bleu de roi. Les boutons portent l'empreinte d'un coq gaulois avec la légende : Gendarmerie départementale, et l'exergue : Sûreté publique.
Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes portent l'aiguillette sur l'épaule gauche.
- Tenue de société pour les officiers
- Les officiers de tout grade peuvent porter, en tenue de société, le pantalon en casimir blanc, ou le pantalon d'été blanc sur la petite botte.
Les coiffures
- Le chapeau. Il est à nouveau bordé d'un galon en argent de 55 millimètres de hauteur pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, 70 millimètres pour les officiers subalternes et 80 millimètres pour les officiers supérieurs. Il est ajouté au bord du chapeau des officiers de tous grades une double crête de 6 millimètres de hauteur en argent qui n'est point comptée dans la hauteur du galon. Il est muni d'une coiffe en toile vernie en noir à l'extérieur qui l'enveloppe entièrement en s'adapte parfaitement à sa forme pour les jours de pluie (chapeau gendarme à pied ci-dessus).
- Le bonnet de police. Il est en drap bleu de roi et orné de galons en fil blanc et d'un gland attaché sous le turban au moyen d'un cordonnet.
(1) L'ancien habit était à revers rouge. Il était constitué de deux revers rouges fixés à des boutons sur les bords extérieurs de l'habit de part et d'autre de la poitrine et s'agrafaient entre eux par le milieu. Le nouvel habit est boutonné droit sur le devant de la poitrine et le plastron écarlate est fixé par dessus à l'aide de deux rangées de boutons placées de chaque côté de la poitrine.
Armement
- Pour les officiers
- le sabre(1) des officiers de la cavalerie légère modèle 1822. Il est à lame évidée, légèrement courbe, longue de 920 mm. La monture à trois branches ciselées et surdorées, la poignée est noire et garnie de filigrane doré. Le fourreau, les bracelets et les anneaux sont en acier poli.
- Une paire de pistolets modèle 1835 à percussion et canon rayé. Ils se chargent à balle forcée sans le secours du maillet (suivant le modèle réalisé par le colonel de Pontcharra). Ils se fabriquent dans les manufactures d'armes royales.
- Une épée(1) portée à pied et en tenue de société. Elle est à lame ployante, modèle 1822. La poignée est en filigrane doré, la coquille est ornée du coq gaulois, la lame à côte mesure 805mm de longueur et 25 de largeur au talon. Le fourreau est en cuir.
- Pour les sous-officiers et gendarmes à pied
- un mousqueton(2) à percussion Mle 1842 et armé de sa baïonnette, un sabre-briquet du Mle 1816 et un pistolet Mle 1842,
- pour les maréchaux des logis à cheval : un sabre et une paire de pistolets,
- pour les brigadiers et gendarmes à cheval : un sabre, un mousqueton percussion Mle 1842 et armé de sa baïonnette, une paire de pistolets Mle 1842.
Pour la tenue de résidence uniquement, les sous-officiers peuvent porter l'épée conformément au modèle adopté.
(1) Suivant l'instruction du 18 avril 1836, l'épée et le sabre sont fabriqués dans la seule manufacture de Châtellerault.
(2) Le mousqueton Mle 1842 était fabriqué avec le système de mise à feu par percussion ; pour le mousqueton Mle 1825 modifié 1842, la modification consistait à remplacer le système de mise à feu à silex par un système à percussion ; pour le mousqueton modèle 1825 modifié 1842 bis, la modification portait sur le changement de la platine (silex en percussion) et à réaliser des rayures dans les canons lisses.
Compagnie de la Seine
Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes à cheval de la compagnie de la Seine font usage d'un bonnet à poil. Il est orné à son sommet d'une grenade en cuivre plaqué argent à 11 flammes sur un rond en drap rouge, d'un pompon demi-sphérique recouvert d'une cocarde tricolore ou d'un plumet droit pour la grande tenue, écarlate pour les officiers subalternes, sous-officiers brigadiers et gendarmes, tricolore pour les chefs d'escadron commandant les compagnies. Le colonel porte seul une aigrette en plumes de héron blanc.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes à pied portent un shako recouvert d'un tissu de soie noire. Il est orné de deux galons formant chevron en argent séparés par une tresse rouge.
Pour toute la gendarmerie
Tenue
Le col de l'habit est noir, les gants sont jaunes, les bottes sont demi-fortes, les petites bottes sont portées sous le pantalon pour le service à pied.
Équipement
Les gibernes des deux armes deviennent plus petites et une pochette en peau de mouton destinée à contenir les capsules nécessitées par l'armement à percussion est adaptée à la banderole porte-giberne au milieu de la poitrine.
La capote est portée sur le sac par les fantassins, enfermée dans un étui en fil bleu et blanc dit à mille raies. Les fontes de selle ont été remplacées par des sacoches toujours recouvertes de trois chaperons.
Armement
- Officiers : sabre et pistolet,
- Sous-officiers, brigadiers et gendarmes à pied : mousqueton Mle 1825, transformé à percussion, avec baïonnette, sabre-briquet et un pistolet.
- Gendarmerie à cheval : maréchaux des logis, sabre et deux pistolets ; brigadiers et gendarmes à cheval : idem, plus mousqueton et baïonnette comme ci-dessus.
| Mousqueton d'essai gendarmerie Mle 1825 T | Caractéristiques techniques |
|---|---|
 |
|
| La version définitive a été mise en service dans la gendarmerie à compter de 1826. | (Col. Musée de la gendarmerie nationale) |
![]() Au 1er janvier 1847, la force des 26 légions de gendarmerie était de 615 officiers dont 19 colonels et 7 lieutenants-colonels chefs de légions et 15090 sous-officiers, brigadiers et gendarmes.
Au 1er janvier 1847, la force des 26 légions de gendarmerie était de 615 officiers dont 19 colonels et 7 lieutenants-colonels chefs de légions et 15090 sous-officiers, brigadiers et gendarmes.
DEUXIÈME RÉPUBLIQUE
(24/02/1848 - 02/12/1852)
Lorsque la deuxième république s'installa, la gendarmerie se composait :

- de 26 légions de gendarmerie :
- 25 pour le service des départements de la métropole,
- 1 légion pour le département de l'Algérie à quatre compagnies (Alger, Blidah, Constantine et Oran),
- De la gendarmerie coloniale :
- 3 compagnies (Martinique, Guadeloupe, La Réunion),
- 1 demi-compagnie en Guyane,
- 2 détachements (Océanie et Saint-Pierre et Miquelon),
- de deux bataillons de gendarmerie mobile casernés à Paris,
- de la garde républicaine, chargée du service spécial de la ville de Paris comprenant :
- deux bataillons d'infanterie,
- deux escadrons de cavalerie,
- de 2 compagnies d'infanterie auxiliaires de la gendarmerie d'Afrique, sous la dénomination de voltigeurs algériens,
- de 5 compagnies de gendarmerie maritime (Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon).
- de deux compagnies de gendarmes vétérans à Riom (Puy-de-Dôme),
La deuxième république sera à l'origine de la création d'emplois d'adjudants et de maréchaux des logis-chefs dans la gendarmerie départementale.
Officiers généraux
Par décret du 28 février 1848, le gouvernement provisoire de la République française rétablit dans l'armée les titres de général de brigade et de général de division.
![]() Par circulaire ministérielle du 27 octobre 1848, le ministre de la guerre impose aux militaires de tout grade de la gendarmerie de porter la mouche.
Par circulaire ministérielle du 27 octobre 1848, le ministre de la guerre impose aux militaires de tout grade de la gendarmerie de porter la mouche.
DÉCISION DU 25 OCTOBRE 1849
Voltigeurs corses
Cette décision décrit l'uniforme du bataillon de voltigeurs corses(1) et des compagnies de voltigeurs algériens. À quelques points de détails près, ces unités sont habillées et équipées de la même manière.
Tenue
- Tunique en drap bleu foncé passepoilé en drap de même nature. Elle est coupée droit sur la poitrine et ferme par une rangée de neuf boutons d'uniforme. Le collet en drap du fond est échancré par devant. Les parements en pointe du même drap que le fond sont passepoilés en bleu et ferment par deux petits boutons d'uniforme. Les brides en drap bleu sont passepoilées de la même façon. Les boutons sont en argent demi-bombés. Les brides des tuniques des adjudants sont en galon d'or partagées au milieu par une raie ponceau. La tunique des officiers est plus courte.
- Le caban est en drap bleu foncé à capuchon, sans manche. Il ferme au moyen de trois brandebourgs à noeuds hongrois en lacet bleu foncé.
- Le pantalon en cuir de laine gris-bleu sans passepoil avec ceinture en drap est à brayette. Pour la tenue d'été, le pantalon est en coutil bleu de même nuance que le pantalon de cuir.
- La veste ronde est de même forme et dimensions que celle de la gendarmerie.
Distinctions
- Les épaulettes des officiers ont un corps à écusson en galon d'argent, franges à petites torsades mates pour les officiers subalternes et à grosses torsades pour les chefs de bataillon,
- les adjudants ont une épaulette en or sur l'épaule droite et une contre-épaulette sur l'autre ; la troupe a des épaulettes en laine vert foncé.
- Galons de grade :
- caporal : deux galons parallèles en laine jonquille cul de dé de 22mm placés sur chaque avant-bras,
- sergent : un seul galon en argent à lézarde de 22mm placés sur chaque avant-bras,
- sergent-major : deux galons parallèles en argent à lézarde de 22mm placés sur chaque avant-bras,
- chevrons d'ancienneté : en argent cul de dé de 22mm pour les sous-officiers, en laine cul de dé écarlate pour les caporaux et soldats. Ils se posent sur le haut du bras gauche seulement (1 chevron : 5 ans ; 2 chevrons : 10 ans ; 3 chevrons : 15 ans),
- clairon : un galon en laine à losanges tricolores autour du collet.
Coiffures
- Shako en cuir avec manchon de drap bleu foncé orné au sommet d'un galon laine bleue de 20mm. Il est orné d'une cocarde, d'un pompon de forme ellipsoïde bleu. Sa jugulaire de 20mm de large est en cuir verni noir. Il est complété par un couvre-shako en toile vernie en noir d'un seul côté.
- Le bonnet de police à visière est en drap pareil à la tunique orné sur toutes les coutures d'un passepoil bleu. La visière inclinée de 25° est en cuir verni noir. Le bonnet de police des adjudants est identique à celui des caporaux et voltigeurs excepté le passepoil bleu séparant le bandeau du turban qui est remplacé par une tresse couleur or. Cette tresse est couleur argent pour les sous-lieutenants et leur nombre varie suivant le grade (lieutenant : 2, capitaine : 3, chef de bataillon : 4).
Équipement, Armement
- Banderole, baudrier et ceinturon de giberne, brodequins à clous en cuir noir.
- Fusil de dragon transformé à percussion, baïonnette d'infanterie et sabre d'infanterie Mle 1831.
(1) On pense que les voltigeurs corses n'en furent jamais vêtus puisque cette formation était supprimée 6 mois plus tard par décret du 23 avril 1850.

Circulaire du 21 décembre 1849
Le ministre de la guerre prescrit aux commandants de légion de gendarmerie le dépôt dans toutes les brigades d'un ouvrage intitulé « Mémorial de la gendarmerie » publié par le chef d'escadron Cochet de Savigny. Il vient en complément du « Dictionnaire de la Gendarmerie ».

Décret du 23 avril 1850
Suppression du bataillon de voltigeurs corses et création d'un bataillon de gendarmerie mobile.
Par décret du 23 avril 1850, le bataillon de voltigeurs corses est supprimé. Cette formation n'ayant pas suffisamment démontrée son efficacité pour réprimer les crimes et les délits qui se multipliaient dans l'île, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République le supprima et le remplaça par un bataillon de gendarmerie mobile. Destiné à opérer sur tous les points de la Corse, l'effectif de ce bataillon fut fixé à 419 militaires répartis en quatre compagnies. Il était placé sous les ordres et dans les attributions du chef de la 17e légion de gendarmerie. Ce bataillon recevait l'uniforme de la gendarmerie à pied de la Corse.
DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 8 AOÛT 1850
Cette décision apporte des modifications à l'instruction du 21 août 1846
Compagnie de la Seine
Le shako
La carcasse du shako en cuir verni mesure 170 mm devant, et 200 mm derrière. Son calot est en cuir verni noir. Sa visière inclinée de 25° vers le bas est vernie en noir au-dessus et en vert au-dessous. Elle est ornée d'un jonc sur son pourtour. Le bourdalou en cuir verni noir mesure 25 mm de hauteur. Le manchon ou turban est en drap bleu. Le pourtour supérieur en galon d'argent, tissé à point de Hongrie de 21 mm de largeur.
Deux galons formant chevrons en argent à point de Hongrie avec tresse rouge tissée au milieu, sont placés sur chaque côté. À l'extrémité inférieure des chevrons, deux rosaces à grenades estampées servent à retenir une chaînette argentée en forme de gourmette, qui est placée au-dessus de la visière. Une cocarde aux couleurs nationales est placée au sommet. Une plaque argentée figurant un coq gaulois placé sur une double branche de chêne et de laurier et sur une bombe au centre de laquelle sont écrits les mots : Gendarmerie de la Seine.
Le shako est équipé d'un gousset porte-pompon, de ventouses en tête d'arrosoir, d'une mentonnière en cuir verni noir. Le pompon en laine écarlate a une hauteur de 100 mm. Le couvre-shako en toile vernie noir porte peint en blanc les mots : Gendarmerie de la Seine avec une guirlande de laurier et de chêne en dessous.
Accessoires
Les gants sans parements sont identiques pour les officiers, sous-officiers et gendarmes, ils sont en mouton entretenus blanc et de forme dite amandis. Les guêtres en étamine noires et celles en coutil blanc sont supprimées pour la gendarmerie à pied qui portera désormais les petites bottes.
Gendarmerie de la Corse
Coiffures
Les gendarmes de la Corse ont un shako semblable à celui de la compagnie de la Seine.

Ils sont dotés du bonnet de police à visière (c'est la première introduction du képi dans la gendarmerie après l'Afrique). Il mesure 120 mm devant et 160 mm derrière. Ce dernier est constitué d'un bandeau, turban et calot en drap bleu foncé. Les coutures sont ornées d'une ganse en fil blanc, un galon de fil blanc en points de Hongrie de 13 mm entoure la partie supérieure du bandeau (il sera le signe distinctif de la gendarmerie). Il porte sur le devant une grenade brodée en fil blanc et ceux des officiers portent des tresses indiquant leur grade. La visière en cuir noir est de même coupe et dimensions que pour le shako.Pour les sous-officiers et brigadiers, le galon et la grenade sont en argent, le centre de la bombe de la grenade est en laine bleue, la ganse est mélangée de 2/3 d'argent et 1/3 de laine bleue. Pour les adjudants la tresse du bandeau est en or. Pour les officiers, le nombre de tresses qui surmonte le bandeau varie en fonction du grade.
Accessoires
Les boutons de l'habit, du manteau, de la capote et de la veste sont en argent. Ils portent l'empreinte du coq gaulois avec les mots : Gendarmerie de la Corse et l'exergue : Sûreté publique.
Les brodequins à tige et à clous font leurs apparitions dans la gendarmerie.
Gendarmerie des départements
Habit
Le pantalon en cuir de laine gris-bleu est à brayette. Elle se ferme à l'aide de quatre boutons. La ceinture est fermée sur le devant par deux boutons. Deux petites pattes martingales sont fixées derrière le pantalon. Le pantalon en coutil blanc pour l'arme à cheval et à pied est confectionné sur le même modèle que le précédent.
Le 17 juin 1851, le pantalon gris-bleu est supprimé et remplacé au fur et à mesure des réformes par un pantalon en cuir de laine bleu clair. Ce bleu sera désigné sous le nom de bleu gendarme.
Suppression du bataillon de gendarmerie mobile de la Corse

Décret du 24 octobre 1851
Le bataillon de gendarmerie mobile de la Corse créé par décret du 23 avril 1850 est supprimé. Les officiers, sous-officiers brigadiers et gendarmes sont versés dans la 17e légion de l'arme. Avec l'accroissement d'effectif que subit cette légion et par suite de la suppression du bataillon mobile, un second décret du même jour réorganise la légion. Commandée par un colonel, elle est désormais subdivisée en quatre compagnies ayant pour chef-lieu : Bastia, Corte, Ajaccio et Sartene. Une partie des hommes venant du bataillon mobile renforce les brigades dont l'effectif est porté de sept à dix hommes. Les hommes non affectés sont constitués en quatre détachements de force supplétive, stationnant au chef-lieu de chaque compagnie. Commandés par un lieutenant, ces détachements sont destinés à être portés, en totalité ou en partie sur les points où leur concours peut devenir nécessaire.
Les accroissements successifs qu'a reçus le corps de la gendarmerie au cours des années précédentes avaient fait reconnaître la nécessité de modifier son organisation hiérarchique. La gendarmerie ne compte alors que deux grades pour les sous-officiers : brigadier et maréchal des logis(1). Les brigades sont regroupées en lieutenance et commandées par un maréchal des logis de l'arme ou un lieutenant d'un autre corps d'armée. Ces lieutenances sont à leur tour regroupées en compagnie (ressort territorial : le département) commandées par un capitaine.
On compte 425 lieutenances et autant de compagnies que de départements. L'augmentation du nombre des brigades porte en moyenne à 240 sous-officiers et gendarmes l'effectif de chaque compagnie. Dans le but de mettre mieux en rapport la hiérarchie de l'arme avec ses effectifs et de se rapprocher de l'évolution en la matière des autres armes notamment de la cavalerie, Louis Napoléon Bonaparte par un décret du 22 décembre 1851 modifiera son organisation.
(1) Ordonnance du 16 mars 1836 Titre XIV.
Création d'emplois de maréchal des logis-chef et d'adjudant

décret organique du 22 décembre 1851
Avec ce décret, des emplois d'adjudants(1) et de maréchaux des logis-chefs sont créés en gendarmerie. Ce texte augmente de 48 chefs d'escadron et de 125 capitaines le nombre d'officiers et diminue d'un nombre égal le nombre de lieutenants. Sont ainsi créés :
- 26 emplois d'adjudants à cheval commandants de brigades pour être placés au chef lieu de chaque légion,
- 65 emplois de maréchaux des logis-chefs à cheval devant commander la première brigade à cheval du chef-lieu de chacune des autres compagnies,
- 2 emplois de maréchaux des logis-chefs à pied,
- 93 emplois de maréchaux des logis adjoints aux trésoriers.
(1) Ce mot dérive du latin «adjuvare » qui signifie aider, seconder. Les adjudants considérés dans leur grade actuel, c'est-à-dire comme sous-officiers, ont été institués dans l'état-major des corps d'infanterie française par l'ordonnance du 25 mars 1776. Ils étaient choisis parmi les fourriers, car le grade de sergent-major n'existait pas. Avant cela, le terme d'adjudant désignait un grade d'officier aidant en quelques fonctions (ex. : adjudant-major pour aide de camp de l'officier qui commande une formation; l'adjudant-général puis adjudant-commandant, terme employé pour désigner le chef d'état-major ).
Pour les différencier des adjudants-sous-lieutenants qui étaient les aides de camp des colonels, les ordonnances les désigneront d'abord sous le terme d'adjudant-sous-officier puis simplement sous celui d'adjudant. Le règlement du 24 juillet 1816 les appelait adjudants-sous-officiers, l'ordonnance du 13 mai 1818 les appelait adjudants. Originairement, il n'y avait qu'un adjudant par régiment. Le ministre Ségur, en 1784, en créa un par bataillon. À compter de 1808, leur nombre augmenta peu à peu.
Les adjudants prirent rang de premier sous-officier. Le règlement du 1er janvier 1791 et le décret du 12 août 1793 les maintenaient dans ce droit. L'ordonnance du 13 mai 1818 leur assignait des fonctions précises.
Effectif de l'arme
Avec le décret du 22 décembre 1851, Louis-Napoléon créait dans la gendarmerie départementale des emplois d'adjudant et de maréchal des logis-chef que l'organisation de cette arme n'avait pas permis de créer jusqu'alors. Les emplois d'adjudant étant réservé pour l'arme à cheval, il précisa dans un décret du 19 février 1852 la manière dont seraient organisées ces créations afin qu'elles correspondent au mieux avec celle des autres corps de l'armée. La gendarmerie départementale comptait à cette date 635 officiers, 2 452 sous-officiers et brigadiers à cheval et 1 230 sous-officiers et brigadiers à pied. À ces créations il rajouta celles de deux maîtres armuriers affectés aux deux bataillons de gendarmerie mobile.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 11 JUIN 1851
À la suite de l'inspection générale de 1850, diverses propositions relatives à l'uniforme des bataillons mobiles, de la garde républicaine et des corps de la gendarmerie ont été soumises au ministre qui en a aprouvé quelques-unes.
- le pantalon de cuir de laine gris-bleu est remplacé par un pantalon de même étoffe bleu-clair.
Gendarmerie de la Corse
- la capote des sous-officiers, brigadiers et gendarmes des deux compagnies de la Corse et du bataillon mobile employé dans l'île est remplacée par le caban,
- le pistolet est retiré aux sous-officiers et gendarmes à pied de la Corse et des compagnies départementales et sont armés de fusils doubles à percussion.
 Décret du 22 janvier 1852 - Création de la Médaille militaire en faveur des soldats et sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de mer.
Décret du 22 janvier 1852 - Création de la Médaille militaire en faveur des soldats et sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de mer.

Décret du 29 février 1852
Les compagnies de gendarmerie départementale (ressort : le département) commandées par un officier du grade de capitaine seront à l'avenir commandées par des chefs d'escadron. Le commandement des lieutenances du chef-lieu des compagnies à la tête desquelles est placé un chef d'escadron sera confié à un officier du grade de capitaine.

Décret du 22 mars 1852
127 lieutenances de gendarmerie seront commandées à l'avenir par un officier du grade de capitaine. Huit seront divisées en deux sections dont la seconde sera commandée par un lieutenant ou sous-lieutenant.
D.M. du 15 avril 1852
Les boutons d'uniforme sont ornés d'une aigle aux ailes déployées portant en exergue : Sûreté publique, avec les mots Gendarmerie départementale.
D.M. du 22 mai 1852
Le coq est remplacé par l'aigle sur la plaque de shako de la compagnie de la Seine et des compagnies de la Corse, la plaque de ceinturon et de baudrier du sabre, les coulants de ferrets d'aiguillettes, l'épée des officiers et celle des sous-officiers et brigadiers.
CIRCULAIRE DU 12 JUILLET 1852
Cette circulaire a pour objet de fixer la tenue des adjudants sous-officiers, des maréchaux des logis-chefs et des maréchaux des logis adjoints aux trésoriers dont les emplois ont été créés par décrets des 22 décembre 1851 et 19 février 1852.
- Adjudants sous-officiers
- épaulette en or à franges sur l'épaule droite, contre-épaulette sur l'épaule gauche des mêmes dimensions et formes que celle des lieutenants, mais la frange est à graine et non à petites torsades. Le corps de l'épaulette et de la contre-épaulette est traversé dans toute leur longueur d'un liseré de 10mm en soie ponceau ; aiguillette en filet d'argent portée à droite ; brides d'épaulettes en or partagées au milieu par une raie de soie ponceau.
- Maréchaux des logis-chef
- même tenue que les maréchaux des logis, avec un troisième galon en argent au-dessus des deux autres.
- Maréchaux des logis adjoints aux trésoriers :
- tenue identique à celle des autres maréchaux des logis.
LE SECOND EMPIRE
(03/12/1852 - 04/09/1870)

En 1853, la gendarmerie de France se compose :
- de 26 légions pour le service des départements et de l'Algérie,
- de la gendarmerie coloniale composée de quatre compagnies pour la Martinique, la Guadeloupe, l'île de la Réunion et la Guyane française,
- un poste de trois brigades aux îles Saint-Pierre et Miquelon,
- de deux bataillons de gendarmerie d'élite,
- de la garde de Paris chargée du service spécial de la ville de Paris,
- de deux compagnies de gendarmes vétérans.
Par lettre ministérielle du 1er février 1853, le maréchal de France De Saint-Arnaud, ministre secrétaire d'État de la Guerre, crée un service médical pour la gendarmerie. Dans chacune des places de garnison où se trouvent des médecins militaires, l'un d'eux ou plusieurs s'il y a opportunité sont désignés par le général commandant la division pour donner gratuitement et à domicile les soins médicaux nécessaires non seulement aux gendarmes employés dans ladite place, mais encore à leur famille.
C'est par touches successives que l'uniforme de la gendarmerie sera modifié au début du Second Empire. Il faudra attendre la décision impériale du 17 septembre 1853 pour que la gendarmerie (y compris de Corse et d'Algérie) prenne le nom de «gendarmerie impériale» et cependant, dès le 5 avril 1853, l'emblème de l'aigle français était placé sur les poignées d'épées, les plaques de ceinturon et de baudrier, les boutons, les coulants de ferrets, les plaques de bonnet à poils et de shako, les coquilles d'épées.
C.M. du 18 février 1854
Les boutons, plaques de ceinturon et de baudrier des légions de gendarmerie (y compris la Corse et l'Algérie), ainsi que les plaques de shakos en usage dans les compagnies de la Seine et de la Corse reçoivent l'exergue « gendarmerie impériale».

Décret impérial du 1er mars 1854
Ce décret portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, fait la synthèse de tous les textes parus depuis la loi du 28 germinal An IV. Le corps de la gendarmerie se compose :
- de 26 légions pour le service des départements et de l'Algérie,
- de la gendarmerie coloniale,
- de deux bataillons de gendarmerie d'élite, (ces deux bataillons sont supprimés et remplacés par le régiment de gendarmerie de la garde impériale)
- de la garde de Paris chargée du service spécial de la ville de Paris,
- d'une compagnie de gendarmes vétérans.
Hiérarchie militaire dans la gendarmerie des départements, de l'Algérie et des colonies

Décret impérial du 1er mars 1854
Ce décret fixe la hiérarchie militaire dans la gendarmerie de la façon suivante :
- Militaires de rang
- brigadier ( commandant de brigade, secrétaire du chef de légion),
- Sous-officiers
- maréchal des logis et maréchal des logis-chef (commandant de brigade, adjoint au trésorier),
- adjudant,
- Officiers
- sous-lieutenant(1), lieutenant (commandant d'arrondissement, trésorier)
- capitaine (commandant d'arrondissement, trésorier, commandant de compagnie)
- chef d'escadron ( commandant des compagnies ),
- lieutenant-colonel et de colonel ( commandant de légion ).
(1)L'organisation de la gendarmerie ne comporte pas d'emplois de sous-lieutenant. Les sous-officiers de l'arme à pied ou à cheval promus au grade de lieutenant n'ont d'abord que le grade de sous-lieutenant et sont promus à celui de lieutenant après 2 ans d'exercice dans leurs fonctions.

Décret impérial du 1er mars 1854
Art. 238 : les officiers de gendarmerie de tout grade sont officiers de police judiciaire, ils sont considérés comme auxiliaires du procureur impérial dans l'arrondissement où ils exercent habituellement leurs fonctions.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 8 MAI 1854
Gendarmerie des départements
Reprenant les décisions du 31 janvier et 3 avril 1854, cette décision apporte quelques modifications à l'instruction du 21 août 1846.

Habit
- Le pantalon de tricot blanc porté à cheval est confectionné à braguette,
- pour le service à cheval on crée un pantalon demi-collant en cuir de laine bleu clair dit à la hongroise en usage dans la garde de Paris,
- le pantalon long en drap bleu de l'arme à cheval n'est plus porté que dans le service à pied et avec les petites bottes,
- le pantalon d'écurie en treillis de coutil de la même forme que le pantalon de coutil blanc est mis en place pour économiser le pantalon de drap,
Coiffe
- le bonnet de police à visière est remplacé par celui adopté pour les bataillons de gendarmerie d'élite (dit képy (avec un "y")),
- le chapeau conserve les dimensions du précédent sauf un allongement de deux centimètres de ses ailes.
Accessoires
- Les bretelles de fusil, les bélières et la dragonne de sabre sont désormais blanches.
- l'aiguillette est désormais portée à gauche pour tous les grades et dans tous les corps de la gendarmerie,
- la fonte de pistolet de l'arme à pied est supprimée et le portefeuille de correspondance est modifié pour le recevoir,
- pour un grand nombre de services à pied, les cavaliers ne prendront plus le sabre et porteront la baïonnette fixée au ceinturon, porté à la ceinture sans les bélières.
- la giberne de l'arme à cheval est modifiée pour recevoir les cartouches et le nécessaire de l'arme,
- un des pistolets de l'arme à cheval est supprimé et la sacoche dans laquelle il était transporté reçoit les effets de pansage,
- les brigadiers des deux armes portent les marques distinctives de leur grade sur les manches de la veste.
- Les étriers et éperons en fer demi-poli se substituent à ceux en fer verni voir.

Décret impérial du 12 août 1854
Deux décrets de 1852 et 1853 avaient affecté 24 brigades à cheval au service de surveillance des forêts comprises dans le domaine de la couronne. Ces brigades sont supprimées par décret du 12 août 1854 et ses effectifs regroupés pour former un escadron de la gendarmerie à cheval pour ce service. Cette nouvelle unité fut intégrée à la Garde impériale. Elle sera désignée sous le nom de : escadron de gendarmerie à cheval de la garde impériale. Son uniforme ne sera réglementé qu'au printemps suivant. Commandé par un chef d'escadron, cet escadron est composé de 5 officiers, 11 sous-officiers, 16 brigadiers, 101 gendarmes, 2 trompettes et 2 enfants de troupe.
SIÈGE DE SÉBASTOPOL 9 octobre 1854 au 11 septembre 1855 (Crimée).
Bataille inscrite au drapeau de la gendarmerie départementale.
Escadron de gendarmerie
de la garde impériale
INSTRUCTION DU 2 MARS 1855
Composition de l'habit
L'uniforme de l'escadron de gendarmerie à cheval est semblable à celui porté dans la compagnie de gendarmerie de la Seine sauf les modifications suivantes :
-Le collet de l'habit s'orne de deux grenades à 12 flammes (fil blanc pour les gendarmes, filé d'argent pour les brigadiers et sous-officiers, cannetille pour les officiers,
- les boutons avec l'aigle couronnée porte la légende Garde impériale et au bas Gendarmerie.

- Grande tenue
- à cheval : pantalon de tricot blanc à brayette (art 50 et suivant de l'instruction du 21 août 1846).
- à pied : pantalon bleu clair garni d'une bande bleu de roi (première apparition de la bande de pantalon en gendarmerie) (art 29 de l'instruction du 21 août 1846 et décision du 11 juin 1851).
- Petite tenue à cheval
- pantalon demi-collant à la hongroise en cuir de laine bleu clair sans bande (art 16 et suivant de la description du 25 oct 1849).
distinction
- Épaulette à frange : les gendarmes de cet escadron ne portent pas les trèfles, mais les épaulettes,
- en laine blanche avec franges en fil retord pour les gendarmes,
- en mélange de laine bleue et argent pour les gradés,
- laine écarlate et d'argent pour les trompettes,
- les aiguillettes identiques à celle de la gendarmerie départementale sont portées sur l'épaule droite.
Coiffures
- Bonnet à poil comme celui du régiment à pied, mais sans calot ni cordon, jugulaire formée d'anneaux de cuivre, plumet du modèle des régiments à pied de la garde impériale.
- Chapeau avec ganse, soutaches et pompon comme dans les régiments à pied.
- Bonnet de police en drap bleu du modèle décrit dans l'instruction du 21 août 1846.
Accessoires
- Gants à la crispin.
- Plaque de ceinturon et bouton avec l'aigle couronné et la légende « Garde impériale Gendarmerie ».
- Le harnachement est identique à celui de la gendarmerie des départements, mais la housse est ornée aux coins postérieurs, d'un « N » couronné, brodé en fil blanc.
- Muserolle du licol orné d'une couronne en cuivre ; sur le rond du poitrail, un écusson en cuivre avec l'aigle couronné. Grenade en cuivre à la fourche de la croupière.
Armement
- Maréchaux des logis à cheval : sabre d'infanterie légère Mle 1822, le pistolet de cavalerie.
- Gendarmes et trompettes : mousqueton gendarmerie Mle 1854, pistolet de gendarmerie, sabre de cavalerie légère.


création d'élèves gendarmes dans la gendarmerie départementale

Décret impérial du 10 octobre 1855
Ce décret autorise la création dans la gendarmerie départementale d'élèves gendarmes. Ces élèves, pris dans les corps d'infanterie et de cavalerie de l'armée, doivent avoir au moins vingt-trois ans d'âge, dix-huit mois de service, et remplir, sous le rapport de l'instruction, de la conduite et de la taille, les conditions exigées par le décret du 1er mars 1854, sur l'organisation de la gendarmerie.
Modèles d'armes destinées aux officiers de gendarmerie

Note ministérielle du 20 janvier 1857
Avec cette note, le ministre de la guerre arrête les modèles d'armes destinées aux officiers de gendarmerie.
- Le sabre d'officier de cavalerie légère Mle. 1822
- L'épée d'officier supérieur de gendarmerie Mle. 1855 :
- lame de 815mm, deux pans creux sur chaque face depuis le talon jusqu'au milieu de la longueur ; poignée en corne de buffle ornée d'un filigrane doré, le pommeau, la garde et la demi-coquille sont ornés ; fourreau en cuir, chape et bout en laiton ; cravate en drap rouge.
- L'épée d'officier de gendarmerie Mle. 1855 :
- semblable à la précédente, mais monture en laiton doré imitant le filigrane des poignées ordinaires ; garde et pommeau en laiton doré ; aigle impérial en relief sur la demi-coquille fixe ;fourreau en cuir, chape et bout en laiton.
- Une paire de pistolets d'officiers de gendarmerie Mle. 1836 :
- canon à cinq pans courts, trente-six rayures, guidon en fer ; culasse à chambre cylindrique, capucine reliée à l'écusson ; monture ronde ; platine du système dit en arrière.
INSTRUCTION DU 20 OCTOBRE 1857
Ce règlement demeure un texte important, car il est le premier à regrouper dans un seul document la tenue et les accessoires vestimentaires de toutes les subdivisions de l'arme. Il résume l'ensemble des modifications effectuées depuis l'instruction du 21 août 1846 et en apporte quelques nouvelles.
La gendarmerie porte la moustache et la mouche. La longueur de l'une et l'autre devant être maintenue dans des limites raisonnables. Les boutons portent l'empreinte d'un aigle avec la légende « Gendarmerie impériale » et l'exergue « sûreté publique ».
Gendarmerie des départements
Composition de l'habit

- Petite tenue
- habit de drap bleu de roi avec retroussis en drap écarlate fermé par neuf gros boutons d'uniforme, pattes horizontales figurant les poches,
- pantalon bleu clair en cuir de laine,
- pantalon de coutil blanc (dit coutil russe) pour la tenue d'été,
- pour les cavaliers : un pantalon demi-collant en drap bleu clair (dit hongroise) qui s'arrête à la cheville, ouvert dans le bas sur les côtés et se ferme par deux cordons de fil noir,
- aiguillettes sur l'épaule gauche et trèfles,
- chapeau identique à celui de la grande tenue.
- Grande tenue
- habit de drap bleu de roi avec retroussis en drap écarlate, collet et parements bleus, pattes horizontales figurant les poches et le plastron en drap écarlate,
- pantalon de tricot blanc double,
- un manteau capote et un pantalon de tricot blanc pour l'arme à cheval,
- une veste en drap bleu pour les brigadiers et gendarmes à pied et à cheval,
- une capote à deux rangs de boutons et à col droit pour les brigadiers et gendarme à pied,
- chapeau orné d'une ganse et bordé d'un galon d'argent,
- aiguillettes sur l'épaule gauche et trèfles en fil blanc,
- buffleterie jaune, piquée à jonc de 5 mm,
- bottes dites demi-fortes pour la cavalerie, petites bottes pour l'infanterie.
Accessoire
Un pantalon d'écurie en treillis pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes à cheval.
Coiffes

- Le chapeau avec sa cocarde bleu blanc rouge est identique au précédent. Il est pourvu d'une mentonnière mobile en cuirverni noir et d'une coiffe noire en vernis noir pour la pluie.
- Un bonnet de police à visière dit Képy en drap bleu clair et bandeau en drap bleu foncé d'une hauteur de 100mm devant et 140mm à l'arrière.
Rien de changé dans la distinction des grades, mais le système permettant d'agrafer les épaulettes des officiers est modifié.
Compagnie de la Seine
La grande et la petite tenue sont semblables à celles des départements sauf les exceptions ci-après :
- Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes à cheval de la compagnie de la Seine continus de faire usage du bonnet à poil. Il est orné d'un plumet écarlate droit pour la grande tenue (tricolore pour les chefs d'escadron, aigrette blanche pour le colonel).
- Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes à pied portent le shako.
- En petite tenue les sous-officiers et brigadiers font usage d'un chapeau du modèle adopté pour la gendarmerie de la garde impériale sans sous-tache ni pompon.
- L'habit de grande tenue se porte avec le plastron écarlate.


Gendarmerie de la Corse
Les gendarmes de la 17e légion n'ont pas la hongroise mais toujours le pantalon de drap bleu clair garni au-dessous du genou d'une fausse botte en peau de veau noir qui se porte par-dessus la petite botte. Le caban qui tient lieu de capote est sans manche en drap bleu foncé et confectionné de telle manière qu'il puisse être porté par dessus le sac. Il se ferme sur le devant par trois branches avec tresse et olives. La coiffure, les brodequins et le harnachement restent sans changement.
Escadron de Gendarmerie
de la Garde impériale
L'uniforme est semblable à celui de l'arme à cheval de la compagnie de la Seine sauf les modifications suivantes :
- Le collet de l'habit de petite tenue est orné de grenades à douze flammes (brodée en fil blanc pour les gendarmes, argent pour les sous-officiers et brigadiers, cannetille pour les officiers)
- le pantalon de drap bleu-clair de la tenue à pied porte une bande de drap bleu-foncé
- les épaulettes sont en fil blanc pour les gendarmes, en laine bleue et filée d'argent pour les sous-officiers et brigadiers, écarlate et argent pour les trompettes. Les franges sont à gros grains.
- Le bonnet à poil et le chapeau de petite tenue sont du modèle du régiment de gendarmerie à pied de la garde impériale. Le bonnet de police est en drap bleu de roi avec galon en fil blanc.
RÈGLEMENT DU 9 AVRIL 1858
Dans son chapitre XIII, ce règlement sur le service intérieur de la gendarmerie rappelle les différentes tenues de la gendarmerie et les conditions dans lesquelles elles doivent être portées. Il y a trois sortes de tenues :
- La tenue du matin permise aux officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes hors caserne jusqu'à dix heures seulement.
- La petite tenue pour le service à cheval ou à pied.
- La grande tenue qui ne se prend que sur ordre de la légion.
La tenue du matin

- officiers : habit et bonnet de police,
- sous-officiers : bonnet de police, habit, sans aiguillettes, pantalon bleu (en capote pour l'arme à pied)
- troupe : bonnet de police, veste, pantalon bleu. Le pantalon de treillis n'est porté qu'à l'intérieur des casernes pour le soin des chevaux.
La petite tenue
- Armement
- Le port du revolver dans le service à pied est laissé à l'appréciation des commandants de compagnie ou d'arrondissement, soit même, du commandant de brigade. La giberne est supprimée dans tous les services ne comportant pas le port du fusil.
- Service à pied
- Pour les deux armes, la tenue pour tout service à pied, dans la résidence, est en petite tenue.
- Dans l'arme à pied, la tenue pour tout service, hors la résidence, est en habit avec giberne et sabre-baïonnette, trèfles et aiguillettes, col noir et chapeau le jour, cravate bleue et képi la nuit, pantalon large sur le brodequin, les hommes sont armés du fusil et portent, s'il y a lieu, le revolver dans son étui.
- Dans l'arme à cheval, lorsque le service se fait à pied, la tenue est en habit, trèfles, aiguillettes, giberne, sans sabre, pantalon large sur la petite botte, avec le fourreau de baïonnette attaché au ceinturon. Ils sont armés du fusil et portent, s'il y a lieu, le revolver dans son étui. Cette tenue est la même pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes chargés d'escorter des prisonniers transportés en chemin de fer ou dans des voilures cellulaires.
- Service de nuit
- En toute saison, les services de nuit, dans la résidence, sont faits en petite tenue, sabre et képi et le revolver sur ordre.
- Hors et à la résidence :
- habit, trèfles et aiguillettes, col noir et chapeau le jour, cravate bleue et képi la nuit, pantalon à la hongroise, giberne, sabre, bottes à la Condé ; chaque militaire est complètement armé.
- Dans les gares :
- chapeau et col noir.
La grande tenue
- arme à cheval : identique à la petite tenue sauf le pantalon blanc qui remplace le pantalon à la hongroise,
- arme à pied :les sous-officiers, brigadiers et gendarmes ont le pantalon bleu large sur la petite botte, la giberne et le ceinturon en sautoir.
Gendarmerie de la Corse

Décret du 11 février 1860
Par décret du 11 février 1860, les détachements de force supplétive établis à Corte et à Sartène par décret du 24 octobre 1851 sont supprimés. L'effectif complet de la 17e légion est fixé à 925 officiers, sous-officiers, brigadiers, gendarmes et enfants de troupe et à 185 chevaux.
Mousqueton de gendarmerie

circulaire ministérielle du 7 mai 1860
Cette circulaire prescrit la transformation des mousquetons de gendarmerie en service dans les compagnies. Toutes les armes à canon lisse doivent être retournées aux manufactures de l'état qui doivent les transformer en armes rayées.
Après transformation les mousquetons modèle an IX ou 1825 prennent la dénomination de mousquetons de gendarmerie modèle an IX transformé bis ou modèle 1825 transformé bis. Les mousquetons modèle 1842 prennent le nom de mousquetons modèle 1842 transformé.
I.M. du 15 juin 1860
Cette instruction, relative à la remonte des gendarmes métropolitains, précise que les montures admises en gendarmerie sont sans distinction de robe la grise excepté

Décision ministérielle du 21 juin 1860
Suite au décret impérial portant promulgation du traité relatif à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France conclu le 24 mars 1860 entre la France et la Sardaigne, cette décision porte sur l'organisation(1) des compagnies de gendarmerie de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes.
(1) En prévision ce ce rattachement, une décision impériale du 9 juin 1860 créait une 26e légion de gendarmerie qui fut organisée par décret du 18 juin 1860.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 27 MARS 1861
Ce texte apporte plusieurs modifications :
- Les officiers de la gendarmerie départementale (intérieur, Corse, Afrique) et de l'escadron de gendarmerie de la garde impériale sont dotés d'une capote(1) pour la petite tenue du matin, avec grenade en argent au collet pour l'escadron, sans grenade pour la départementale.
- Adoption d'un collet manteau en remplacement de la capote pour la gendarmerie à pied (intérieur, Afrique) ou du caban (17e légion). Ce nouveau manteau à collet pour la métropole et comporte un capuchon pour la Corse et l'Afrique.
- Comme cela existe pour l'escadron de gendarmerie de la garde impériale et pour la garde de Paris, une bande de drap bleu foncé est apposée sur la couture des pantalons bleu clair de tous les militaires de la gendarmerie départementale (Intérieur, Corse, Afrique) et de la garde impériale, quel que soit leur grade.
- Suppression du pantalon en tricot blanc pour l'arme à cheval des légions de Corse et d'Afrique.
- Addition d'une mentonnière en cuir verni noir au bonnet de police à visière pour l'arme à cheval.
- Remplacement du portemanteau par une besace pour la gendarmerie à cheval d'Afrique.
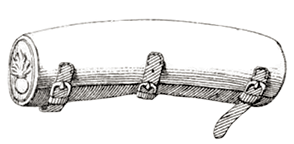
(1) cette disposition sera étendue aux adjudants sous-officiers par circulaire du 18 mai 1861.
Chevrons d'activité de service

Décret impérial du 18 février 1863
Dans ce décret important (751 articles) portant règlement sur la solde, les revues, l'administration et la comptabilité de la gendarmerie, la haute paie journalière d'ancienneté (article 128). Désignée sous le titre de haute paie de premier, de deuxième et de troisième chevron, elle est due aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes en activité de service. Le premier chevron est acquis à sept ans de service, le deuxième à onze ans et le troisième à quinze ans. Ces chevrons se placent sur le haut de l'épaule gauche.
Escadron de gendarmerie d'élite

Décret impérial du 13 avril 1864
L'escadron de gendarmerie(1) cesse de compter dans la garde impériale, il est placé sous l'autorité du grand maréchal du palais. Il continue néanmoins de relever du ministère de la Guerre en ce qui concerne le personnel, et son administration. Il prend le titre d'escadron de gendarmerie d'élite.

(1) sur une décision ministérielle du 9 octobre 1863, l'escadron de gendarmerie de la garde impériale cessait à compter de ce jour d'être embrigadé pour être placé sous le commandement direct du général commandant la division de la cavalerie de la garde impériale.
L'escadron de gendarmerie d'élite conserve dans ses grandes lignes sa tenue d'origine :
Grande tenue
- Habit de drap bleu foncé avec retroussis écarlates, collet et parements bleus, pattes horizontales figurant les poches, plastron écarlate, boutons en métal argenté à l'aigle, pantalon de tricot blanc double, pantalon bleu clair avec des bandes bleu foncé (à pied),
- bonnet à poil avec plaque à l'aigle, plumet écarlate, épaulettes et aiguillettes en fil blanc, buffleterie jaune piquée à jonc de 5 mm, plaque de baudrier en cuivre jaune, bottes à l'écuyère dites demi-fortes.
Petite tenue
- À cheval :
- Habit de drap bleu foncé avec retroussis écarlates, pattes horizontales figurant les poches, plastron en drap bleu foncé, pantalon demi-collant dit à la hongroise en cuir de laine bleu clair, manteau en drap bleu foncé, bonnet à poil.
- À pied :
- Pantalon bleu clair avec des bandes bleu foncé, petites bottes sous le pantalon, chapeau à cornes avec ganse et soutaches pompon écarlate.
D.M. du 2 novembre 1864
Les boutons d'uniforme et les plaques de ceinturon portent comme nouvelle inscription : Escadron des gendarmes d'élite au lieu des mots : Garde impériale; gendarmerie.

Gendarmerie de la Corse
Décret du 28 mars 1868
La 17e légion de gendarmerie(1) est réorganisée en deux compagnies ayant pour chef-lieu Bastia et Ajaccio. Chaque compagnie est subdivisée en deux capitaineries : Bastia et Corte pour la première et Ajaccio et Sartène pour la deuxième.
(1) les deux détachements supplétifs établis à Bastia et Ajaccio ont été dissous par décret du 15 juin 1864.

Escadron de gendarmerie d'élite
Décret du 20 janvier 1869
Le nombre de cavaliers de l'escadron de gendarmerie d'élite étant insuffisant pour assurer la protection des forêts contre les déprédations des braconniers et des maraudeurs, l'escadron est converti en un corps mixte. Dix-neuf gendarmes sont démontés pour former sept brigades à pied. Le complet de l'unité est de 110 cavaliers et 36 gendarmes à pied.
Gendarmes et gardes sous le IIIe empire
GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE début des hostilités : 19 juillet 1870.

Constitution de deux régiments de gendarmes
Décret impérial du 11 août 1870
Tant pour la défense du territoire que pour le maintien de l'ordre, deux régiments de gendarmes sont organisés, l'un à pied et l'autre à cheval. Le complet du régiment à pied est fixé à 48 officiers et 1.200 sous-officiers, brigadiers et gendarmes. Celui du régiment à cheval est fixé à 46 officiers et 720 sous-officiers, brigadiers et gendarmes. Les deux régiments comprennent un état-major et un petit-état-major. Le régiment à pied est organisé en 2 bataillons à 6 compagnies. Le cadre du régiment à cheval est à 6 escadrons.
LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE (04/09/1870 - 19/02/1871
Le gouvernement de défense nationale proclame la République aux habitants de Paris le 4 septembre 1870.
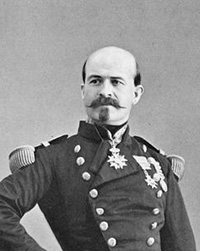
Au cours de cette période difficile, la gendarmerie allait être appelée à constituer des unités spéciales pour participer à la campagne de 1870. Ainsi, le général Trochu, président du gouvernement de la défense nationale forma par décret du 29 septembre 1870 un deuxième régiment de gendarmerie à cheval avec les militaires de tous grades, appartenant aux compagnies de gendarmerie envahies par l'ennemi, qui s'étaient repliés sur la capitale. Le complet de ce régiment fut fixé à 46 officiers et à 750 sous-officiers, brigadiers et gendarmes formant un état-major, un petit état-major et 6 escadrons.
Le décret du 1er octobre suivant créait un troisième bataillon dans le régiment de gendarmerie à pied. Le complet de ce bataillon qui comptait six compagnies comme les deux premiers fut fixé à 20 officiers et 800 sous-officiers brigadiers et gendarmes.
Cinq jours plus tard, le gouvernement de la défense nationale licenciait par décret du 6 octobre, l'escadron de gendarmerie d'élite qui avait été créé pour la surveillance des résidences impériales et des forêts de la couronne. Les officiers, sous-officiers brigadiers et gendarmes furent versés dans la gendarmerie départementale.
Sous les directives de Gambetta, les membres du gouvernement décrétèrent le 31 octobre 1870 de prélever dans les brigades les militaires nécessaire à la formation de trois régiments de marche de la gendarmerie dont deux à cheval et un à pied. Les deux régiments de marche de gendarmerie à cheval (n°1 et 2) étaient à l'effectif de 480 hommes montés répartis en 4 escadrons de 120 hommes chacun. Le régiment de marche de gendarmerie à pied était de la force de 1 200 hommes répartis en 2 bataillons à 4 compagnies de 150 hommes.
Estimant que ces créations étaient encore insuffisantes, le gouvernement qui s'était réfugié à Bordeaux mobilisa par décret du 20 décembre la gendarmerie sédentaire des départements pour assurer la police militaire en arrière des corps d'armée et par un décret du même jour mobilisa 14 légions de gendarmerie départementale pour former des régiments supplémentaires.
GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE fin des hostilités : 28 juillet 1871.
La France défaite perd l'Alsace-Lorraine.
La 25e légion et la 17e seront mobilisées à leur tour au mois de janvier et février 1871. Avec la fin des hostilités et considérant que la sécurité intérieure était fortement compromise, le ministre de la guerre par décret du 27 février 1871 fit regagner aux gendarmes mobilisés leurs brigades. Le 9 mars suivant, un arrêté d'Adolphe Thiers, ministre de la guerre, licenciait les régiments de marche de gendarmerie créés le 31 octobre 1870 et les deux escadrons de gendarmerie organisés le 10 novembre par arrêté du général commandant en chef l'armée de nord.
Le deuxième régiment de gendarmerie à cheval créé par décret du 29 septembre 1870 fut licencié à son tour par arrêté du 21 avril 1871, le 26 juin suivant le régiment à pied créé par le même décret était à son tour licencié.
LA IIIe RÉPUBLIQUE (04/09/1870 - 11/07/1940)
Lorsque la IIIe république s'installa, la gendarmerie nationale était à l'effectif de 19 735 hommes.

Dès 1871, il fut porté à 23 000 hommes avec la créationd'une légion de gendarmerie mobile de 1 222 hommes et l'augmentation de la garde républicaine de 2 856 hommes à 6 246. À cela il convient d'ajouter les gendarmes de l'Afrique au nombre de 867, les gendarmes des colonies 800, les gendarmes maritimes 600.
Le 25 juin 1871, un arrêté du chef du pouvoir exécutif créa pour le service de Versailles une légion de gendarmerie mobile composée d'un escadron de cavalerie et d'un bataillon d'infanterie formant un effectif de 1 222 hommes.
Ces effectifs ayant été prélevés dans les brigades de la métropole, les gendarmes firent campagne en habit et képi.
Petit à petit les gendarmes à cheval adoptèrent la tenue de la gendarmerie d'Afrique, c'est-à-dire le pantalon de drap bleu clair basané en cuir noir depuis le genou et porté par-dessus les petites bottes ou les brodequins. La couture extérieure de ces pantalons pouvait être ornée d'un passepoil rouge ou bien être recouverte d'une bande noire. Le changement de régime amena des changements d'insignes, dont la disparition des aigles.
Ces formations furent dissoutes le 9 mars 1871 par Adolphe Thiers alors chef du pouvoir exécutif.
Dans une circulaire du 10 juin 1871, le nouveau ministre de la Guerre, le général de Cissey, rappelait à tous la nécessité de reprendre une tenue régulière imposée par les textes en vigueur.
 Gendarmes prévôtaux à cheval (1870 - 1871)
Gendarmes prévôtaux à cheval (1870 - 1871)

État sur le matériel de guerre
Un rapport de 1873 sur le matériel de guerre produit par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale fait ressortir qu'au 1er juillet 1870, l'armée française possédait tant dans les magasins de l'État qu'entre les mains des troupes 3.181.000 fusils, carabines et mousquetons répartis en modèles Chassepot (33%), modèles à tabatière (11%), modèles à percussion (54%) et modèles à silex (2%). Près de 500.000 armes seront perdues pendant la guerre, détruites, saisies ou remises à l'ennemi prussien.
C.M. du 9 juillet 1871
Le port des moustaches et de la mouche est seul autorisé dans l'armée. La barbe est tolérée en campagne.
C.M. du 22 août 1871
Adoption de boutons en étain pur pour l'uniforme de la gendarmerie.
Une loi du31 août 1871 porte que le chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Président de la République française.
Ce qui distingue la tunique de l'habit, c'est qu'elle ne comporte pas de basques. La jupe de cet effet est coupée droite au niveau des cuisses.
DÉCISION DU 7 DÉCEMBRE 1871
Avec cette décision ministérielle, l'habit est définitivement supprimé et remplacé par la tunique en drap bleu foncé boutonnant droit sur la poitrine par neuf gros boutons d'uniforme. Les bords sont ornés d'un passepoil écarlate. La tunique est pourvue sur le côté gauche à hauteur des hanches d'une patte en drap passepoilée d'écarlate et doublé de cuir noir pour supporter le ceinturon. Le collet échancré par devant est orné dans les angles d'une grenade brodée en fil blanc. Les parements en pointe sont en drap bleu foncé passepoilé d'écarlate. Sur le pli de derrière de chaque pan de la tunique, une patte taillée en accolade passepoilée en drap écarlate est garnie de trois gros boutons d'uniforme. La jupe est entièrement doublée en escot écarlate pour l'arme à cheval de manière à former retroussis rouges lorsque les 4 pans sont relevés. Les boutons en étain portent la grenade et la légende : Gendarmerie. Ordre public.
Habillement

- Une tunique en drap bleu foncé boutonnant droit sur la poitrine par neuf gros boutons d'uniforme, son collet en drap bleu foncé passepoilé en drap pareil est orné de chaque côté d'une grenade à dix flammes entrelacées, blanc pour les gendarmes, argent pour les sous-officiers et brigadiers. La jupe de la tunique de l'arme à cheval est doublée d'escot écarlate,
- le col des sous-officiers, brigadiers et gendarmes est en satin turc noir,
- une veste destinée au travail salissant en drap bleu, coupé droit par devant et fermant au moyen de neuf petits boutons d'uniforme,
- le pantalon en cuir de laine bleu-clair est à brayette et comporte des poches et deux petites pattes-martingales en arrière. Il est orné d'une bande en drap bleu-foncé,
- la hongroise en cuir de laine bleu-clair de l'arme à cheval est à son tour ornée comme le pantalon d'une bande en drap bleu foncé,
- le pantalon demi-collant de tricot blanc est semblable pour la coupe et la forme au pantalon à la hongroise,
- le pantalon d'écurie en treillis de même forme que le pantalon en drap,
- la grande botte dite à l'écuyère est remplacée par la botte droite en cuir souple sans pli, avec genouillère de cuir fort montant jusqu'au genou, dite botte de Condé,
- le chapeau, non modifié est recouvert d'une coiffe en toile cirée pour le mauvais temps, il se porte toujours en bataille,
- le bonnet de police à visière dit képy est conservé pour les services extérieurs de nuit et le service de guerre, le bandeau est en drap bleu-foncé, le calot et le turban en drap bleu-clair.
équipement
- les trèfles et aiguillettes sont conservés sans modifications,
- le ceinturon de sabre des officiers est pour toutes les tenues en cuir verni noir avec bélière et se porte par dessus la tunique,
- le ceinturon d'une seule pièce est pourvu d'une plaque en cuivre qui porte au milieu une grenade et la légende « Gendarmerie. Ordre public ». Il est en buffle piqué à jour, jauni au milieu et blanc sur les bords,
- la banderole porte giberne, de même nature que le ceinturon, est ornée d'une plaque de cuivre représentant une tête de lion reliée à un écusson à grenade au moyen de trois chaînettes,
- en tenue de ville les sous-officiers et brigadiers portent l'épée suspendue à un ceinturon en cuir verni noir avec plaque en cuivre ornée d'une grenade et la légende « Gendarmerie. Ordre public »
- le havresac de l'arme à pied est en peau de veau fauve, le poil dehors.
Armement
Dès le mois d'août 1866, l'armée française adoptait le fusil Chassepot (du nom de son concepteur) qui prit la dénomination officielle de fusil Mle. 1866. Indépendamment du fusil d'infanterie, on créa dans les années qui suivirent trois autres modèles d'armes du même système qui ne différaient entre eux que par des dispositions spéciales en rapport avec le service des troupes auxquelles ils étaient destinés. Ainsi, la carabine de cavalerie et celle de la gendarmerie à cheval étaient identiques. Elles avaient la même longueur et possédaient une baïonnette quadrangulaire mod 1866. La carabine de la gendarmerie à pied possédait des boucles et des tenons qui permettaient d'y adapter un sabr- baïonnette.
D.M. du 22 décembre 1871
Le ministre de la Guerre décide que toutes les troupes de gendarmerie recevront des armes modèle 1866. Les gendarmes à pied recevront provisoirement le fusil d'infanterie et les gendarmes à cheval seront armés du fusil de cavalerie. Les gendarmes à cheval porteurs du fusil de cavalerie modèle 1866 pouvant dans le service à pied ne pas paraître suffisamment armés avec un fusil sans baïonnette, le ministre a décidé qu'une baïonnette quadrangulaire serait adaptée aux fusils de cavalerie modèle 1866 pour le service spécial de la gendarmerie à cheval. Cette baïonnette portera le nom de baïonnette modèle 1866.

Par modification à la décision ministérielle du 3 janvier 1870(1) l'arme du modèle 1866 en service dans les troupes à cheval prend les noms suivants : - Carabine modèle 1866 ; - Carabine avec baïonnette modèle 1866.
(1) L'Empereur ayant adopté le 4 décembre 1869 pour le service de la cavalerie un fusil se chargeant par la culasse du même système que le fusil d'infanterie, le ministre avait décidé le 3 janvier 1870 que cette arme prendrait le nom de fusil de cavalerie modèle 1866.
C.M. du 14 mars 1872
Les sous-officiers à cheval qui n'étaient armés que du sabre et du pistolet reçoivent comme les gendarmes la carabine avec baïonnette Mle. 1866 qu'ils ne prendront qu'en cas de nécessité, et cela jusqu'au moment où la gendarmerie pourra être équipée de révolver.
C.M. du 16 mars 1872
Les boutons à aigle avec la légende : Gendarmerie impériale sont retirés des effets d'habillement et remplacés par les anciens modèles portant la légende : gendarmerie nationale ou ceux du modèle décrit dans la décision du 22 décembre 1871.
D.M. du 19 mars 1872
Pour remplacer l'aigle emblème de l'empire, la coquille du sabre des officiers supérieurs est ornée de six drapeaux derrière une couronne de chêne et de laurier, celle des officiers subalternes d'une couronne de chêne et de laurier seulement.
C.M. du 27 mai 1872
La giberne à banderole est d'un modèle unique pour toute l'arme, tous les officiers de l'arme, quel que soit leur grade sont équipés de la capote-manteau de cavalerie, le pantalon de coutil blanc est supprimé.
Chefs de légion

Décret du 21 juillet 1872
L'admission dans la gendarmerie des colonels des autres armes est supprimée.
Tous les emplois de colonel sont donnés par avancement aux lieutenants-colonels de l'arme.
![]() Les instructions interprétatives de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée précisent qu'un gendarme présent au corps n'est pas autorisé à voter, par contre si celui-ci est en permission il peut se rendre aux urnes, car il est alors considéré comme un citoyen et non comme un militaire.
Les instructions interprétatives de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée précisent qu'un gendarme présent au corps n'est pas autorisé à voter, par contre si celui-ci est en permission il peut se rendre aux urnes, car il est alors considéré comme un citoyen et non comme un militaire.
INSTRUCTION DU 13 AOÛT 1872
Cette instruction ministérielle reprend dans son ensemble la décision ministérielle de 1871 et lui apporte de nombreuses précisions et quelques modifications. L'habillement de la gendarmerie se compose pour les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes d'une petite et d'une grande tenue.
- Petite tenue
- tunique en drap bleu foncé, pantalon en cuir de laine bleu-clair avec bandes de drap bleu-foncé ; pour le service à cheval, un pantalon demi-collant en drap bleu-clair dit hongroise avec bande de drap bleu-foncé
- Grande tenue
- même tunique et pantalon pour l'arme à pied, d'un pantalon de tricot blanc pour l'arme à cheval
Gendarmerie des départements

- La jupe de la tunique est moins ample et plus courte.
- Suppression du pantalon de coutil blanc.
- Le manteau de l'arme à cheval est toujours à manches et assez ample pour couvrir la charge et les chaperons.
- L'arme à pied porte toujours le collet-manteau orné aux deux angles du petit collet d'une grenade. Le corps du manteau est fermé devant par trois pattes.
- Les dimensions du képi sont fixées à 100 mm par devant et 140 mm par-derrière. Le bandeau en drap bleu-foncé est de 45mm, le calot de 120 mm de diamètre et le turban en drap bleu-clair. Il est muni de deux attaches pour fixer une jugulaire pour l'arme à cheval. Le galon blanc de fonction de 13mm entoure la partie supérieure du bandeau, la grenade du bandeau en fil blanc est à neuf flammes.
- Le col est toujours en satin noir, mais pour les services extérieurs effectués en képi, les gendarmes font usage de la cravate bleu de ciel foncé qui vient s'attacher devant par un noeud plat caché par le vêtement.
- Les gants de forme dite amadis (ils s'arretent au niveau du poignet) sont en peau de mouton blanchie.
- Les cavaliers font usage des bottes dites à la Condé comportant une genouillère de 175mm de hauteur échancrée à l'arrière. Pour le service à pied ils font usage des petites bottes. Les deux modèles sont équipés d'éperons.
- Le ceinturon de l'arme à cheval en buffle blanc est d'une seule pièce avec deux bélières (une grande et une petite).
- Sur la plaque de ceinturon en cuivre légèrement cambrée est estampé en relief une grenade à onze pointes et les mots GENDARMERIE et ORDRE PUBLIC.
- Le coffret de giberne est tout en cuir pour les deux armes, la pattelette porte une grenade en cuivre ; pour la maintenir, une martingale en cuir noirci se fixe d'une part à un bouton placé sur la giberne et de l'autre au bouton de taille gauche du vêtement.
- Des brodequins sont autorisés pour le service journalier hors de la résidence. La petite botte étant conservée pour la grande tenue et pour le service à la résidence.
- Le porte-feuille de correspondance destiné à contenir les dépêches et le révolver est le même pour les deux armes.
- L'épée des adjudants et maréchaux des logis-chefs est ornée d'une dragonne en poil de chèvre noir et terminée par une olive recouverte en poil de chèvre noir.
Gendarmerie de la Corse
La tunique, le pantalon de cuir de laine bleu-clair, le pantalon de treillis, le mateau, le collet-manteau, la este des sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont semblables à ceux des départements. Les différences sont les suivantes :
- L'arme à cheval ne fait pas usage d'un pantalon à la hongroise mais utilise un pantalon ordinaire porté sur les petites bottes et garni jusqu'au genou d'une fausse botte en peau de veau noir.
- Le képi est du même modèle que celui de la légion d'Afrique. Il est plus haut que celui des départements 120 mm par devant et 165 mm par-derrière. Le bandeau est en drap bleu-foncé, le calot et le turban en drap bleu-clair. Il est orné sur toutes ses coutures d'une ganse en argent de 2mm et possède une grenade en argent sur le devant brodée sur drap bleu foncé.
- Les sous-officiers et gendarmes sont autorisés à porter pour le service journalier le pantalon de coutil de coton bleu.
- Le collet-manteau de l'arme à pied est pourvu d'un capuchon mobile.

Armement de la gendarmerie
Décision ministérielle du 20 novembre 1872
Avec cette décision la gendarmerie adopte définitivement les armes du modèle 1866 spécialement adaptées à cette troupe. La carabine des gendarmes à pied diffère de celle des gendarmes à cheval par les points d'attache de la bretelle qui sont disposés pour le service à pied et de son sabre-baïonnette modèle 1866. La carabine des cavaliers est munie d'une baïonnette quadrangulaire Mle. 1866. Ces armes tirent la cartouche Mle. 1866. Son poids est de 3,530 kg (4,185 kg avec la baïonnette). Sa longueur est de 1,175m (1,748 avec la baïonnette).
DÉCISION DU 26 NOVEMBRE 1872
La gendarmerie possédant plusieurs tenues, un premier règlement du 9 avril 1858 précisait dans quelles circonstances elles devaient être portées. Ce règlement sera modifié par une décision ministérielle du 26 novembre 1872 donnant la description précise des quatre tenues de l'époque : la grande tenue qui est permise jusqu'à midi seulement ; la petite tenue ou tenue du jour qui se porte à partir de midi ; la tenue de service ; la grande tenue mise sur ordre de la légion.

- La grande tenue
- officier : tunique et képi,
- sous-officier : képi, tunique, cravate bleue, sans aiguillettes et pantalon bleu,
- gendarme : képi, cravate bleue, veste, pantalon bleu. Pour le pansage et les corvées : pantalon de treillis, sabots et blouse en toile grise.
- La petite tenue ou tenue du jour
- officier : tunique, épaulette et aiguillettes, pantalon, petites bottes à éperons, chapeau bordé de noir, épée,
- sous-officier et gendarme : tunique, trèfles et aiguillettes, pantalon, petites bottes avec ou sans éperons, suivant l'arme, chapeau, col noir, sabre ou sabre-baïonnette en ceinturon. Les sous-officiers et brigadiers portent l'épée.
- La tenue de service
- officier : tunique, épaulette et aiguillettes, pantalon de drap à la hongroise, bottes à la Condé, sabre et képi,
- sous-officier et gendarme :
- Dans la résidence : petite tenue.
- Hors la résidence :
- arme à pied : tunique avec giberne et sabre-baïonnette, trèfles et aiguillettes, cravate bleue, képi, pantalon large sur brodequin,
- arme à cheval : tunique, trèfles et aiguillettes, col noir et chapeau le jour, cravate bleue et képi la nuit, pantalon à la hongroise, giberne, sabre, bottes à la Condé.
- La grande tenue
- arme à pied : tenue de service + giberne et havresac,
- arme à cheval : tenue de service, mais en pantalon de tricot blanc avec les quatre pans de la tunique relevés en forme de retroussis.
Avec la suppression du pantalon de coutil blanc, les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarme n'ont plus de tenue d'été et doivent en toutes circonstances porter le pantalon de drap bleu.
N.Min. du 13 janvier 1873
- La coupe et la dimension de la tunique sont dorénavant uniques pour toutes les subdivisions de l'arme.
- Pour les légions de Corse et d'Afrique, le pantalon de coton bleu est remplacé par un pantalon de coutil gris.

D.M. du 12 février 1873
Adoption d'un nouveau modèle de révolver présenté par M. Delvigne.
I.M. du 24 décembre 1873
Adoption dans les armées d'un nouveau modèle de képi. La visière carrée et horizontale est abandonnée au profit d'une ronde inclinée à 30°. Deux orifices de ventilation semblable à ceux des shakos sont incorporés dans la partie supérieure, enfin le calot est ovalaire au lieu d'être circulaire.
N.Min. du 20 avril 1874
Le ministre de la guerre décide d'assigner une dénomination uniforme à la coiffure de petite tenue des troupes de toutes armes, laquelle, suivant les époques a été appelée indifféremment : bonnet de police à visière, casquette, képi. À compter de cette date, cette coiffure est désignée exclusivement et réglementairement sous le nom de képi.
D.M. du 8 mai 1874
La visière droite du képi est remplacée par une visière inclinée de 30° au-dessous de l'horizon.
Képis des sous-officiers

Décision ministérielle du 4 juin 1874
Le ministre de la guerre decidait que le képi des sous officiers serait orné d'une fausse jugulaire en galon d'or. Cet ornement avec ses deux passants est fixé de chaque côté du képi par deux petits boutons d'uniforme demi-sphériques de 10 millimètres de diamètre en métal d'argent ou plaqués en or selon l'arme et semblables en tout point à ceux du képi des officiers
I.M. du 20 juin 1874
La sacoche gauche du harnachement est aménagée de façon à recevoir le révolver Mle 1873.
C.M. du 16 juillet 1874
À compter de cette date, le révolver n'est plus porté dans le portefeuille de correspondance* mais dans un étui sur l'homme. Cet étui doit recevoir le pistolet Mle. 1873 et être pourvu d'une case pouvant contenir les cartouches. Il est muni d'une bretelle destinée à passer en sautoir sur l'épaule, afin de soulager le ceinturon d'une partie du poids de l'arme. Il est porté à gauche pour ne pas gêner le port du fusil à droite.
* À la suite de cette décision, le ministre de la guerre supprime dans une note du 24 août suivant la fonte en vache lisse qui se trouvait à l'intérieur du portefeuille de correspondance.
N.Min. du 24 août 1874
Le ministre de la guerre décide de supprimer la fonte se trouvant à l'intérieur du portefeuille de correspondance et dans laquelle on plaçait le pistolet.
| Révolver Mle 1873 | Caractéristiques techniques |
|---|---|
 |
|
| Arme à percussion centrale qui équipa la gendarmerie à compter du 15 juillet 1878. | (Collection Tenue bleu-gendarme) |
C.M. du 16 janvier 1875
Le ministre de la guerre autorise les chevaux de robe grise en gendarmerie.
DÉCISION DU 24 JUIN 1875
Cette décision ministérielle annule et remplace l'article 189 du règlement du 9 avril 1858 sur le service intérieur de la gendarmerie qui avait été modifié par une décision ministérielle du 26 novembre 1872.
- Service à pied
- Pour les deux armes, la tenue pour tout service à pied, dans la résidence, est en petite tenue.
- Dans l'arme à pied, la tenue pour tout service, hors la résidence, est en tunique avec giberne et sabre-baïonnette, trèfles et aiguillettes, col noir et chapeau le jour, cravate bleue et képi la nuit, pantalon large sur le brodequin, les hommes sont armés du fusil et portent, s'il y a lieu, le revolver dans son étui.
- Dans l'arme à cheval, lorsque, par une circonstance exceptionnelle, et notamment pour le parcours des bois et forêts, le service se fait à pied, la tenue est en tunique, trèfles, aiguillettes, giberne, sans sabre, mais les hommes ont le pantalon large sur la petite botte, avec le fourreau de baïonnette attaché au ceinturon. Ils sont armés du fusil et portent, s'il y a lieu, le revolver dans son étui. Cette tenue est la même pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes chargés d'escorter des prisonniers transportés en chemin de fer ou dans des voilures cellulaires.
- Service de nuit
- En toute saison, les services de nuit, dans la résidence, sont faits en petite tenue, sabre et képi, plus le revolver quand il en sera ainsi ordonné.
- Service à cheval
- La tenue pour les services hors la résidence est en tunique, trèfles et aiguillettes, col noir et chapeau le jour, cravate bleue et képi la nuit, pantalon à la hongroise, giberne, sabre, bottes à la Condé ; chaque militaire est complètement armé.
- La tenue de service, dans la résidence, est la même que ci-dessus.
- Le service dans les gares, quel que soit leur éloignement de la caserne, ainsi que le service près des autorités civiles et militaires, ou de participation avec elles, est toujours fait en chapeau et col noir.
- La giberne est supprimée dans tous les services ne comportant pas le port du fusil.
- La giberne étant enlevée et le revolver étant porté à gauche, le portefeuille de correspondance sera placé à droite, pour permettre aux hommes de l'arme à cheval de saisir le sabre plus facilement.
D.M. du 15 juillet 1878
Le cloisonnement à l'intérieur des gibernes est modifié pour les deux armes de manière à recevoir le nécessaire d'arme, les cartouches pour le fusil et celles pour le révolver.
DÉCISION DU 9 FÉVRIER 1880
Adoption d'un nouveau modèle de veste et d'insigne de grade pour les manteaux et collets-manteaux.
Les brigadiers, maréchaux des logis fourriers, maréchaux des logis, maréchaux des logis chef et adjudants portent désormais leur insigne de grade sur les manteaux en galons horizontaux de 12 mm de large et 70 mm de long placés sur les devants de la rotonde ou du collet-manteau. Le brigadier porte un galon tissus point de Hongrie en argent, le maréchal des logis ou maréchal des logis fourrier deux galons en argent, le maréchal des logis-chef trois galons en argent; l'adjudant trois galons dont celui du milieu est or.
La nouvelle veste est en drap bleu foncé. Elle ferme droit sur la poitrine à l'aide de neuf boutons d'uniforme du petit modèle. Le collet en drap du fond mesure 35 mm de haut. Sur chaque épaule est placée une patte en drap du fond retenue près de l'encolure par un petit bouton d'uniforme. Le parement des manches en drap du fond est taillé en pointe.

Appellation des adjudants

Circulaire du 16 février 1880
La loi du 13 mars 1875 et le décret du 30 avril suivant ayant donnés aux adjudants le rang et l'état d'officier, ils étaient abusivement appelés « mon lieutenant ». Le général Farre, alors ministre de la guerre, décide de réserver cette appellation qu'aux militaires qui ont effectivement ce grade. Les adjudants sous-officiers de toutes les armes devront être appelés par leurs subordonnés « mon adjudant ».
![]() Par décision ministérielle du 12 avril 1880, le général Farre décide que l'inscription « Gendarmerie Nationale » sera désormais apposée sur toutes les casernes de gendarmerie départementale.
Par décision ministérielle du 12 avril 1880, le général Farre décide que l'inscription « Gendarmerie Nationale » sera désormais apposée sur toutes les casernes de gendarmerie départementale.
![]() Avec la loi du 6 juillet 1880, la République adopte la date du 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle.
Avec la loi du 6 juillet 1880, la République adopte la date du 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle.
DÉCISION DU 12 MARS 1883
La distinction hiérarchique des officiers se faisait à cette époque par le jeu des épaulettes (couleur, torsades) des contre-épaulettes et des aiguillettes. Ces éléments avaient été imposés dans les armées comme insigne de grade à compter de 1762. Avec cette décision, le ministre de la guerre autorise les officiers de gendarmerie (gendarmerie départementale, légion d'Afrique, bataillon mobile et garde républicaine) en petite tenue et dans leur service journalier à porter sur les manches de la tunique et du manteau des galons de grade à la place des épaulettes et aiguillettes.
Cette décision entraîna, pour les officiers, la modification des parements des manches de la tunique qui étaient taillés en pointes et se prêtaient parfaitement au galonnage en chevron des maréchaux des logis et brigadiers. Les grades des officiers étaient constitués de galons or ou argent suivant l'arme dit en traits côtelés de 6mm placés parallèlement et immédiatement au-dessus du parement et faisaient le tour de la manche. Leur nombre indiquant le grade de l'officier. Cette décision sera appliquée aux adjudants.
I.M. du 29 août 1883
Les brigadiers reçoivent une deuxième tunique en remplacement de la veste.
En 1883, l'effectif de la gendarmerie est de 26 511 hommes et le nombre de ses chevaux s'élève à 13 013. L'arme est composée :
- de la gendarmerie départementale divisée en 30 légions et forte de 21 387 hommes dont 759 officiers. Tous les officiers sont montés et les compagnies sont constituées de brigades à pied et à cheval. Cette composante a 11 540 chevaux pour son service,
- d'une légion à 4 compagnies pour le service d'Algérie forte de 940 hommes avec 707 chevaux,
- d'un bataillon de gendarmerie mobile de 1013 hommes,
- de la garde de Paris. Forte de 3171 hommes, elle est divisée en 3 bataillons à 8 compagnies et 3 escadrons avec 753 chevaux.

INSTRUCTION DU 11 AOÛT 1885
Cette instruction résume l'ensemble des modifications apportées à l'uniforme de la gendarmerie ( gendarmerie départementale, de la Corse, d'Afrique, de la garde républicaine et des auxiliaires indigènes de la gendarmerie d'Afrique) depuis 1872. L'habillement se compose de deux tenues.
Tenue
- La petite tenue : tunique en drap bleu foncé, pantalon bleu clair avec bandes bleu foncé, pour l'arme à cheval d'une hongroise avec bande bleu foncé.
- La grande tenue : identique à la première, mais pour l'arme à pied, d'une veste et d'un collet-manteau ; pour l'arme à cheval, d'un pantalon de tricot blanc, d'un manteau, d'une veste, d'un pantalon d'écurie en treillis ; pour les officiers, une capote manteau.
Armement
- Arme à pied : révolver, carabine de gendarmerie modèle 1874 modifiée 1880, sabre-baïonnette,
- arme à cheval : révolver, carabine modèle 1874 avec baïonnette quadrangulaire, sabre de cavalerie légère modèle 1822;
Quelques modifications sont à noter :
Gendarmerie des départements
- La hauteur de la calotte ou forme du chapeau est diminuée,
- Un faux col dit à soufflet toujours en satin noir, mais contenant un dépassement en calicot blanc remplace l'ancien,
- les adjudants, qui sont dispensés du port de la giberne depuis le 8 novembre 1884, portent toujours l'épaulette à graine à droite. Comme les officiers, leur tunique et manteau sont désormais galonnés d'un galon en trait côtelé or sur la manche ce qui leur permet d'être dispensé du port des épaulettes dans les mêmes circonstances que l'officier (voir instruction du 12 mars 1883),
- les gendarmes font usage de la cravate en calicot bleu pour tous les services extérieurs fait en képi,
- le révolver est porté du côté gauche, dans un étui de cuir fauve et soutenu par une banderole en cuir fauve.
Gendarmerie de la Corse
La tunique, le pantalon de cuir en laine bleu clair, le pantalon de treillis, le manteau, le collet-manteau, la veste des sous-officiers, brigadiers et gendarmes de la Corse sont semblables à ceux des départements.
- Pantalon de cheval : la hongroise et les grandes bottes sont remplacées par un pantalon ordinaire en drap bleu clair qui se porte par dessus la petite botte,
- le pantalon de coutil gris de mêmes forme et dimensions que le pantalon bleu clair est autorisé pour le service journalier,
- le collet-manteau est pourvu d'un capuchon mobile,
- le personnel est pourvu de deux képis : celui de la légion d'Afrique pour la grande tenue (képi droit et rigide) et celui de la métropole pour la petite tenue.
D.M. du 13 oct. et 24 déc. 1886
- Le harnachement des officiers montés est modifié. La selle est garnie de deux sacoches en cuir jaune. Le manteau est "paqueté" à l'arrière de la selle.
- La seconde décision porte que les officiers disposent de deux harnachements, un de parade avec un tapis en drap bleu galonné d'argent et faux manteau et un harnachement de deuxième tenue composé d'un tapis et un couvre-sacoche dans lesquels les galons d'argent sont remplacés par des galons bleu foncé.
I.M. du 13 septembre 1886
Un col blanc fixé au collet de la tunique remplace pour les officiers et adjudants le col de satin noir. Le collet de la tunique n'est plus échancré, mais coupé droit.
Le décret organique du 22 décembre 1851 avait créé des emplois d'adjudantset de maréchaux des logis-chefs en gendarmerie. 26 emplois d'adjudants à cheval commandants de brigades étaient placés au chef-lieu de chaque légion et 65 emplois de maréchaux des logis-chefs à cheval étaient créés pour être placés en chacun des chefs-lieux de compagnie pour commander la première brigade à cheval. Lorsqu'en 1875, le nombre de légions augmenta passant de 26 à 31 par la création des légions bis et légions ter, le nombre d'adjudants augmenta dans les mêmes proportions.
Dans un décret du 6 avril 1886, Jules Grévy, estimant qu'il fallait donner à la gendarmerie une organisation moins coûteuse et mieux en rapport avec l'organisation militaire du pays, réduisit le nombre de légions de 31 à 21. Le nombre d'adjudants devait être réduit de la même manière. Cependant, le nombre de brigades ayant été considérablement augmenté depuis 1852 passant de 3200 à 4341, le nombre d'emplois d'adjudants et de maréchaux des logis-chefs n'était plus en rapport avec l'effectif du corps comme dans les autres armes.
L'accès au grade de lieutenant étant très restreint, les perspectives de carrière pour les sous-officiers de gendarmerie étaient considérablement limitées. Pour remédier à cette situation, le général Boulanger, ministre de la Guerre, proposait au président de la République Jules Grévy, qu'un emploi d'adjudant soit créé au chef-lieu de chaque compagnie et qu'un emploi de maréchal des logis-chef à cheval soit créé au chef-lieu de chaque arrondissement ou section externe.
Adjudants et maréchaux des logis-chef

Décret du 26 mars 1887
Augmentation du nombre d'adjudant et de maréchal des logis-chef dans la gendarmerie départementale. Un emploi d'adjudant est créé au chef-lieu de chaque compagnie et un emploi de maréchal des logis-chef à cheval au chef-lieu de chaque arrondissement ou section externe. Les sous-officiers des brigades à pied sont autorisés de concourrir avec ceux des brigades à cheval.
Ce décret a été rendu applicable à la gendarmerie coloniale par le décret du 13 mars 1889.
I.M. du 28 juin 1887
- La gendarmerie adopte le harnachement du modèle 1874. Il se comporte d'un tapis de selle bleu foncé bordé d'un galon blanc sans grenade et garni d'un entrejambe en cuir noir de chaque côté. Les sacoches en cuir fauve sont recouvertes de couvre-sacoche. La besace a disparu. Un bissac composé de deux poches en toile noire s'adapte derrière la selle. Le manteau plié en portefeuille peut être placé, soit tel quel, soit dans son étui derrière la selle.
- Il n'y a plus de botte de carabine. Celle-ci est portée à la grenadière.
| Fusil Chassepot avec sabre-baïonnette Mle 1866 | Caractéristiques techniques |
|---|---|
 |
|
| Arme à feu rayée ; chargement par la culasse. Fusil transformé dit fusil à tabatière. | (Collection Tenue bleu-gendarme) |
I.M. du 23 novembre 1887
- Deux nouveaux modèles de manteaux équipent la gendarmerie.
- Pour l'arme à cheval, un manteau dit criméenne en drap bleu foncé imperméabilisé, fermé par une rangée de six gros boutons d'uniforme et resserré derrière par une martingale fermée fermée par deux petits boutons. Les devants sont parementés en drap du fond. Un large collet pouvant se relever est garni dans ses angles de deux grenades en fil blanc.
- Pour l'arme à pied, le collet-manteau fait place à une capote-manteau en drap bleu foncé imperméabilisé et fermé par une rangée de cinq boutons d'uniforme. Le collet orné de grenades pouvant se relever. Sa coupe permet qu'il puisse être porté par-dessus les trèfles.
N.Min. du 3 juin 1888
Le képi des sous-officiers et brigadiers est orné d'une fausse jugulaire en galon d'argent, façon dite en trait côtelé, fixée sur le devant par deux petits boutons d'uniforme auprès desquels sont placés, sur la fausse jugulaire deux passants faits du même galon (cet accessoire est toujours monté sur les képis actuels). Le galon de bandeau et la grenade sont en argent, les ganses qui recouvrent les coutures sont mélangées 2/3 argent et 1/3 en laine bleu foncé.
N.Min. du 30 juin 1888
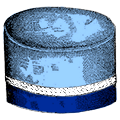
La gendarmerie est pourvue d'une coiffure de corvée destinée à être portée à l'intérieur des casernes et des cantonnements pour effectuer tous les travaux d'entretien. Cette calotte haute de 11,5 cm, légèrement ovale, comprend un bandeau bleu foncé de 35mm de hauteur, un turban bleu clair de 67 mm de haut sur lequel est placé un galon tissé à point de Hongrie de 13 mm de largeur et un calot circulaire bleu clair. Le galon est de fil blanc pour les gendarmes, argent pour les sous-officiers et brigadiers, de laine orange pour la garde républicaine.
Cette coiffure n'est obligatoire que pour : les nouveaux admis, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes à pied et à cheval qui sont désignés pour faire partie de la prévôté et les simples cavaliers de la garde républicaine. Les personnels n'entrant pas dans ces catégories peuvent se faire confectionner cette calotte à partir de vêtements usagés.
Gendarmerie de la Corse et d'Afrique
N.Min. du 14 septembre 1888

Cette note apporte des modifications à l'instruction du 11 août 1885. Le képi de grande tenue est rigide. Il s'orne du galon d'arme de 13 mm en argent à la partie supérieure du bandeau. Sur celui-ci est brodée une grenade en argent. Le képi reçoit une cocarde fixée par une ganse et un macaron en argent et laine, un gousset porte-pompon, un pompon ovale dont le quart inférieur et postérieur est supprimé. Sa hauteur sur le devant est de 105 mm et de 155 mm sur l'arrière. Toutes les coutures sont recouvertes d'une ganse ronde en cordonnet tissé deux tiers en argent et un tiers en laine bleue.
Cette coiffure est identique du gendarme au maréchal des logis-chef. Celle des adjudants comporte une soutache de grade en or. Pour les officiers les ganses et soutaches sont en argent et il s'y rajoute les soutaches de grade. Le képi des officiers et adjudants est orné d'un noeud hongrois sur le dessus du calot et une fausse jugulaire en galon d'argent (or pour les adjudants). Le pompon entièrement en argent (or pour les adjudants) est remplacé en grande tenue pour les officiers supérieurs par l'aigrette ou le plumet tricolore prescrit pour toutes les armes par décision ministérielle du 11 juin 1886. La fausse jugulaire est remplacée pour les gendarmes par une ganse cordonnet 2/3 argent et 1/3 laine semblable au cordonnet recouvrant les coutures du bandeau et du calot.


NOTES DU 30 JUILLET ET 8 OCTOBRE 1889
Avec ces deux notes ministérielles, la tenue de la gendarmerie va subir d'importantes modifications applicables également aux légions de Corse et d'Algérie.
- La tunique à jupe, serrée à la taille est remplacée par une tunique dite ample. Fermée par neuf gros boutons, elle est plus courte d'une dizaine de centimètres et porte une poche extérieure dite de poitrine sur le devant de droite et à hauteur du troisième bouton. La caractéristique de cette tunique est d'être portée par-dessus le ceinturon aussi une fente horizontale recouverte d'une patte est pratiquée sur le coté gauche afin de laisser passer le porte-sabre baïonnette. Les manches sont garnies d'une patte de parement en drap écarlate passepoilée en drap du fond et garnie de trois petits boutons. Le bas du dos est orné de deux pattes taillées en accolade en drap du fond passepoilé en drap écarlate, garnies chacune de trois boutons d'uniforme. Seuls les pans antérieurs de cette tunique se relèvent, ils sont doublés d'escot rouge pour l'arme à cheval.
- La culotte à la hongroise est collante dans la partie au-dessous du genou et se ferme sur le côté au moyen d'une rangée de boutons extérieurs.
- Le pantalon bleu-clair n'est plus en drap cuir de laine, mais en drap satin.
- Le pantalon de treillis et le bourgeron de toile blanche sont portés dans les casernes et cantonnements par les deux armes.
- Le faux-col à soufflet est supprimé; un col de calicot blanc est fixé à l'intérieur de la veste et de la tunique.
- La cravate bleue n'est plus portée qu'en campagne.
- L'ensemble des cuirs (dragonne, bélière de sabre, bretelle de carabine, courroies d'éperon ...) sont teintés en noir. Le ceinturon porté sous la tunique reste en cuir fauve.
- L'épée est supprimée pour les gradés à cheval qui portent en toutes circonstances le sabre. Elle est également supprimée pour les officiers avec le ceinturon. Seuls les gradés à pied la conservent.
- Suppression pour les officiers du chapeau de petite tenue bordée de noir. Le chapeau galonné argent n'est plus porté que dans la grande tenue de service.
- Dans la grande tenue, les officiers font usage du képi rigide. Il est orné d'une cocarde avec ganse de cocarde et bouton, d'un pompon sphérique en argent, d'un noeud hongrois sur le dessus, de galons de grade et de galons verticaux sur les côtés et derrière. Les tresses plates qui indiquaient les grades sont remplacées par des soutaches de 4 mm de large.
D.M. du 7 avril 1891
Les deux manteaux sont à nouveau modifiés. Ils ne sont plus en drap imperméable, mais en drap double broche. Les grenades du collet sont supprimées.
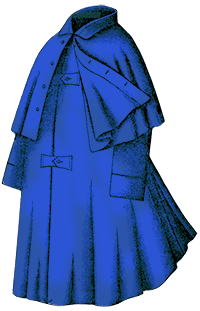
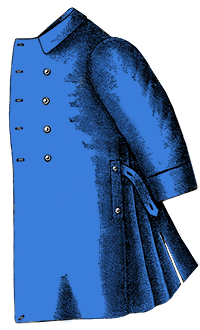
(1) Pour l'arme à cheval, le manteau se ferme par deux pattes boutonnées. La criméenne fait place à une rotonde plus longue descendant à la hauteur du coude et fermée par quatre boutons.
(2) Pour l'arme à pied, la capote-manteau ferme par deux rangées de cinq boutons, les parements des manches sont coupés droit. Le manteau est fendu en bas du dos sur une longueur de 25 cm. Deux pattes de poche recouvrent l'ouverture des poches. Ces pattes sont ornées de deux gros boutons dont le supérieur sert pour accrocher la martingale.
Mode de recrutement des adjudants de gendarmerie

Décision présidentielle du 16 mars 1891
Le Président de la République a décidé que les maréchaux des logis chefs de gendarmerie seraient à l'avenir seuls admis à concourir pour l'emploi d'adjudant.
Cette décision modifie l'article 47 du décret du 1er mars 1854 (B.O., p.r.,P.332).
N.Min. du 23 juillet 1891
Le képi rigide des colonels est orné d'une aigrette en plume de héron blanc entouré à sa base de plumes tricolores.
| Mousqueton modèle 1890 et son épée-baïonnette(1) | Caractéristiques techniques |
|---|---|
 |
|
| Arme à répétition équipée d'une hausse de tir | (Collection Tenue bleu-gendarme) |
(1) La carabine modèle 1890 fut mise à l'essai, au cours de l'année 1891, dans quelques compagnies de gendarmerie et dans la garde républicaine en remplacement du modèle 1874. Plus courte de 20cm environ que le modèle précédent (96 cm au lieu de 1,17 m), cette arme à répétition était munie d'une hausse de tir. D'une portée maximale de 2000 m. et équipée d'un chargeur mobile contenant trois cartouches, elle fut délivrée dans toutes les compagnies à compter de mars 1892.
N.Min. du 9 janvier 1892
Les gradés et gendarmes sont autorisés à sortir en képi chaque fois qu'ils ne sont pas de service.
D.M. du 23 avril 1892
Le ministre de la Guerre décide de remplacer les carabines de cavalerie avec baïonnettes et les carabines de gendarmerie modèle 1866-74 M 80 et 1874 M 80 par la carabine de gendarmerie modèle 1890. Cette arme est livrée avec trois chargeurs.
N.Min. du 8 septembre 1892
- La veste est supprimée pour les deux armes.
- Cavaliers et fantassins ayant été équipés de la carabine Lebel Mle 1890 avec épée-baïonnette, le porte-sabre-baïonnette de l'arme à pied est supprimé et l'ensemble du personnel reçoit le porte-épée-baïonnette en cuir verni noir qui a la forme du porte-fourreau de baïonnette précédent.
La tunique omnibus
C'est dans le courant de la même année qu'un nouveau vêtement allait faire son apparition : la tunique-omnibus. Ce vêtement était issu d'un concept développé dans les années 1888 / 1889 selon lequel les officiers devaient pouvoir commander en toutes circonstances revêtus d'un seul et même uniforme. Cet uniforme extraordinaire devait leur permettre d'aller tout à la fois aux manœuvres et en ville, à la bataille et au bal. Est-ce par manque d'imagination dans ce siècle vieillissant ou pour des économies de bout de chandelle que cette mesure fut proposée par le comité technique au ministre qui l'approuva ? Nous n'avons pas la réponse, mais ce lamentable choix qui devait être maintenu jusqu'à la veille de la Grande Guerre sera à l'origine de nombreuses fantaisies. En effet dans la réalité chacun s'était fait confectionner auprès de fournisseurs non agréés par le ministre une seconde collection de tenues de même type, mais qui était réalisée avec des étoffes et des mesures différentes.
Cette nouvelle tunique très courte se portait par dessus le ceinturon. Elle ne fut pas du goût des gendarmes qui très rapidement portèrent en toutes circonstances le révolver et le ceinturon par-dessus la tunique.


D.M. du 10 janvier 1895
Le ministre décide d'équiper les gendarmes en pays montagneux d'un bâton ferré pour les patrouilles qu'ils doivent effectuer en terrain accidenté. Cette décision est suivie d'une note de 9 février qui confirme cette décision et la complète en dotant ces gendarmes de bande molletière et de chaussure spéciales.
Décision ministérielle du 9 juin 1895
Avec cette note, les modifications suivantes sont apportées à la tenue :
Gendarmerie départementale

Habillement
- La tunique : les poches extérieures de la tunique sont supprimées et remplacées par deux poches de poitrine intérieures.
- Les boutons d'uniforme : ils portent la légende : Gendarmerie nationale ; les mots Ordre public sont supprimés.
- Pantalon : Le pantalon en cuir-laine dite à la hussarde est de coupe large et non plus de forme droite comme dans l'ancienne description.
Le pantalon d'été est enfin réglementé. Il est confectionné en coutil treillis est adopté (une note ministérielle du 3 janvier 1896 précisera que ce pantalon pourra être porté par les militaires de la gendarmerie dans les tenues du matin, du jour et de service hors la résidence. En 1905 il sera autorisé dans la tenue de service dans la résidence puis en 1913 pour la tenue de sortie et de travail). - La hongroise prend désormais la dénomination de culotte, sa coupe est revue afin que les cavaliers soient plus à l'aise.
- Les bandes molletières d'une longueur de 2m11 et larges d'environ 0m12, en molleton de laine bleue, sont adoptées pour les pays de montagne, ainsi qu'un bâton ferré à poignée en forme de bec de corbin.
Coiffes
- Le képi rigide des officiers, recevra, en grande tenue, un plumet droit de la forme et des dimensions de celui des officiers d'infanterie, avec olive en argent. Le plumet est rouge pour les officiers subalternes et tricolore pour les lieutenants-colonels et les chefs d'escadron. Les colonels chefs de légion continueront à faire usage de l'aigrette en plumes de héron blanches.
- Le chapeau change de forme, il est abaissé, sa corne arrière redevient verticale. Les cornes avant et arrière s'incurvent davantage dans leurs parties basses au point de former une aile plate et élargie.
- Calotte de corvée : elle est conservée à la gendarmerie seule.
- Le portefeuille de correspondance est en cuir de vache grenée vernie noire, et non plus en cuir fauve.
Gendarmerie de Corse et de Tunisie
Elle a les mêmes effets que la gendarmerie départementale, sauf les exceptions ci-après :
- Pour le service à cheval on continue à faire usage d'un pantalon de cheval garni d'une fausse botte en peau de veau noire.
- Coiffure : elle est équipée du salako, casque en liège, recouvert de coutil, écru pour la troupe, blanchi pour les officiers.
- La banderole de giberne est maintenue pour les deux armes.
- Les officiers sont pourvus d'un porte-cartes.
N.Min. du 23 septembre 1897
Le képi de grande tenue pour la métroplole est semi-rigide. Il s'orne d'une cocarde striée aux couleurs nationales de 45 mm. Les soutaches de grade, la grenade et le galon de pourtour sont semblables à ceux du képi ordinaire. Le pompon se porte incliné à l'avant. En grande tenue, les chefs de légion font usage d'une aigrette de plumes de héron blanches de 120 mm de hauteur. Le plumet droit est tricolore pour les officiers supérieurs, rouge pour les officiers subalternes. Le képi est muni d'une jugulaire en cuir noir de 11 mm de large. Le képi des adjudants se distingue de celui des sous-lieutenants par la soutache du bandeau couleur or.
D.M. du 13 avril 1899
Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes de métropole sont autorisés à faire usage pendant les fortes chaleurs du couvre-képi avec protège-nuque en calicot blanc comme les gendarmes de Corse et d'Afrique.


DÉCRET DU AVRIL 4 AVRIL 1900
Dans ce décret portant règlement sur le service intérieur de la gendarmerie départementale, un chapitre est consacré aux différentes tenues qui sont fixées à six.
- La tenue du matin
- Officiers et adjudants : képi, tunique, pantalon d'ordonnance avec sous-pied, petites bottes avec éperons, ou culotte avec grandes bottes,
- arme à pied : képi, tunique, pantalon, petites bottes,
- arme à cheval : képi, tunique, pantalon avec sous-pied, petites bottes avec éperons.
- La tenue du jour
- Officiers et adjudants : képi, tunique, pantalon d'ordonnance avec sous-pied, petites bottes avec éperons, sabre avec dragonne en cuir,
- arme à pied : képi, tunique avec trèfles et aiguillettes, pantalon, petites bottes, épée-baïonnette, épée pour les gradés,
- arme à cheval : képi, tunique avec trèfles et aiguillettes, pantalon avec sous-pied, petites bottes avec éperons, sabre avec dragonne.

- La tenue de service
- Officiers et adjudants en service à pied : Képi, tunique, pantalon d'ordonnance avec sous-pied, petites bottes avec éperons, sabre avec dragonne en cuir, révolver sur ordres,
- Officiers et adjudants en service à cheval : Képi, tunique, culotte bleue, botte à la Condé, sabre avec dragonne en cuir, révolver sur ordre, ( képi rigide avec épaulette et aiguillettes le dimanche et jour de fête) ;
- arme à pied : képi, tunique avec trèfles et aiguillettes, pantalon, petites bottes, épée-baïonnette, révolver sur ordre ;
- arme à cheval : képi, tunique avec trèfles et aiguillettes, culotte bleue, botte à la Condé, sabre avec dragonne, révolver avec son étui ;
- arme à cheval en service à pied : képi, tunique avec trèfles et aiguillettes, pantalon avec sous-pied, petites bottes avec éperons, sabre avec dragonne,révolver sur ordre.
- La grande tenue
- Officiers et adjudants : Képi, tunique avec épaulette et aiguillettes, pantalon d'ordonnance avec sous-pied, petites bottes avec éperons, sabre avec dragonne à gland d'or pour les officiers ;
- arme à pied : chapeau, tunique avec trèfles et aiguillettes, pantalon, petites bottes, épée-baïonnette, épée pour les gradés,
- arme à cheval : chapeau, tunique avec trèfles et aiguillettes, pantalon avec sous-pied, petites bottes avec éperons, sabre avec dragonne.
- La grande tenue de service
- Officiers et adjudants à pied : grande tenue avec le chapeau à galon d'argent et la jugulaire, sabre avec dragonne à gland d'or pour les officiers (en dehors des prises d'armes, les officiers portent le képi rigide avec aigrette ou plumet) ;
- Officiers et adjudants à cheval : grande tenue avec le chapeau à galon d'argent et la jugulaire, pans de tunique relevés, culotte blanche, bottes à la Condé, sabre avec dragonne à gland d'or pour les officiers, révolver avec son étui ,
- arme à pied : chapeau avec jugulaire, tunique avec trèfles et aiguillettes, pantalon, petites bottes, giberne, épée-baïonnette, carabine, havresac avec manteau roulé par-dessus,
- arme à cheval : chapeau avec jugulaire, tunique avec trèfles et aiguillettes, bottes à la Condé, sabre avec dragonne, giberne, révolver avec son étui, carabine et baïonnette sur ordre.
- arme à cheval à pied : chapeau avec jugulaire, tunique avec trèfles et aiguillettes, pantalon avec sous-pied, petites bottes avec éperons, sabre avec dragonne, giberne, carabine avec épée-baïonnette.
- La tenue de campagne
- Officiers et adjudants montés : képi, bonnet de police, tunique, culotte bleue, grandes bottes, gand de couleur, manteau avec pèlerine mobile à capuchon, révolver et son étui, sabre avec dragonne cuir, ceinturon, porte-cartes ,
- Officiers et adjudants non montés de la garde républicaine : képi, bonnet de police, tunique, pantalon d'ordonnance, brodequins ou petites bottes, gants de couleur, manteau avec pèlerine mobile à capuchon, révolver et son étui, épée avec dragonne, ceinturon, porte-cartes, sacoches,
- arme à pied : bourgeron de toile, capote-manteau, ceinture de flanelle, chemise de flanelle, pantalon bleu, pèlerine, tunique, trèfles et aiguillettes, bonnet de police, képi, brodequins, cravate, ceinturon, étui de révolver avec courroie, giberne-cartouche, havresac, portefeuille de correspondance,
- arme à cheval : bourgeron de toile, ceinture de flanelle, culotte bleue, manteau, chemise de flanelle, pèlerine, tunique, trèfles et aiguillettes, bonnet de police, képi, brodequins, grandes bottes, cravate, ceinturon, étui de révolver avec courroie, portefeuille de correspondance.
C.M. du 29 mai 1900
Le ministre interdit le port du képi dit « Saumur ». Ces képis étaient le résultat des caprices de la mode. Si l'aspect général restait à peu près le même, leurs propriétaires faisaient varier les dimensions des éléments le composant (allongement de la visière, augmentation du diamètre du calot pour l'évaser dans sa partie haute) de sorte que l'excentricité avait fait place à la rigueur.
C'est avec cette interdiction du ministre de la Guerre que se termine l'histoire de l'uniforme de la gendarmerie au 19e siècle. Comme nous avons pu le constater, l'évolution du costume en gendarmerie fut lente et les changements de régime n'apportèrent à l'uniforme de cette arme que de modestes modifications. Cette lenteur était due à plusieurs facteurs, dont celui de l'évolution de la mode dans la société civile sur laquelle était calquée la mode militaire, mais elle était surtout tributaire de l'amélioration des matières en particulier celles des tissus qui n'étaient fabriqués à cette époque qu'avec des fibres naturelles ; au développement industriel dont celui de la chimie avec les problèmes liés à la fixation des teintures et leur tenue dans le temps, l'imperméabilisation des effets, la lutte contre la corrosion des parties métalliques, etc.
Cette transformation dépendait également des découvertes et des progrès de la métallurgie qui entraient pleinement dans la fabrication des armes; elle était évidemment liée au coût que représentent ces opérations de renouvellement. Ainsi toutes les décisions ministérielles concernant le changement des effets d'uniforme n'étaient mises en application que par la voie du remplacement et au fur et à mesure des réformes imposées par la vétusté ou l'usure de l'effet en question. Il fallait enfin perpétuer la silhouette du gendarme dans la mémoire collective et l'histoire du chapeau que l'on modifia pendant plus de deux siècles jusqu'à ne plus avoir d'idée est là pour nous en convaincre.













