- HISTOIRE DU CHAPEAU -

Sous le règne de Louis IX (1226 - 1270), le « chapel » était un mot usité pour désigner une coiffure en général. Sous les règnes suivants, il désignait un accoutrement purement militaire fait de métal. Il figurait déjà comme armure de tête dans une ordonnance de son petit-fils Philippe IV le Bel rendue en 1306. Ce mot y est pris sous l'acception de casque. À cette époque le mot chapeau du latin « caput », la tête, était plutôt un terme générique que spécial.
Sous le règne de Charles VI le Bien-Aimé, le chapeau commença à remplacer le chaperon dont l'origine remontait aux premiers temps de la monarchie française. Ainsi, pendant plus d'un siècle on nomma chapeau des éléments de tête qui n'avaient rien à voir avec la coiffure à laquelle on donne de nos jours le même nom.
Le chapeau à roue

La mode du chapeau bourgeois venait d'Angleterre et y régnait depuis le quatorzième siècle. La noblesse française lui emboîta le pas et commença à porter cet ornement de tête relevé de plumes et de franges. La noblesse française, devant au roi le service des armes, le chapeau fut naturellement introduit dans les armées au cours du quinzième siècle et la troupe, à l'imitation de ses capitaines, fit sien ce nouvel attribut au fur et à mesure de l'abandon des éléments de l'armure et notamment du casque de métal. Ainsi, les arquebusiers quittèrent le chaperon pour le chapeau à roue (le chapeau rond).
Le chapeau à roue était une coiffure à forme haute et en entonnoir. Ses bords nommés volants s'abaissaient ou se relevaient à volonté. Le chapeau fut d'abord orné d'une plume quelquefois debout, mais le plus souvent couchée. Après les arquebusiers, se furent les mousquetaires qui en prirent l'usage, d'autres, comme les piquiers, conserveront leurs casques de fer jusqu'à leur abolition. Sous le règne d'Henri IV, les troupes commencèrent à le désigner sous le nom de « feutre » en référence à sa matière.
le chapeau de feutre

Au début du règne de Louis XIII, le chapeau de feutre était à bords ronds légèrement relevés dont la forme se situait à mi-chemin entre le chapeau breton et le chapeau de curé. Lorsqu'en 1690 parurent les premières ordonnances de Louvois créant l'uniforme, l'armée française presque tout entière en portait un. Il devint un élément de la tenue. Il se portait souvent relevé du coté gauche et le bord retroussé était fixé à la calotte par un nœud de ruban (qui sera transformé plus tard en cocarde), souvent aussi les bords étaient relevés des deux cotés ou en pointe sur le devant.
Ce chapeau allait suivre les modes. Vers 1680, il commença à abaisser sa forme et à prendre trois cornes lâches et plutôt plates. Les officiers français devaient faire preuve de beaucoup d'astuces dans la manière de maintenir ce petit élément sur leur vaste perruque.
Le chapeau à quatre cornes

Dès le début du XVIIIe siècle, les bords du chapeau allaient être relevés tout autour et fixés à la calotte par quatre points. Les quatre bords ainsi relevés formaient entre eux quatre godets ou quatre cornes, d'où le nom de chapeau à quatre cornes. Cependant, il n'était pas désigné à cette époque sous cette appellation, mais sous celle de chapeau rond, car le bouton fixé sur son sommet permettait de relever un ou plusieurs côtés.
En réalité, ce chapeau ayant prêté au ridicule n'eut bientôt plus que trois cornes. La corne arrière fut plaquée contre la calotte, ce qui entraînât le recul des cornes de droite et de gauche. Le chapeau devint vite un tricorne avec une corne en avant et une partie plate à l'arrière. Peu à peu, le chapeau cessa d'être souple. Les attaches disparurent de la calotte et les bords furent raidis et formés afin qu'ils tiennent seuls. Ce tricorne quelques fois appelé « lampion » fut porté de 1725 à 1775.
Le bicorne

En 1755, le chapeau prit du volume. Pour lui donner une autre esthétique, les chapeliers le fabriquèrent avec des bords inégaux. Ainsi lorsqu'ils étaient repliés vers la calotte les cornes de droite et de gauche s'allongeaient ou s'abaissaient et prirent alors le nom « d'ailes ». La corne arrière fut entièrement aplatie contre la calotte qui à son tour prenait le nom de « forme » et la dépassait légèrement. À l'inverse, la corne avant diminuait de volume. Ce nouveau modèle correspondait mieux au règlement de 1786.

La révolution conserva l'allure générale du chapeau, mais lui donna plus d'ampleur en élevant davantage ses cornes et en allongeant ses ailes. Sa fabrication en feutre rigide était abandonnée pour être à nouveau confectionnée en feutre souple. Cela imposait de fixer ses bords à la forme pour assurer son maintien.
Le relèvement de la corne plate de l'arrière fut assuré par deux fixations assez approchées tandis que celle de devant, pour lui conserver sa forme en godet, fut maintenue par deux points assez écartés. Ce façonnage permettait de former de chaque côté, deux longues ailes. Ce modèle de chapeau fut produit avec de nombreuses variantes. Ainsi, le modèle des troupes de l'infanterie était plus large, celui des officiers avait une forme plus haute. La maréchaussée adopta au même titre que les autres troupes, la variante du chapeau qui était alors en usage dans la cavalerie.

À sa création en 1791, la gendarmerie nationale reçut un chapeau de modèle haut, bordé d'un galon d'argent et porté en bataille (c'est-à-dire les ailes parallèles aux épaules).
C'était celui prescrit par le règlement élaboré par le général Wirion, en l'an VIII, pour la gendarmerie des quatre départements nouvellement conquis sur la rive gauche du Rhin (la Roër, Rhin-et-Moselle, Mont-Tonnerre et Sarre). Il servit de modèle pour toute la gendarmerie nationale.
Il y eut cependant quelques variantes dans sa forme. Tout en conservant l'aspect général du chapeau prescrit par Wirion, certains modèles présentaient des ailes plus longues, était le plus souvent sans galons ce qui permettait de les porter en colonne (c'est à dire les ailes perpendiculaires aux épaules) ; mais ces modèles furent abolis sous le directoire.

Sous le 1er Empire, le modèle général du chapeau dérivait directement de celui de la révolution. Il était assez rigide et se différenciait de son prédécesseur par la courbure des deux bords formant la corne arrière. Cette modification de courbure s'appliquait depuis la pointe des deux ailes jusqu'au sommet. Jusqu'alors convexe, elle devint concave dans sa partie basse, se qui eut pour effet de diminuer la largeur arrière du chapeau et de le faire paraître plus haut
Ce nouveau chapeau fut toujours porté en bataille en gendarmerie contrairement aux autres armes qui le portaient tantôt en bataille, tantôt en colonne, tantôt de guingois, tantôt de quart en coin.
À la fin de l'empire, le chapeau devint de plus en plus rigide et ses deux cornes s'inclinèrent de plus en plus vers les épaules. C'était la forme dite « demi-claque ».

La restauration, voulant marquer sa différence, abandonna ce modèle, mais elle ne fut pas pour autant en mesure d'élaborer une forme particulière qui aurait pu trancher avec la précédente. Son modèle 1819 différait peu de celui du type de l'Empire et n'avait pour seule différence de voir ses cornes relevées. La Restauration créa un chapeau dit de deuxième tenue, plus petit que celui de la grande tenue et dont les bords étaient dépourvus de galon. Il fut porté de 1819 à 1826.
Le 22 septembre 1826, sous le règne de Charles X (1824 - 1830) parut un règlement qui fut à l'origine du modèle de chapeau le plus haut porté en gendarmerie. Celui-ci ne mesurait pas moins de 27 centimètres de hauteur arrière. L'aile avant perdit sa forme en godet et se retrouva presque aussi plate que celle de derrière. Cette nouvelle ligne fit perdre au chapeau son volume et le pourvut d'ailes de 14 centimètres à partir de la forme.
Peu de temps avant l'abdication de Charles X, une circulaire ministérielle en date du 13 juillet 1830 prévoyait d'apporter quelques modifications à l'uniforme de la gendarmerie et d'équiper ses personnels d'un chapeau imperméable de modèle piqué. Ce chapeau ne vit le jour qu'après l'avènement de Louis-Philippe Ier(1830 - 1848) et fut adopté par le règlement du 8 septembre 1830.

Ce texte décrivait les modifications du chapeau de la manière suivante : « La bordure du chapeau en galon d'argent est supprimée. Il y sera substitué un galon noir en poil de chèvre uni. La corne du devant et la partie relevée du derrière seront ornées chacune de quatre passants en galon d'argent à cul-de-clé suivant le modèle qui sera adopté. » Sa fabrication fut confiée à un maître chapelier parisien.
Un autre règlement du 18 avril 1836 modifia légèrement le chapeau de 1830 en abaissant simplement la hauteur de la corne de devant, en diminuant un peu la longueur des ailes et en augmentant la cambrure. Il faut entendre par cambrure la différence de niveau entre le bout des ailes et le bord inférieur du milieu du chapeau soit devant, soit derrière. Confectionné en feutre, il conserve le galon en poil de chèvre, les huit passants en galons d'argent, tissu à cul-de-clé ainsi que la ganse en argent avec sa raie noire centrale et son bouton d'uniforme cousu au bord de la calotte.

Une décision ministérielle du 26 août 1844 modifiait sensiblement l'aspect de la coiffure. Elle diminuait la hauteur du chapeau de trois centimètres, mais surtout en réduisait considérablement sa cambrure. Une jugulaire mobile était rajoutée à ce nouveau chapeau. Quatre crochets disposés en croix et fixés à l'intérieur et au fond du chapeau permettaient de le porter tantôt en colonne tantôt en bataille. Cette possibilité ne fut guerre utilisée.
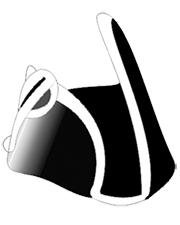
Les règlements antérieurs du 5 février 1819, du 22 septembre 1826 et du 18 avril 1836 interdisaient aux gendarmes de porter le chapeau en colonne. Ils précisaient « pour que le chapeau soit bien placé, le bouton doit être au-dessus de l'œil gauche, le côté droit légèrement incliné vers la droite. »
Le règlement du 21 août 1846 modifia totalement l'aspect du chapeau. S'il en conservait les dimensions, il en changeait la forme. D'une part, il rétablissait le galon d'argent de bordure et supprimait les passants ; d'autre part, la forme de la corne du devant changeait et devenait plus volumineuse. La forme du chapeau était à nouveau dite « à trois cornes ». L'aspect plat de la corne de devant apparue sous l'empire et en usage depuis le règlement de 1826 disparaissait. La courbure de la corne avant redevint très nette et ses deux bords s'incurvaient à nouveau dans le bas pour atteindre le bout des ailes qui s'élargissaient.
À compter de ce règlement, le chapeau ne subit plus que des modifications légères.
Le règlement de 1854 se borna à allonger simplement les ailes et réduire la largeur de la partie relevée de l'arrière ; ceux de 1857 et de 1871 portant sur l'uniforme de la gendarmerie n'apportèrent aucune modification au chapeau. Celui du 17 août 1885 diminua la hauteur de la forme, ce qui eut pour effet d'incliner davantage la partie relevée de la partie arrière vers l'avant. La cambrure fut également réduite.

Le règlement du 9 juin 1895 qui modifia en profondeur la traditionnelle grande tenue de la gendarmerie à cheval, diminuait à son tour le chapeau en abaissant sensiblement la hauteur des cornes avant et arrière et en remodelait sa forme. La partie relevée arrière redevint verticale et ses bords s'incurvèrent de plus en plus dans sa partie basse.
Si dans l'imagerie populaire le prestige du bicorne demeure lié à la gendarmerie, il ne pouvait subsister dans un siècle ou l'électricité avait remplaçait les becs de gaz et où les premières automobiles commençaient à disputer la rue aux fiacres et autres véhicules hippomobiles. C'est sans regret que les gendarmes abandonnèrent définitivement le chapeau pour le képi bien plus léger et plus pratique. Ainsi, après avoir subi toutes les transformations de la mode militaire, le règlement du 21 mars 1904 mettait un point final à cette aventure et supprimait tous les accessoires qui nous attachaient à la tradition de ce siècle.
Ainsi disparaissaient
- de l'habillement : le chapeau, la culotte blanche, les bottes de Condé ;
- de l'équipement : le baudrier de giberne ocré et du harnachement : les chaperons(1) et fontes de parade.
(1) Terme de sellier pour désigner les pièces de cuirs qui couvrent les fourreaux de pistolet pour les protéger des intempéries.