- HISTOIRE DE L'UNIFORME -
Composé des mots latins « unus », un et « forma », la forme, c’est-à-dire qui a une seule et même forme, l’origine de l’uniforme est relativement récente dans les armées. Son adoption s’imposa au fur et à mesure que l’organisation militaire reçut plus de consistance et de régularité. Cependant, l'uniformité des troupes mettra du temps à s'imposer dans les idées et dans la pratique. Malgré tout, elle s'imposa dans les armées dès lors que les différents États de l'Europe décidèrent à faire eux-mêmes les levées et à entretenir des troupes permanentes.
Le ministre Louvois fut le premier à régler les uniformes. Le comte d'Argenson s'appliqua à apporter de l'ordre dans l'habillement et fixa les mesures des habits des soldats à raison d'une taille moyenne. Il donna un uniforme aux généraux, décida de l'uniforme des artilleurs et imposa que l'habillement des troupes soit divisé en grand et petit ordinaire (grande et petite tenue). Grâce à une poigne de fer, il imposa l'uniforme qui peu à peu s'enracina dans les traditions du pays au point que son existence ne fût jamais remise en cause, malgré les différentes variations que cet attribut ait pu subir.
Nous développerons dans ce dossier quelques notes historiques pour permettre au lecteur de mieux appréhender les circonstances dans lesquelles l'uniforme a subi des transformations majeures.
Les casaques d'armes
Avant sa mise en place, la tenue variait suivant les régiments (1). Les chefs et les soldats adoptaient en temps de guerre l’habit qui convenait le mieux à leur goût, à leurs habitudes.

Pour se distinguer, chaque colonel adopta la couleur de son blason. Les plumes, les nœuds, les rubans se multipliaient sur le costume de l’officier et du soldat selon leur fortune, leur caprice et leurs succès féminins. Toutes ces superfluités n’avaient aucune utilité pratique et n’étaient conservées que par le culte du souvenir. Ces ornements participaient à flatter le soldat (et pas seulement) lui garantissant une certaine fierté à les porter, mais également une obligation morale d’accomplir pleinement son devoir afin de ne pas les déshonorer. Certains chefs pouvaient arborer des tenues parfaitement remarquables au risque de présenter une cible potentielle sur un champ de bataille, mais permettaient aux soldats d’avoir un point de repère dans la bataille. On se souvient d’Henri de Navarre et de son fameux « ralliez-vous à mon panache blanc » avant la bataille d’Ivry qui eut lieu le 15 mars 1590.
À défaut d’un uniforme leur permettant de se distinguer, les corps militaires des nations en conflit usaient de signes de reconnaissance. Ainsi les Français marquaient leurs vêtements d’une croix blanche, mais ils n’étaient pas les seuls. La différence se faisait alors sur d’autres éléments de l’habit. Une différenciation aussi peu tranchée produisait souvent la confusion dans les rangs et les cornettes et autres étendards étaient de peu de secours. Ainsi, la tenue des soldats se bornait à des signes de convention qui ne s’étendaient même pas jusqu’à la casaque. Seules, les compagnies d'ordonnance créées sous Charles VII se distinguaient des autres troupes, car les gendarmes qui les composaient étaient entièrement équipés d'une armure par-dessus laquelle ils portaient une cotte d'armes à la couleur de leur capitaine.
Une ordonnance de 1549 régla la tenue des Hommes d’armes et archers, leur armure et leur équipement. Ainsi, « Ledit homme d'armes sera tenu de porter armet, petit et grand garde bras, cuirasse, cuissots devant de grèves avec une grosse et forte lance et entretiendra quatre chevaux les deux de service pour la guerre dont l'un aura le devant de barde avec le champfrain et les flançais et si bon luy semble aura un pistolet à l'arçon de la selle. L'archer portera pour l'habillement de teste bourguignonne, cuirasse, avant bras, cuissots et la lance et aura et entretiendra deux chevaux l'un de service pour la guerre portant le pistolet à l'arçon de la selle ». C'est donc peu après le début du dix-septième siècle que les combattants furent armés et vêtus d’un casque en fer, appelé salade ou bassinet, d'un bouclier, d'une casaque de peau de buffle, d'un pourpoint en toile rembourré de laine ou de coton (c’était le hoqueton), auquel on ajoutait quelquefois une cotte de mailles ou brigantine.
Les écharpes
Les casaques, qui servaient de marque de reconnaissance grâce à leur couleur ayant disparu, furent remplacées par des écharpes (2) de couleur. L’usage de ce signe distinctif datait de Saint-Louis (3). À cette époque, le port de l'écharpe tenait plus de la coutume chevaleresque que du règlement militaire. Ces étoffes, principalement blanches, que les chevaliers ceignaient sur leur poitrine, leur rappelaient l'engagement qu'ils avaient formé pour leur dame lorsqu'ils recevaient d'elle l'honorable distinction. En flattant leur orgueil, ces écharpes étaient un puissant moteur d'honneur et de bravoure.

Cette coutume, fondée sur la galanterie et la vanité, se révéla d'être d'une certaine utilité lorsque les chevaliers servirent en grand nombre. On reconnut que, dans l'enchevêtrement des batailles, il manquait aux armures de fer une marque permettant de distinguer les chevaliers et, par ce motif, cet ornement galant fut transformé en un signe de ralliement. Apparurent alors au XIIIe siècle les écharpes aux couleurs convenues. La France conserva le blanc suivant la coutume chevaleresque, bien que la couleur royale était le pourpre de l'oriflamme, mais dans un royaume où la puissance des vassaux disputait sans peine celle de la couronne, le blanc fut choisi comme couleur d'alliance entre chevaliers des diverses provinces. Peu à peu cette marque distinctive fut portée aussi bien par les officiers que par les soldats. Avec la création des compagnies d'ordonnance, sous Charles VI, l'écharpe cessa d'être blanche. Encore en usage sous Louis XI, elle fut abandonnée sous Louis XII et François Ier.
Pourtant, l'écharpe revint à la mode sous Henri II et remplaça dans l’uniforme l’usage des casaques. L’écharpe se mettait sur la cotte d’armes ou par-dessus l’armure, suivant le caprice du moment ou l’époque. Son usage perdura et fut longtemps le seul signe d’uniforme. Henri II imposa aux compagnies d'ordonnance une deuxième écharpe en bandoulière, l’une à droite, l’autre à gauche. La première était l'emblème de la couronne, la seconde était aux couleurs du capitaine de la compagnie. Charles IX et Henri III portaient l'écharpe rouge tandis que les huguenots et leurs chefs la portaient blanche. En 1591 les ligueurs la portaient noire.
Chaque nation avait également sa couleur, celle des Anglais et des Savoyards était bleue, celle des Espagnols : rouge, celle des Hollandais : orange, celle des Autrichiens : noire et jaune, etc.
Après la paix de Ryswick signé en septembre 1697, on s'interrogea sur l'utilité de cet effet. On reconnut que l'écharpe était devenue une décoration sans objet, coûteuse, embarrassante, voire même, dangereuse dans la mêlée. On n'en fit plus usage dans la guerre de 1701, comme le prouvent les ordonnances des troupes françaises. En 1695 et en 1703 elle fut entièrement abolie dans l'infanterie qui depuis avait adopté le fusil et dont les soldats étaient désormais ceints de la bandoulière soutenant la giberne. L'uniforme, qui caractérisait désormais beaucoup mieux les troupes françaises la rendit définitivement caduc.
Son souvenir fut cependant conservé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans la couleur que l'on donna aux bandoulières. Ainsi, les compagnies de gens d'armes et de chevaux légers avaient pour se distinguer des bandoulières violettes, vertes, aurore, rouges, jonquille ou bleues, les Cent Suisses avaient leurs bandoulières de peau blanche frangée de soie rouge, bleue et blanche. Les bandoulières des gardes de la porte étaient à carreaux d'or et d'argent, celles des gardes du corps étaient, pour la première compagnie, à carreaux de soie blanche et d'argent, pour les trois autres à carreaux de soie verte, de soie bleue et de soie jaune et d'argent. On les porta jusqu'en 1830.
Le hoqueton
À ces époques, l'uniforme proprement dit n'existait pas. L'état ne fournissait pas d'habillement aux troupes et chacun s'habillait à peu près à sa guise. L'uniformité s'obtenait naturellement par la position sociale des individus. La draperie de luxe, les soies, les broderies d'or ou d'argent étaient réservées à ceux qui avaient les moyens de se les offrir les nobles et les bourgeois. Cette richesse s'accompagnait le plus souvent d'une grande variétés de modèles répondant aux goûts ou aux caprices de leurs destinataires ou de la mode du moment. Ceux qui n'entraient pas dans cette catégorie de gens fortunés devaient se contenter de la draperie courante qui comptait de trés nombreuses fabriques dans le pays. C'est avec ce drap grossier aux couleurs limitées, que les tailleurs confectionnaient des vêtements correspondant aux formes habituellement en usage dans chaque profession suivant les modèles imposés par les coutumes régionales et de l'époque. La paysannerie, qui représentait l'essentiel de la population française, était ainsi vétue d'effets qui, par ses formes et ses couleurs, devait avant tout permettre à celui qui les portait d'accomplir avec commodité son ouvrage. Ces habits du quotidien étaient donc très similaire parmi la population. Ainsi, la troupe principalement recrutée au sein de la population campagnarde se trouvait-elle habillée d'une manière presque uniforme, tandis que les officiers, issus uniquement de la noblesse, faisait montre d'extravagance en revêtant des habits de grande facture et richement décorés.
On retrouve cependant le premier élément d'uniforme dans les anciennes ordonnances concernant les compagnies d'ordonnance (4). Les hommes d'armes, archers, coustiliers et pages de ces unités avaient l'obligation de porter le hoqueton à la devise de leurs capitaines. Cette mesure avait été ordonnée, non pas dans un souci d'uniformisation vestimentaire, mais à des fins d'identification. En effet, les rois voulaient absolument éviter que les hommes enrôlés dans cesCornette vers 1590 vêtu de son hoqueton compagnies et donc soldés par la couronne, se livrassent au pillage, vol et autres crimes en profitant de leur équipement militaire et de leur expérience acquise au combat.

Ainsi, dans une ordonnance du 20 janvier 1514 (5), François Ier ordonnait « que les capitaines desdits gens de guerre fassent toujours porter à tous archers, coustilliers et pages de leurs compagnies, hoquetons à leur devise tant à la ville qu'aux champs » et pour faciliter leur identification, le roi exigeait que « la livrée de chacun capitaine [soit] envoyée par les seneschaucées et bailliages à fin que quand ils feront les maux que l'on puisse cognoistre de quelle compagnie chacun sera pour en faire reparation ». Ceux qui espéraient passer outre cette obligation et se faisaient arrêter sans leur livrée étaient remis aux officiers de justice du lieu pour être jugés « comme gens vagabons et sans adveu ». Quant à ceux qui changeaient leur hoqueton pour celui d'une autre compagnie, il s'exposait à être « privé des ordonnances dudit seigneur pour l'avoir changé et s'il le fait pour un cas criminel, il sera executé par justice ».
L'obligation du port des saies et hoquetons à la livrée et couleurs de leurs capitaines fut réitérée dans les règlements concernant la gendarmerie du 12 janvier 1533 (6) et du 4 janvier 1545 (7).
Son fils Henri II confirma cette exigence en 1547 (8), en précisant que ceux qui s'y soustrairaient s'exposaient à être punis de mort. Dans une nouvelle ordonnance de novembre 1549 (9), il maintenait cette obligation pour les hommes d'armes et archers des compagnies. Cependant, l'orgueil des capitaines avait rendu ces vêtements coûteux par la qualité des tissus utilisés et l'ajout de divers ornements, le roi décidait alors qu'ils seraient désormais en drap simple, bordés d'une simple bande de velours ou de soie.
Dans son ordonnance du 12 février 1566 (10), Charles IX réaffirmait cette directive et déclarait que ceux qui ne la respecteraient pas seraient châtiés corporellement. En février 1574 (11), il renforçait ces dispositions en spécifiant qu'à défaut d'être vêtus de leurs saie ou hoqueton, les gens d'armes « ne pourront loger en aucunes maisons des lieux où ils passeront». C'était une remarquable mesure incitative à une époque où les compagnies étaient itinérantes et logeaient chez l'habitant à chaque étape. Ces vêtements, qui demeuraient à la charge de chaque homme d'armes, continuaient d'atteindre des prix exorbitants à cause des prétentions de leur capitaine qui les voulaient toujours plus brillants. Reprenant une prescription de son père sur leur coût, Charles IX décidait de fixer leur prix maximum à quarante livres tournois pour les hommes d'armes et à trente livres pour les archers. À charge pour les capitaines de payer sur leurs deniers le surplus de ces sommes si leur vanité ne s'en satisfaisait pas.
Parvenu à la couronne, Henri III, dans une ordonnance de février 1584 (12), perpétua l'obligation du port des saies et hoquetons à la livrée des capitaines pour les soldats des ordonnances. Il reprit les dispositions de ces prédécesseurs sur le coût de ces vêtements en fixant un prix maximum pour les hommes d'arme et archers. (* voir les extraits de ces ordonnances)
Ainsi, le port du premier effet d'habillement uniforme du soldat était avant tout une mesure de police destinée à maintenir dans le droit chemin les hommes d'arme et archers des compagnies d'ordonnance. En étant parfaitement identifiable, le risque de pillage et violences commis contre les populations était réduit au mieux. Pour les plus hardis, les peines les plus sévèrent étaient là pour leur rappeler à quel sort leur entreprise téméraire les destinait. On peut voir ici les prémices de ce qui sera plus tard l'uniforme. Cette mesure fit déjà apparaître un phénomène qui nuiera beaucoup aux troupes, la mégalomanie des capitaines. Ainsi, pour satisfaire leur orgueil, ces officiers n'avaient pas hésité à faire de ces simples saies et hoquetons des objets de valeur en parfaite contradiction avec leur simple fonction d'identification. Cette complaisance vaniteuse s'appliquera plus tard sur les autres parties des vêtements du soldat et du cavalier. Elle devra encore être fermement combatue par la couronne jusqu'à ce qu'elle se décide à financer elle-même les uniformes et interdise aux officiers de les modifier sous peine de sanctions.
Les chevaux légers (13) avaient eu la casaque de la couleur de la cornette, la cavalerie légère (13), vers 1639, portait à peu près uniformément le chapeau à plumes, le justaucorps de buffle avec la cuirasse, la culotte bouffante et les bottes à entonnoir. C'était une mesure générale pour la cavalerie régulière, mais rien n'existait pour l'infanterie (14).
(1) Le régiment d'infanterie est un corps de troupe commandé par un colonel ou mestre de camps et composé de plusieurs compagnies commandées par un capitaine. C'est Henri II qui institua en 1558 ces corps qu'il désigna d'abord sous le nom de légion. Les régiments de cavalerie, institués en 1635, étaient des corps composés de deux à quatre escadrons subdivisés chacun en quatre compagnies.

(2) écharpe du latin ex carpo, couper, détacher de.
(3) Le plus souvent ces étoffes se portaient en bandoulière sous l'armure, mais elles furent portées dessus, sur l'habillement ce qui est à l'origine du verbe s'écharper pour désigner une lutte.
(4) Les compagnies d'ordonnance ont créées par Charles VII. Elles sont à l'origine de l'armée de métier. Chaque compagnie était alors commandée par un chef auquel on donna le nom de capitaine (cap : la tête, celui qui est à la tête). Il était secondé par un lieutenant, un enseigne, un guidon et un maréchal des logis. La compagnie comprenait 100 lances. Chaque lance était composée de 1 homme d'arme ou maître armé de pied en cap (des pieds à la tête), de 3 archers, 1 coutilier et 1 page tous armés et montés à la légère. Une compagnie de 100 lances présentait donc un effectif de 600 hommes à cheval. Les diverses campagnes menées par Louis XII et François Ier devaient amener de profondes modifications dans la constitution générale de l'armée et dans l'organisation particulière de la cavalerie face aux troupes étrangères.
(5) Lettres patentes publiée le 20 janvier 1514 à La Ferté-sous-Jouarre, portant règlement sur la gendarmerie (nom donné aux compagnies d'ordonnance).
(6) Règlement concernant la gendarmerie du 12 janvier 1533.
(7) Règlement concernant la gendarmerie du 4 janvier 1545.
(8) Ordonnance donnée à Saint Germain en Laye en décembre 1547
(9) Ordonnance du 12 novembre 1549 donnée à Paris, portant règlement pour la levée, l'entretien et la police des gens de guerre, ainsi que pour le paiement et l'augmentation de leur solde.
(10) Ordonnance du 12 février 1566 donnée à Moulins concernant les hommes d'armes, les payeurs, commissaires et contrôleurs des guerres.
(11)Ordonnance donnée à Saint-Germain-en-Laye le 1er février 1574.
(12)Ordonnance donnée à Saint-Germain-en-Laye le 9 février 1584.
(13)La cavalerie est issue des compagnies d'ordonnance créées par Charles VII. Elle fut créée lorsqu'on sépara les archers et les coutiliers des hommes d'armes pour former des compagnies particulières qui furent désignées collectivement sous le nom de cavalerie légère. Placés sous le commandement du lieutenant et du guidon, les archers et coutiliers commencèrent à combattre à part sous leurs propres cornettes. Louis XII appuya cette séparation qui se concrétisa par la création de deux types de troupes. Celle des hommes d'armes ou de gens d'armes qui, par tradition de la chevalerie, formèrent une troupe réservée aux nobles et privilégiées sous le nom de gendarmerie et la cavalerie légère qui ouvrit largement ses rangs aux aventuriers de toutes les classes et par conséquent à la roture.
Alors que la poudre et les idées nouvelles faisaient disparaître les lourdes armures et des lances, les archers, coutiliers et pages continuèrent à se défaire de leurs états pour devenir à leur tour maîtres dans les compagnies de cavalerie légère. Cette troupe fut définitivement séparée des compagnies d'ordonnances par Henri II qui, dans son ordonnance du 20 décembre 1549 la plaça sous la direction d'un colonel général. Les gendarmes demeurèrent sous le commandement immédiat du roi et y furent maintenus pour devenir ce que l'on appela plus tard : la maison du roi et des princes.
(14) Corps de soldats qui combattent à pied, que l'on nomme fantassin. De l'italien fantassino, de fante, garçon qui sert à pied. Ce mot a été rapporté de l'Italie sous le règne de François Ier ou son fils Henri II et substitué à piéton qui servait jusqu'alors à désigner les combattants à pied.

Les progrès en matière d’armement avec l’apparition de l’arme à feu et plus particulièrement de l’artillerie eurent raison de l’armure. Du jour où les troupes cessèrent de la revêtir, elles présentèrent le spectacle ridicule d’une armée bigarrée de mille couleurs différentes selon le goût fastueux ou le caprice des princes. L'idée d'un habit uniforme se répandit dans toutes les armées à mesure que les différents États de l’Europe se décidèrent à faire eux-mêmes les levées et à entretenir des troupes permanentes. Les guerres, menées par des armées composées de milliers d’hommes, démontrèrent la nécessité de reconnaître sur le champ de bataille les différents corps engagés. Les temps de paix permirent aux uns et aux autres de s'inspirer des trouvailles développées dans les autres armées, de les améliorer ou de carrément les adopter.
Le corps des grenadiers de Brandebourg présenta le premier uniforme complet sur lequel les autres nations prirent modèle. Il avait été réglé par Frédéric Ier, devenu roi de Prusse. C'était un costume constitué d'un justaucorps et d'une veste bleue assez ample avec les parements de même couleur, garnis de boutons jaunes, d'une doublure rouge. Les grenadiers étaient coiffés d'un chapeau en drap ou court bonnet à la catalane, portaient des bas et cravates rouges pour les soldats, et des bas noirs et cravate blanche pour les officiers. Ils étaient chaussés de souliers montants.
Néanmoins, ces habits hauts en couleur et richement galonnés furent ramenés à des proportions plus modestes par les autres États. La France devait opter pour un uniforme au caractère plus strict et dont la coupe devint invariable dans chaque corps. Les premiers effets d'habillement qui allaient être utilisés dans notre armée ne différaient guère quant à la coupe du costume civil.
En France, la couronne confrontée au problème de l'entretien d'une armée de 200 000 hommes se préoccupa avant tout d'alléger ce fardeau et de diminuer cette énorme dépense. La tâche était délicate et il s'en rajouta une autre et non des moindres, celle de faire vivre en bon ordre ces régiments dans les garnisons qui leur avaient été assignées. La discipline et la police des ordonnances ne pouvaient avoir leur plein effet qu'à la condition de verser au soldat une solde lui permettant de vivre sans avoir recours au vol et au pillage des populations. La paie était modique et comme l'indique l'ordonnance du 20 juillet 1660 elle était versée pour toute solde, le roi ne fournissant que le pain de munition et le fourrage. Les soldats étaient donc tenus à cette date de se vêtir eux-mêmes.
C'est après la paix d'Aix-la-Chapelle, conclue en 1668 avec l'Espagne, que la France adopta graduellement l'uniforme.

Avant cette date, les anciennes ordonnances se préoccupaient principalement de la solde, de la composition des compagnies, de l'ustensile (1), des fourrages, etc., mais n'avaient jamais abordé le sujet de l'habillement. Comme nous l'avons montré dans le dossier concernant le financement des uniformes, cette question ne se posait pas, car les enrôlements étant faits pour une courte durée (trois ans), pour une ou deux campagnes, il n'y avait pas lieu dans ces conditions de se préoccuper de l'habillement proprement dit du soldat qui, une fois enrôlé, continuait à porter son habillement personnel. Cependant, les vêtements s'usaient et il fallait bien les remplacer. Cette opération était à la charge du soldat dont la solde devait lui permettre de se nourrir et se vêtir. La mauvaise gestion que faisaient les hommes de leur solde et son versement par fraction de dix jours avait obligé la plupart d'entre eux à demander des avances à leurs capitaines qui retenaient sur les prêts suivants le montant avancé. Les abus réalisés par des officiers cupides à l'égard de ces retenues obligèrent la couronne à se saisir du problème. L' ordonnance du 21 avril 1666 (pdf) leur interdit de pratiquer des retenues « sous prétexte de fourniture d'habillement, chaussure, ou pour quelques autres causes que ce soit ». Cependant, ces avances étant devenues incontournables, Louvois n'eut d'autre choix que d'en accepter la pratique. Six mois plus tard, dans une ordonnance du 5 décembre 1666 (pdf), il faisait volte-face et réglementait le procédé pour contenir non seulement les abus de ses officiers, mais aussi par crainte que ce défaut d'entretien « réduiroit insensiblement les troupes dans la dernière misère ; les mettroit hors d'état de pouvoir rendre aucun service ».
Si le vêtement restait à la charge du soldat et du cavalier, son financement n'était plus soumis à la comptabilité plus ou moins douteuse des officiers qui faisaient les avances. Désormais, 30 sols étaient retenus légalement sur la solde des cavaliers et soldats pour être employés en « habillemens, chaussures et autres necessitez desdits cavaliers & soldats & à la remonte desdits cavaliers ». C'était une sorte d'épargne obligatoire qui restait la propriété du soldat et lui permettait de disposer des fonds nécessaires pour l'achat d'effets vestimentaires sans avoir recours aux avances faites par les capitaines.
Cette première mesure officielle sur l'habillement demeurait néanmoins dans la continuité de ce qui s'était toujours pratiqué. Certes, on assurait au soldat d'avoir la ressource financière pour lui permettre d'acheter ses vêtements, mais le choix de la forme et de la couleur lui appartenait toujours. Si, l'idée d'un habit uniforme avait progressé au sein des armées, son adoption définitive devait encore se heurter à quelques obstacles, dont celui du libre choix de disposer de sa solde. En effet, la couronne s'était toujours déchargée sur le soldat de son entretien et de son alimentation en lui versant une solde. On exigeait simplement de l'homme enrôlé qu'il soit en état de servir sous les armes.
Quelques colonels plus fortunés avaient cependant commencé à habiller tout leur régiment d'effets uniformes, mais cette initiative avait été menée dans le but de leur assurer un certain prestige. Louvois utilisa avec habileté la fatuité des chefs de corps pour les encourager à poursuivre dans cette voie. Il exacerba leur amour-propre, en exigeant notamment des régiments étrangers au service du royaume et dont les appointements étaient plus élevés qu'ils aient une tenue uniforme. En 1669, à Dunkerque, il passa en revue le régiment allemand de Fürstenberg dont les soldats étaient tous vêtus d'un habit bleu à doublure jaune. Humiliés par la comparaison de leurs troupes avec les troupes étrangères, les colonels et les capitaines français suivirent peu à peu leur exemple et, sans être prescrit, l'uniforme devint pour chacun une obligation volontaire. L'orgueil et la vanité réussirent mieux que n'auraient pu faire les ordonnances les plus sévères.

Louvois, grand-maître de la lutte contre la corruption, de la méthode et de l'obéissance, connaissait la puissance morale de l'uniforme. S'il devait permettre aux chefs de distinguer leurs hommes, il n'en était pas moins un moyen efficace pour lutter contre les désertions et assurer l'ordre et la discipline (2).
L’uniformité des troupes mettra cependant du temps à s’imposer dans la pratique. Les colonels, propriétaires de leurs compagnies, continuaient d’habiller leurs soldats comme ils l’entendaient. Ainsi, à l’image du maréchal d’Ancre et des cardinaux Mazarin et Richelieu, qui avaient donné leur livrée à leurs gardes, plusieurs colonels propriétaires avaient donné la leur aux régiments qu’ils commandaient. Pour les autres, l'uniforme se résumait à habiller leurs soldats avec les mêmes types de vêtements utilisés à cette époque et qui consistaient en un habit à larges basques, une veste ample et un feutre à bord rond.
Le sol retenu sur la solde des cavaliers et soldats permettant désormais de remplacer l'habillement sans trop de difficultés, on put passer à l'étape suivante qui consista à ôter aux bénéficiaires le choix de leurs effets. Cette décision ne fut pas acceptée sans résistance, aussi pour éviter que « les cavaliers et dragons negligeans de s'habiller, le pourroient être, de manière qu'ils ne seroient pas tous vêtus, de même sorte, ni de semblable couleur », Louis XIV, dans une ordonnance du 20 novembre 1671 (pdf), décida qu'à l'avenir toutes ses « compagnies soient toujours composées de cavaliers et de dragons (3) vêtus de même façon ». La qualité très médiocre des étoffes à cette époque obligeait au renouvellement complet des habits tous les deux à trois ans. Ainsi, avec un cycle de renouvellement court et un financement assuré, il fut facile aux colonels d'imposer à leurs soldats et cavaliers une coupe et une couleur. L'uniformité consistait alors à fixer le type et la couleur des effets que chaque soldat devait porter. L'uniforme proprement dit, c'est-à-dire respectant une coupe, des couleurs tranchantes et des attributs officiellement réglés, n'était pas encore défini.
Bien vite, confronté au coût de cette entreprise, les occasions d'achat d'étoffes présentes sur le marché en grande quantité et à très bas prix furent privilégiées. La draperie était une industrie répandue dans la plupart de nos provinces. Les types de drap (4) étaient nombreux et chaque canton restait fidèle à celui qu'il avait coutume de fabriquer depuis de longues années. La fabrique de Sedan occupait le premier rang dans la draperie fine et jouissait depuis longtemps de la réputation qu'elle a toujours su conserver. Derrière elle, venaient Lorient, Elbeuf, Abbeville, Darnetal. Les draps de ces fabriques furent réservés aux officiers. La draperie commune était fabriquée surtout dans le centre de la France et dans le Languedoc où Lodève eut le privilège d'habiller les troupes. Ces fabriques produisaient des étoffes grossières pour la plupart dont les meilleures présentaient un tissu épais et sans souplesse.

Dans les années 1670, les fantassins reçurent le justaucorps blanc-gris à larges basques, le gilet long ou veste, la culotte (5), les bas, les souliers, le chapeau de feutre gris à bords ronds et larges.
Les régiments se distinguaient entre eux par la couleur des parements (6), du gilet, de la culotte et des bas que les colonels avaient choisie. On privilégia cependant le bleu et le rouge qui étaient les couleurs du roi et de la reine et le blanc qui était celle du royaume. Certains régiments, qui avaient pour couleur celle de leurs origines géographiques, les conservèrent. Cette première étape, dont le but était de vêtir les soldats avec des effets de modèle identique, devait subir les extravagances de son temps. Les mestres de camp conservèrent la couleur du fond d'habit, mais firent varier à l'infinie les couleurs tranchantes qui les distinguaient. Ainsi, suivant leur caprice, ils adoptèrent des couleurs qui s'accordaient le mieux entre elles ou qui plaisaient à telle maîtresse adorant le bleu pâle ou à telle autre idolâtrant le cramoisi.
Les Gardes françaises (7) reçurent l'habit gris-blanc galonné d'argent sur les coutures, sur les poches et les parements, la culotte écarlate et les bas de même couleur. Le chapeau noir à larges bords ornés de plumes (8), la cravate blanche à rabat et le ceinturon porte-épée en peau jaune, complétaient cette tenue. Les officiers, pour se distinguer de la troupe, portaient l'habit écarlate richement galonné d'argent et la cuirasse.
En 1685, on commença à mettre de l'ordre dans le choix des couleurs destinées au fond de l'uniforme. Le bleu fut réservé pour les gardes françaises et une partie des régiments royaux, le rouge pour les Suisses et le blanc-gris pour les autres corps. Les habits et les vestes dans chaque corps furent ornés de boutons métalliques jaunes ou blancs sur les devants, la taille et les poches. Le soulier à boucle et le ceinturon qui devait soutenir l'épée et porter la giberne devinrent de rigueur. La giberne ou cartouchière s'était progressivement imposée dans les armées à la suite des progrès techniques réalisés sur les armes à feu. Les cartouches de papier contenant la poudre et la balle ayant fait leur apparition, on remplaça les petites boîtes à charges suspendues au baudrier ou à la bandoulière par une petite sacoche de cuir appelée giberne dans laquelle on logeait les cartouches de papier.

La cavalerie ne prit l'uniforme à proprement parler qu'en 1690. Jusque là, le vêtement avait été, d'une façon générale, bleu à revers rouge pour les régiments royaux et gris pour les régiments de gentilshommes. Les compagnies se distinguaient entre-elles par la couleur du baudrier supportant l'épée. Les grenadiers à cheval (9) portaient, probablement depuis leur création en 1676, l'habit bleu doublé de rouge avec les agréments blancs. Les mousquetaires, les gendarmes et chevaux légers avaient l'uniforme entièrement rouge. Sur 116 régiments de cavalerie légère alors sur pied, 87 avaient encore l'habit gris à revers rouges, 4 l'habit gris à revers bleus et 14 appartenant au roi ou aux princes du sang l'habit bleu à revers rouges. Sur les 31 régiments de dragons, 15 n'avaient pas d'uniforme arrêté, deux, dont celui du roi et du dauphin, avaient l'habit bleu, les 11 autres l'habit rouge. Les couleurs employées étaient les couleurs royales, le bleu, le rouge et le gris remplaçant le blanc trop difficile à entretenir. Le vert qui n'était pas une couleur française apparut un peu plus tard chez les dragons.
Le marquis de Louvois mourut le 16 juillet 1691 à l'âge de 50 ans. Il fut remplacé par son fils, le marquis de Barbesieux, qui fut fait secrétaire d'État par provision du 5 décembre 1681, en survivance de son père. Il exerça conjointement avec son père cette fonction, puis seul après sa mort, jusqu'à la sienne le 5 janvier 1701.
En 1697, l'infanterie reçut les boutons de métal or ou argent, les souliers à boucle, le ceinturon, la giberne et le chapeau en feutre noir ou lampion à bords retroussés, galonné de jaune ou de blanc et orné d'une cocarde noire en tissu. La couleur de la cocarde varia bientôt suivant les corps, en 1767, elle deviendra blanche.
(1) On désignait ainsi, les objets que devaient fournir aux soldats les habitants obligés de les loger. Au nombre de ces objets, on trouvait «le lit garni de linceuls, la place au feu et la chandelle de l'hôte selon sa commodité ». Cette servitude fut bientôt remplacée par une contribution en argent que les habitants payaient à l'État. La couronne, de son côté, pourvoyait aux besoins de la troupe par l'allocation de l'ustensile, dont le montant était fixé chaque année. L'ustensile n'était plus payé une fois les troupes casernées.
(2) Comme le dira en son temps le général Susane « sous un habit particulier, on échappe difficilement aux regards et l'esprit de corps ne souffre jamais qu'on déshonore l'uniforme ».

(3) Jusqu'alors, l'armée n'était constituée que d'infanterie et de cavalerie. Parmi les unités montées, on distinguait cependant des corps particuliers au nombre desquels les gendarmes, les chevaux légers (voir leurs créations ci-dessus) et les dragons. Invention française, les dragons sont nés de la nécessité d'avoir sur le terrain des unités capables d'aller semer le désordre dans les rangs ennemis. Ils se déplaçaient à cheval, combattaient à pied et avaient, pour mener à bien leurs actions, un armement et un équipement particuliers. Pour pouvoir évoluer sans gêne, les dragons eurent un habillement particulier qui évolua comme celui de la cavalerie. Ils étaient reconnaissables à leur coiffure, une espèce de chaperon à longue queue qui les distinguait des fantassins. Certains historiens ont voulu voir dans le nom de dragon une étymologie latine, mais il semble plus sûr que ce qualificatif leur fut donné par les troupes ennemies, pour caractériser la terreur et les ravages qu'ils semaient dans leurs rangs. Ces groupes de cavaliers particuliers adoptèrent ce nom qui leur sembla correspondre si bien à leurs activités redoutables. Initialement, ces soldats furent des fantassins qui prirent l'habitude, pour l'exécution rapide de leurs hardis coups de main, de monter à cheval et de chercher par la célérité de leur course à surprendre l'ennemi.
Cet usage se conserva dans une partie de l'infanterie pendant toute la durée des guerres de religion. On vit enfin se former en dehors des régiments d'infanterie quelques compagnies d'arquebusiers à cheval et plus tard les dragons devinrent une arme mixte nouvelle, indépendante de l'infanterie et de la cavalerie. Ils furent intégrés dans tous les régiments de cavalerie, puis ils formèrent des compagnies pour constituer, à la paix des Pyrénées (1659), deux régiments, celui du roi créé en 1657 et celui de La Ferté créée en 1668. Par un édit du 25 juillet 1665, les dragons tenaient rang dans l'infanterie. Ils n'étaient pas considérés comme appartenant à la cavalerie. Louis XIV, qui affectionnait cette cavalerie particulière, en fit une arme à part entière en instituant la charge de colonel général des dragons par ordonnance du 2 avril 1668 et consacra d'une manière définitive l'existence de ce corps par la création d'un l'état-major par édit du 17 mai 1669.
(4) Les étoffes de drap étaient en laine, celles de toile en coton.
(5) La culotte était un vêtement d'homme qui couvrait le corps depuis les hanches jusqu'aux genoux. Elle remplaçait le haut-de-chausse. Les chausses étaient un vêtement couvrant le corps depuis la ceinture jusqu'au pied. Les chausses furent séparées en trousse, haut-de-chausse et bas-de-chausse. Les trousses formaient la partie supérieure du haut-de-chausse. Elles étaient bouffantes, enveloppaient le bassin et étaient détachées du haut-de-chausse (voir image du mestre de camp ci-dessus). Le haut-de-chausse désigna par la suite le vêtement qui couvrait les cuisses et le bas-de-chausse celui qui couvrait les mollets. Il semble que c'est par abréviation du mot bas-de-chausse que l'on désigna cette partie du vêtement tout simplement « bas ». Du mot « chausse » dérive les mots chaussette, chausson, chaussure, chausser, caleçon.
(6) Le parement du latin paratum qui signifie orner, consistait dans un retroussis ou une garniture de l'extrémité des manches d'un gilet, d'une veste ... Ils servaient à distinguer les régiments. Le parement des justaucorps a été initialement réalisé en botte, c'est-à-dire largement évasé. Outre la couleur, ils étaient ornés d'agréments, boutons, galon, passepoil. Ils seront réduits peu à peu, mais continueront à être utilisés pour la distinction des corps puis des grades.
(7) Les gardes-françaises ont été instituées sous Charles IX pour la garde du roi vers 1563. Elles changèrent plusieurs fois de nom et d'organisation. Initialement composée de fantassins elle comprit des compagnies de grenadiers dont la première fut créée en 1689. Ce corps fut le premier qui ait eu des aumôniers soldés par l'état, une école d'enfants nommée dépôt, ancêtre de l'institution des pupilles, une musique militaire et des officiers ayant le titre de porte-drapeau. En 1613, leur force est de 2790 hommes. L'effectif a varié pour être en 1789 de 3600 hommes. Elle fut licenciée à cette date et incorporée dans la garde nationale parisienne jusqu'en 1792, époque à laquelle les gardes furent dispersés dans tous les régiments envoyés aux frontières.
(8) Les soldats d'infanterie portaient sur leurs chapeaux des plumes aux couleurs des colonels ce qu'on appelait alors un chapel de plumes. Cette touffe était faite ordinairement de plumes de coq et on la nommait à cause de cela « coquarde ou cocarde ». Plus tard on remplaça la plume par un nœud de rubans, mais on continua à donner à ce nœud le nom de cocarde.
(9) La compagnie des grenadiers à cheval a été créée en 1676 et jointe aux quatre compagnies des gardes du corps du roi. Les grenadiers furent créés en 1667. Cette arme meurtrière, utilisée depuis François Ier, était confiée à des hommes joignant intrépidité et adresse. Ces soldats d'élite, touchant une haute-paie, reçurent le nom de grenadier. Initialement au nombre de quatre par compagnie, Louis XIV réunit en 1670, tous les grenadiers de son régiment pour en former une compagnie. En 1672, les trente premiers régiments d'infanterie imitèrent l'exemple du régiment du Roi. Dans la suite de 1672 à 1678 tous les régiments et enfin tous les bataillons eurent leur compagnie d'élite. Au cours de cette période, le fusil fit disparaître le mousquet, le soldat d'infanterie, en dehors des grenadiers, prit le nom général de fusilier.
La succession d'Espagne plongea le royaume de France dans un conflit qui dura de 1701 à 1714. Cette guerre obligea à lever des milliers d'hommes. En 1704 ce ne sont pas moins de huit armées qui sont mises sur pied, une en Flandre, deux en Allemagne, trois en Italie, une dans les Cévennes et une en Espagne.

Bientôt les engagements sont insuffisants, on lève des milices, les princes et les gentilshommes lèvent des régiments à leurs frais. En 1709, l'hiver des plus rigoureux amène la famine et met le comble à la désolation générale. Le 6 mars 1714, un traité de paix est signé à Rastadt. La France respirait, mais épuisée humainement et financièrement, un long repos lui était désormais nécessaire. Sur les 280 régiments, Louis XIV n'en conserva que 120.
Le 1er septembre 1715, Louis XIV meurt. L'armée se composait alors de régiments royaux, de ceux des princes, des gentilshommes et des provinces chacun avec leurs particularités. La priorité du régent, le duc d'Orléans (oncle de Louis XV) fut de rétablir les finances de l'État que ces années de guerre avaient mises à mal.
L'armée n'était plus que l'ombre d'elle-même. La misère s'était installée en son sein et le relâchement qui en résulta était tel, que le 28 février 1716 parut une ordonnance interdisant aux particuliers tout achat d'habillement de soldats. Le conseil des finances, institué par le régent, emprunta 10 millions de livres pour payer les arriérés de solde. L'heure fut à la réorganisation et à la réduction des effectifs. Le 24 septembre 1718, Claude Le Blanc fut nommé secrétaire d'État à la Guerre.
L'habillement des troupes n'était pas le seul souci de la couronne. L'une de ses principales préoccupations était le logement de ses unités qui s'effectuait toujours chez l'habitant. L'idée de construire des bâtiments exclusivement destinés au logement des troupes n'était pas nouvelle, mais faute de financement ce projet n'avait jamais vu le jour. Cependant le 14 janvier 1692 on avait commencé dans les faubourgs de Paris la construction de casernes pour les gardes françaises et suisses. Ces casernes furent achevées en 1716. Le conseil de la guerre décida alors que des casernes seraient construites sous la surveillance de l'État dans les villes qui en ferait la demande et aux frais des populations directement intéressées à s'affranchir des charges du logement militaire. En attendant, on loua des locaux aussi vastes que possible pour y réunir les troupes et les soustraire aux graves inconvénients de l'éparpillement chez l'habitant. Quatre cent quatre-vingt-huit casernes furent construites dans les principales villes de garnison en 1719.
En 1719, les finances du royaume ayant retrouvé leur équilibre, une ordonnance du 1er septembre rétablissait les troupes au niveau de celui qui existait à la fin du règne de Louis XIV. C'est à cette occasion que tous les cavaliers furent équipés des bottes molles et que la taille des chevaux des cavaliers, dragons et gendarmes fut réglementée. Depuis les années 1690, l'uniforme dans sa coupe et ses couleurs s'était réellement imposé. Sa réglementation allait désormais relever exclusivement de la couronne.
La maréchaussée n'avait jamais bénéficié d'une évolution dans son habillement comme les autres corps militaires. Cette troupe d'ancienne création était toujours sous le coup de l'ordonnance de 1584 dans laquelle Henri III avait prescrit aux maréchaussées le port du hoqueton, de la bourguignotte, des brassards, des tasselots et autres éléments de cuirasse.

Les prévôts, alors capitaines de ces compagnies, n'avaient ni la possibilité réglementaire ni les moyens financiers de faire évoluer l'habillement de leurs archers comme les colonels le faisaient pour les soldats de leur régiment. En restructurant cette milice et en la militarisant, Louis XV, dans son ordonnance du 16 mars 1720 (pdf), décida que ses hommes fussent vêtus d'un uniforme semblable dans son aspect général à celui en usage dans les armées. Il fixa les différents effets composant cet uniforme et donna à ce corps royal les couleurs de la maison du roi à savoir le bleu et l'incarnat auxquelles on rajouta le blanc, plus discret, que l'on retrouvait dans les galons et boutons d'argent et dans l'aiguillette.
Ainsi, ce costume était composé d'un justaucorps bleu de roi avec parements et doublures écarlates et fermant sur le devant avec des boutons argent, d'une veste de chamois ou de couleur chamois bordée d'un galon d'argent, d'un chapeau orné d'un galon d'argent, d'une bandoulière (1) et d'un ceinturon de buffle jaune bordés d'un galon d'argent, d'un manteau bleu avec parement écarlate et des bottines à boucles de cuivre.
Les sous-brigadiers se distinguaient par trois ganses d'argent à queue sur le parement de l'habit (ou retroussis de l'extrémité de la manche), le brigadier par six ganses, trois sur le parement et trois sur la manche. L'habit de l'exempt avait trois ganses sur la manche, trois autres sur la poitrine et trois sur chaque poche.
Les lieutenants avaient six ganses sur la poitrine dont une en haut, deux au milieu et trois au-dessus des poches, trois sur chaque manche, trois sur chaque poche, une sur le côté et trois derrière l'habit. Le prévôt avait des ganses sur la poitrine disposées de deux en deux jusqu'à la hauteur des poches, quatre sur chaque manche, quatre sur chaque poche et quatre sur chaque pan arrière. Les officiers portaient l'aiguillette d'argent, les archers et gradés portaient l'aiguillette de soie blanche.
(1) Toutes les troupes avaient le ceinturon et la bandoulière. On affecta à la cavalerie la bufflèterie jaune et à l'infanterie la bufflèterie blanche. Les deux pièces étaient galonnées de soie pour les corps d'élite.
L'infanterie
La mise en place progressive de ces nouveaux effets uniformes laissait aux officiers la possibilité de se parer encore de quelques fantaisies de dentelle et autres broderies. Toutefois, l’ordonnance du 10 mars 1729 (pdf) devint moins tolérante et prescrivit des règles plus rigoureuses dans le port de l’uniforme.
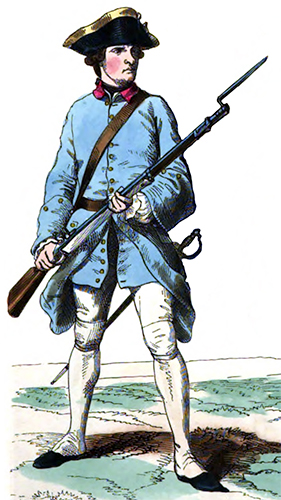
L'habillement que les troupes d'infanterie s'étaient attribué par la seule volonté de leurs capitaines devint officiel. Loin de tout modifier, l'ordonnance s'adapta aux effets en usage. Ainsi, suivant l'expression consacrée par cette ordonnance, l'habillement des « sergents et soldats des troupes de l'infanterie continuera d'être composé d'un justaucorps en drap de Lodève, doublé de serge d'Aumale, ou autre étoffe de même qualité, blanche, rouge ou bleue, selon la couleur affectée au régiment, d'une veste et d'une culotte de tricot, d'une paire de bas de couleur assortie au justaucorps, d'un chapeau galonné d'or ou d'argent ».
Les sergents se distinguaient soit par un galon d'or ou d'argent sur la manche de leur justaucorps, soit par quelques brandebourgs, suivant la coutume du régiment. Les boutons entraient désormais dans les accessoires participant à la distinction des régiments. Ils étaient de cuivre ou d'étain pour imiter les couleurs or et argent. Les tambours continuaient, comme par le passé, de porter la livrée du régiment, sans aucun galon d'or ni d'argent.
Les officiers durent se pourvoir du même habit (1) que leur troupe. Si le roi leur accordait des étoffes et attributs de meilleure facture comme le drap d'Elbeuf, il leur interdisait, sous peine des plus sévères sanctions, de le modifier ou de se parer de galons ou de fil d'or ou d'argent. Cette interdiction n'était pas nouvelle. Si le luxe et la somptuosité des habits permettaient aux officiers de se distinguer de la troupe à une époque où l'uniforme n'existait pas, ils n'en demeurait pas moins un puissant outil pour afficher leur fortune et leur suffisance. Cette fatuité était une véritable plaie dans la chaîne de commandement où l'orgueil et la vanité prenaient le pas sur la raison.

Louis XIV, dans son ordonnance du 25 mars 1672 (pdf) interdisait déjà aux officiers de ses troupes de porter sur leurs habits des passements d'or ou d'argent. Certe, cette méchante coutume en dépenses inutiles et superflues valorisait les officiers les plus riches, mais elle ruinait les moins accommodés qui, à leur exemple et par une fausse réputation, croyaient être obligés de les immiter.
Le royal-artillerie
Une ordonnance du 1er juillet 1729 concernant la solde et la composition du régiment royal-artillerie imposa quelques variantes dans l'habillement de ce corps en fonction de la spécialité des compagnies. Ainsi, les compagnies de sapeurs, bombardiers et canonniers continuaient d'être vêtus, suivant l'ordonnance du 22 mai 1722, d'un l'habit bleu doublé de rouge avec boutons de cuivre, de la veste rouge doublée de rouge et de la culotte rouge.
Les compagnies des mineurs avaient le justaucorps bleu doublé de rouge, la veste gris de fer et la culotte rouge. Les compagnies d'ouvriers portaient un justaucorps gris de fer doublé de bleu, avec les manches en amadis, la veste gris de fer et la culotte rouge.
La cavalerie
Quatre ans plus tard, une ordonnance du 28 mai 1733 (pdf) régla l'uniforme des troupes à cheval. Comme pour l'infanterie, les couleurs, que les régiments avaient adoptées, furent conservées. L'habit se composait d'un justaucorps blanc, bleu ou rouge confectionné en drap de Lodève pour les cavaliers, en draps d'Elbeuf pour les officiers, d'un buffle ou d'une veste couleur chamois, suivant le modèle utilisait par les régiments et d'un chapeau dont la forme permettait qu'il soit garni d'une calotte en fer et bordé d'un galon or ou argent. Les brigadiers se distinguaient par un galon d'or ou d'argent à la manche. Comme pour l'infanterie, les officiers furent soumis aux mêmes obligations. Les premières directives, établissant un modèle unique d'effet pour toute l'arme, portèrent sur les bottes qui devaient être molles, la bandoulière et le ceinturon de buffle (2).
Les hussards

À cette date il n'existait que deux régiments de hussards (3), celui de Ratzky (n°57) et celui de Berchini (n° 59). Si la forme du vêtement, dite à la hongroise, avait été conservée, il n'en avait pas moins évolué pour se rapprocher des méthodes de confection de la draperie à la française. Les hussards avaient abandonné la simple peau de mouton pour une pelisse de drap bleu, doublée de cette même peau et bordée d'une fourrure noire. Ils étaient coiffés d'un bonnet rouge avec fourrure noire et plume blanche, avaient la culotte bleue, l'écharpe de laine rouge bordée, les bottines noires. La veste et la pelisse étaient garnies de petits boutons d'étain ronds, brandebourgs de laine blanche, ganse plate et ronde pour les boutonnières. Le ceinturon et bufflèterie de sabretache étaient jaunes, la sabretache était ornée d'une fleur de lys blanche.
Pour limiter les dépenses d'habillement, le secrétaire d'État à la Guerre, Nicolas d'Angervilliers avait dû en 1729 fixer la liste des effets réglementaires entrant dans la composition de l'uniforme des soldats. Cette mesure qui aurait dû ramener l'achat d'étoffes à des quantités plus modestes, fut au contraire un prétexte pour l'augmenter. Fort des effets réglementaire qu'il fallait faire confectionner, les capitaines achetèrent sans compter de grandes quantités d'étoffe pour leur compagnie. Comme il fallait s'en douter, cette profusion de matière incita au détournement et au gaspillage. Pour endiguer cette gabegie, une ordonnance du 20 avril 1736 (pdf), concernant l'habillement de l'infanterie, déterminait les quantités et les qualités des étoffes nécessaires à la confection de chacun de ces effets. L'habit complet pour les sergents comprenait le justaucorps et la veste garnis de boutons blanc ou jaune, la culotte, le tout en drap blanc de Lodève, la cravate, les bas. Pour les caporaux, anspessades (4) et soldats, l'habit était en drap gris-blanc de Lodève avec le parement des manches de la couleur du régiment, il était complété d'une paire de guêtres, d'un ceinturon, de la bandoulière, de la cartouche et d'un fourniment (5).
En complément de l'ordonnance de 1733 qui imposait de porter une calotte de fer, appelée discrète, sous le chapeau, Louis XV, dans une ordonnance du 27 décembre 1743 (pdf), cru bon de faire reprendre l'usage de la cuirasse aux troupes à cheval les jours de combat et autres actions militaires. Cette obligation avait été déjà établie par les ordonnances des 5 mars 1675 et du 1er février 1703, cependant son exécution n'avait jamais été observée. Cette répugnance à porter cet équipement inconfortable s'expliquait notamment par des considérations d'amour-propre. En effet, si au temps de la chevalerie, ceux qui s'en couvraient en tirer honneur et fierté, ce n'était plus le cas désormais et les officiers redoutaient à présent d'être accusés de pleutre s'ils s'en équipaient face à l'ennemi. La bienveillance de Louis XV à l'égard de sa cavalerie ne résista pas à la toute-puissance de la mode et des idées, et la cuirasse disparue des champs de bataille sans que des dispositions réglementaires l'eussent abolie.
(1) La résistance que mirent les officiers à revêtir l'uniforme fut immense. Pour l'imposer, la couronne dut user de menaces et de beaucoup de concessions. L'une des raisons pour laquelle les officiers ne le portaient pas était d'abord qu'il était semblable à celui des soldats à l'exception des boutons en argent ou en or et d'un drap plus fin, ensuite parce que rien ne distinguait le sous-lieutenant du colonel. Il y avait aussi le problème de son entretien qui se faisait avec de la céruse et avait pour fâcheuse conséquence de déteindre les étoffes. Pour ces raisons, les officiers ne revêtaient que des vêtements civils avec lesquels ils pouvaient grâce à la richesse des étoffes, des dentelles, galons d'or et d'argent se prévaloir de leur rang.
(2) Cette ordonnance devait également uniformiser l'armement afin que les mousquetons et pistolets soient de même longueur et du même calibre que ceux de l'infanterie, et fixer la taille des chevaux.
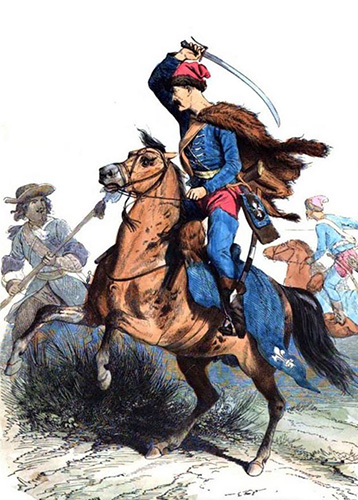
(3) C'est sous le règne de Louis XIII que l'on vit pour la première fois en France des compagnies de hussards étrangers servant dans nos armées comme troupes auxiliaires. On ne les connaissait alors que sous le nom de cavalerie hongroise.
Depuis la mort de Louis XIII jusques au traité des Pyrénées (novembre 1659) l'armée compta dans ses rangs un nombre variable, mais cependant considérable, de régiments étrangers. En 1640, la situation de la cavalerie légère portait 3 000 cavaliers allemands ou hongrois. Ils furent licenciés par Louvois qui désirait que l'armée française soit composée de nationaux. On chercha alors à former une troupe capable de suppléer à l’ensemble de la cavalerie, pour prévenir les actions ennemies. Louvois favorisa grandement le développement des dragons. Les hussards furent appelés à remplir ce rôle qu'après la mort de Louvois.
Les hussards étaient une espèce de milice à cheval que l'on trouvait en Hongrie et en Pologne. Ils étaient montés sur de petits chevaux ardents et infatigables qui leur donnaient une supériorité incontestable dans les courses et leurs coups de main. À l'inverse, ils étaient médiocres aux actions de pied ferme. Ces cavaliers avaient la tête rase or un toupet de cheveux qu'ils conservaient et une grosse moustache. Ils étaient coiffés d'un bonnet long bordé de peaux. Les officiers étaient habillés à la Turque. Les cavaliers avaient des pourpoints ou vestes qui allaient jusqu'à la ceinture. Les manches, plus étroites, se retroussaient avec un bouton. Ils portaient une grande culotte en pantalon, c'est-à-dire descendant jusqu'aux chevilles. Ils n'avaient ni justaucorps, ni manteau, ni chemise, mais pour se parer du mauvais temps ils portaient chacun une peau de tigre ou de mouton pendue à leur col. La plupart étaient bottés à cru. C'étaient des combattants intrépides et déterminés.
Les hussards étaient armés d'un grand sabre recourbé attaché à la ceinture avec des anneaux et des courroies. Ils avaient des pistolets et une carabine et de très grandes gibecières en bandoulière en forme de havresac. Leur tactique de combat était de désorganiser par différents mouvements les troupes ennemies afin de mieux les combattre.
Les premiers escadrons de hussards arrivèrent en France vers 1689 sous la conduite d'officiers hongrois. Ils avaient fui la Hongrie que l'Autriche avait annexée en 1689. Les deux plus vigoureux champions de cette lutte avaient été les Estherhazy et les Bercheny, tous deux de famille princière et créateurs de l'arme des hussards. N'ayant pu conserver l'indépendance de leur patrie, ils s'étaient repliés sur la France en 1689. Quelques années plus tard, ils tenteront de reconquérir leur pays, mais en vain, ils se replieront une nouvelle fois sur la France et en 1712 se mettront au service de Louis XIV. En 1720, Louis XV conféra par lettre patente au comte de Bercheny le titre de mestre de camp colonel et l'autorisa à augmenter et former ses escadrons en régiment. Le régiment prit rang dans la cavalerie française sous le numéro 59. Par la suite, on multiplia les régiments de hussards.
(4) Ce mot vient, par corruption de l'italien, de Lanza spezzada qui signifie lance rompue par opposition à Lanza fornita c'est-à-dire lance fournie ou complète. C'était autrefois un gendarme ou cavalier démonté, qui n'ayant plus les moyens d'entretenir son équipage, demandait alors à servir dans l'infanterie. On créa pour lui une position d'attente, une place honorable où on le faisait servir avec quelques distinctions de paye ou de service. Il prenait rang entre les simples fantassins et le caporal. Il était une sorte de 1re classe.
(5) Fourniment : Ce mot a la même origine que le verbe FOURNIR. Il n'a jamais eu dans les ordonnances un sens fixe, mais caractérisait à cette époque les accessoires pour les armes à feu et plus particulièrement la poire à poudre d'amorçage des fusils. C'était un étui de cuir bouilli, de bois ou de corne qui se fermait à l'aide d'un bouchon de bois. Il était plus petit que le pulvérin destiné à transporter la poudre pour les charges. Ce mot cessa d'être employé avec l'apparition de la cartouche et fut définitivement remplacé par la giberne qui fut d'abord appelée cartouche d'équipement et demi giberne.
Lorsque le comte d'Argenson fut nommé secrétaire d'État de la Guerre, il lui parut nécessaire de distinguer les lieutenants généraux et les maréchaux de camp (1). Une ordonnance du 1er février 1744 (pdf) leur imposa de porter un uniforme lorsqu'ils étaient employés aux armées, afin d'être promptement reconnus de tous. C'était un habit uniforme non croisé bleu de roi (2), orné d'une double broderie d'or en forme de galon sur les manches et sur les poches pour les lieutenants généraux et simple pour les maréchaux de camp.
(1) L'uniforme des maréchaux de France ne fut jamais défini par les ordonnances royales jusqu'à la révolution ou cette dignité fut supprimée. Il fallut attendre le décret du 29 messidor an XII (18 juillet 1804) et la création des maréchaux de l'Empire pour voir apparaître la première réglementation à ce sujet.
(2) Bleu foncé.

Après le second traité d'Aix-la-Chapelle en 1748 qui mit fin à la guerre de succession d'Autriche, les régiments français furent réorganisés. Avec l'ordonnance du 10 février 1749, on réduisit le nombre de régiment et les effectifs des régiments conservés. Des 48 régiments licenciés, le roi ne conserva que les 48 compagnies de grenadiers et forma par ordonnance du 15 février 1749 (pdf), le corps des grenadiers de France (1). Ce corps, de quatre brigades de 540 hommes, prit rang dans l'infanterie et reçut le n° 40. Un officier général était à la tête de ce corps avec le titre d'inspecteur commandant.
L'uniforme consistait en un habit et parement bleu, revers et collet rouges, doublure rouge, avec des agréments blancs sur l'habit, trois sur chaque parement et trois sur chaque poche, boutons blancs et plats, veste bleue sans revers garnie de boutonnières blanches et trois sur chaque poche, culotte bleue, bonnet de peau d'ours par devant et de drap rouge par derrière, guêtres blanches.
(1) Ce corps sera supprimé en 1771 (ordonnance du 4 août)
L'infanterie

Avec l'ordonnance du 19 janvier 1747 (pdf), le ministre rappela les dispositions précédemment établies et en substitua quelques-unes de nouvelles quant à la forme et à la coupe de l'habit. Ainsi, les justaucorps furent croisés à l'arrière, les manches en botte ordinaire étaient maintenues par un bouton et pouvaient être rabattues, les justaucorps et vestes étaient garnis de boutons de cuivre ou d'étain jusqu'à la taille et possédaient deux poches de hanches. Les sous-officiers et soldats recevaient une paire de guêtres en toile écrue. Si les régiments conservaient leur couleur, cette réglementation fut le prélude d'une modification complète de toute la tenue qui aura pour finalité d'uniformiser l'habillement et l'équipement pour tous les régiments d'infanterie.
La cavalerie
Louis XV, ayant réglé par son ordonnance du 28 mai 1733 l'habillement, l'équipement et l'armement de la cavalerie à l'effet de les uniformiser dans tous ses régiments, décidait, dans une ordonnance du 1er juin 1750 (pdf), de renouveler l'habillement des cavaliers par tiers ou par quart chaque année. La mise en application de cette ordonnance fut confiée à Henri de la Tour d'Auvergne, alors colonel général de la cavalerie française et étrangère, qui élabora pour cela un règlement qui lui fut annexé. Comme pour l'infanterie, les régiments de cavalerie conservaient leur couleur, mais chaque élément de la tenue devait répondre à des caractéristiques bien précises.
À cette occasion, l'aiguillette fut supprimée et remplacée par deux épaulettes de laine destinée à maintenir la bandoulière à laquelle était suspendue la cartouche. Elles étaient en drap bleu de Lodève ou de Berry et bordées d'un galon de la couleur du régiment. Le chapeau de laine était bordé d'un galon argent. Les chevaux de tous les régiments portaient un ruban de laine pour trousse-queue de couleur rouge. La bandoulière, blanche pour les régiments royaux et buffle pour les autres, soutenait une cartouche à 12 coups. Désormais, tout l'équipement du cavalier et du cheval devait être conforme à un modèle défini par le roi. L'habit des officiers était identique à celui des cavaliers excepté la qualité du drap et les boutons qui étaient en argent. Armés de l'épée, ils n'étaient pas équipés de la cartouche et de sa bandoulière et donc ne portaient pas d'épaulettes.
Les dragons
À la suite d'une ordonnance publiée le même jour, le duc de Coigny, colonel général des dragons fit un règlement le 16 mai 1750 (pdf) similaire pour ses régiments. Dans ce règlement associé à cette ordonnance, le duc de Coigny imposait aux brigadiers, caporaux, anspessades, carabiniers et dragons le justaucorps et la veste en drap de Lodève ou de Berry, de couleur bleu, rouge-garance ou vermillon suivant la couleur affectée au régiment. Les parements en botte et le devant de l'habit étaient garnis de boutons. L'aiguillette fut supprimée et remplacée par une épaulette sur l'épaule gauche pour maintenir la bandoulière de la cartouche.
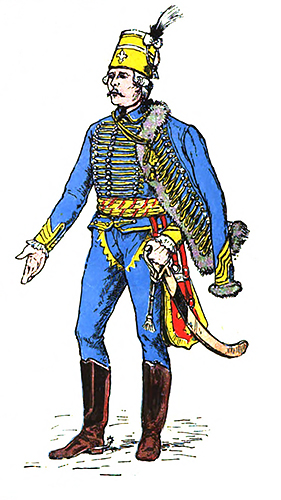
Les dragons possédaient deux coiffures, un bonnet de drap à pointe renversée sur l'épaule gauche bordé d'un galon de la couleur du régiment et d'un chapeau de laine bordé d'un galon d'argent. Les grades étaient figurés sur les manches par des agréments en tresse. Ils avaient également la culotte de peau, les bottines et les guêtres blanches. Les dragons étaient armés du sabre à poignée de cuivre avec une lame à double tranchant. Afin que tous les régiments aient le même type d'habillement, d'équipement et d'armement, ils recevaient du ministère un modèle auquel ils devaient se conformer. L'habit des officiers était identique à celui de la troupe à l'exception des draps qui étaient de meilleure qualité. Ils étaient armés de l'épée.
Les hussards
Poursuivant le même objectif, une ordonnance du 15 mai 1752 (pdf), établie sur un modèle identique aux précédentes, fit l'objet d'un règlement élaboré par le prince de Turenne pour normaliser l'habillement, l'équipement et l'armement des régiments de Hussards. La pelisse, la veste et la culotte étaient à la hongroise en drap de Lodève ou de Berry bleu céleste. La pelisse de drap était doublée d'une peau de mouton blanc bordée de peau noire. La veste ou dolman, plus court que la pelisse, de drap de même couleur, était garnie de la même qualité et quantité de boutons et de cordonnets de fil blanc. L'extrémité de la manche était retroussée d'un drap de la couleur du régiment. Ils avaient la culotte ornée de charivaris, le bonnet ou shakos de feutre blanc (1) garni des couleurs affectées aux régiments, surmonté d'une aigrette blanche et orné d'une fleur de lys, l'écharpe de laine autour de la taille.
La sabretache de drap rouge ornée d'une fleur de lys, le ceinturon à la hongroise, la bandoulière avec cartouche à 20 charges tout en cuir rouge complétaient l'habillement. L'habit des officiers se distinguait par la qualité des matières : pelisse, veste et la culotte en drap d'Elboeuf, la pelisse garnie de peau de renard, les boutons, galons et fleur de lys en argent. Tous les hussards étaient équipés du sabre courbé.
(1) Sauf le régiment de Berchény qui conservait le shako rouge.
Par Ordonnance du 8 décembre 1755, les bataillons du régiment Royal-Artillerie, les compagnies de mineurs et d'ouvriers qui servaient à leur suite, les officiers d'artillerie et les ingénieurs furent regroupés en un seul corps sous la dénomination de Corps Royal de l'Artillerie et du Génie. Ce corps fut placé sous l'autorité immédiate du roi.

Le 1er janvier suivant fut constitué le Corps Royal de l'Artillerie (1) par la réunion du Corps de l'Artillerie et du Régiment Royal-Artillerie. Les uniformes portés par les unités spécialisées attachées depuis 1671 au service de l'artillerie avaient subi les mêmes transformations générales que celui des troupes à pied. Cependant, compte tenu des exigences de leur service, il comportait quelques variantes. L'ordonnance du 5 février 1720 (pdf), qui avait créé le premier régiment en fusionnant les corps de bombardiers, de canonniers et de mineurs, lui avait conservé l'habit gris-blanc doublé de rouge.
Le duc de Maine, grand-maître de l'artillerie lui donna en 1722 (2) l'habit bleu doublé de rouge avec boutons de cuivre et la veste rouge doublée de rouge. Les boutonnières des habits du Royal-Artillerie furent galonnées d'or pour les officiers et de laine aurore pour les sous-officiers. L'armement et l'équipement étaient identiques aux autres troupes d'infanterie.
Ce costume fut attribué aux compagnies de sapeurs, de bombardiers et de canonniers qui composaient les bataillons, lorsque l'ordonnance du 1er juillet 1729 en détacha les mineurs et les ouvriers qui formeront plus tard le corps du Génie. Vers 1740, les artilleurs avaient l'habit bleu avec doublure, parements, veste, culotte et bas rouges. Les manches étaient retournées en bottes. Ils avaient les poches en travers, les boutons de cuivre ronds dorés, le chapeau noir bordé d'or avec la cocarde noire. Dans une déclaration de mars 1741 (pdf), les ouvriers de l'artillerie (futur génie) quittaient la veste bleue du royal artillerie pour prendre la veste rouge doublée de rouge. Ils conservaient le justaucorps gris-de-fer doublé de rouge, avec les manches en amadis.
La création du corps ne changea rien aux uniformes des unités le composant. Les artilleurs conservaient l'habit bleu garni d'une bande, parement, collet et doublure rouges. La veste, avec sa doublure blanche et la culotte étaient rouges. L'habit avait des pattes ordinaires garnies de six boutons jaunes, trois boutons sur le parement, boutons égaux d'un côté sur l'habit et des deux côtés sur la veste de deux en deux, trois aux poches de la veste. Ils avaient le chapeau bordé d'or.
Les mineurs avaient l'habit bleu garni d'une bande, parement, collet et doublure rouges. La veste et la culotte gris de fer, les boutons jaunes et le chapeau bordé d'or.
Les ouvriers avaient l'habit gris de fer garni d'une bande, parement et collet rouges. La veste, la culotte et la doublure de l'habit rouges, les boutons jaunes et le chapeau bordé d'or.
(1) L'artillerie existait dans l'armée depuis près de quatre siècles sous différentes dénominations en fonction du nom donné aux armes en usage, bouche à feu, bombarde, canon. Le caractère rudimentaire des premières armes n'avait pas permis de mettre sur pied des unités capables d'infléchir le cours d'une bataille. L'infanterie fut donc l'arme au sein de laquelle on organisa les premières unités utilisant ce type d'arme. Devenues performantes et incontournables, ces petites unités furent peu à peu regroupées pour devenir des corps autonomes. Cependant, l'artillerie restera classée parmi les régiments d'infanterie jusqu'au 1er janvier 1791.
(2) Ordonnance pour régler le service de l'artillerie dans les armées du 22 mai 1722.
L'habit de la cavalerie, des dragons, des hussards et de l'infanterie ayant été réglé, le comte d'Argenson (1), secrétaire d'État à la Guerre, s'occupa de celui de la maréchaussée qui n'avait pas évolué depuis l'ordonnance de 1720. Dans une nouvelle ordonnance du 10 octobre 1756 (pdf), le roi fixait à six ans le renouvellement des habits pour les exempts, brigadiers, sous-brigadiers, cavaliers et trompettes. L'aiguillette fut supprimée et remplacée pour les exempts par des ganses d'argent à queue et pour les brigadiers et sous-brigadiers par un galon autour de la botte de chaque manche. Les bottines à boucle de cuivre furent remplacées par des bottes molles.
Les exempts étaient habillés d'un justaucorps de drap fin d'Elbeuf, bleu de Roi avec parements et doublure écarlate; d'une veste couleur chamois, doublée de serge blanche, d'un surtout doublé de serge écarlate et d'un manteau bleu parementé de serge rouge-garance. Les brigadiers, sous-brigadiers et cavaliers, portaient un habit de drap croisé, bleu de Roi avec parements de drap écarlate et doublé de serge rouge-garance; une veste de drap couleur chamois, un surtout bleu doublé de serge rouge garance, le manteau de drap bleu. Les manches du justaucorps des cavaliers étaient garnies de six ganses à queue en fil blanc. Les brigadiers et sous-brigadiers avaient un galon de manche d'un pouce de large.
Toute la maréchaussée était habillée à l'identique et portait le chapeau de laine bordé d'un galon d'argent et orné d'une cocarde noire, le bouton et les galons argent ou de fil blanc pour les cavaliers. Il n'y avait pas de couleur distinctives pour les compagnies.
(1) Au cours de son ministère le comte d'Argenson fut, plus qu'aucun de ses prédécesseurs, celui qui se préoccupa le plus du bien être et de la santé du soldat. L'habillement ne pouvait échapper à sa sollicitude. Il introduisit l'usage des caleçons dans l'armée. Il voulut que chaque homme portât avec lui de quoi se nettoyer et se changer et la garniture du havre sac fut minutieusement fixée par ses règlements. C'est lui qui amena l'uniforme au dernier terme de son perfectionnement en soumettant à des mesures d'où il était défendu de s'écarter les moindres détails du vêtement et il astreignit sur ce point tous les officiers même les généraux à une obéissance aussi rigoureuse que les simples soldats.
En vertu de l'ordonnance du 8 décembre 1755, le ministre D'Argenson avait réuni en un seul corps les bataillons du Royal Artillerie, les compagnies d'ouvriers et de mineurs, les officiers de l'état major de l'artillerie et les ingénieurs. Les rivalités et les divergences ne tardèrent pas à se révéler entre ingénieurs et artilleurs ce qui eut pour conséquence de diminuer les capacités opérationnelles de chacune de ces spécialités. Deux mois après son entrée au ministère, le duc de Belle Isle dans une ordonnance du 5 mai 1758 (pdf), reconstitua les ingénieurs en un corps séparé sous le nom de corps du génie (1) et mit un terme à l'essai de fusion de son prédécesseur.
Les ingénieurs avaient l'habit bleu de roi à parements et revers de velours noir. Ils avaient la doublure, la veste et la culotte rouges, les boutons de cuivre doré jusqu'à la taille, cinq sur chaque poche, autant sur les manches.
(1) L'arme sera à plusieurs reprises réunie ou séparée de l'artillerie et ce n'est qu'en 1778 que la séparation sera rendue définitive. La révolution (1793) lui accordera sa réelle autonomie.
L'épaulette des soldats et cavaliers avait été créée dans le but de maintenir la bandoulière à laquelle était suspendue la cartouche ou demi-giberne. Les cavaliers en avaient reçu une seconde pour parer les coups de sabre sur les épaules.

Pour donner une distinction particulière à ses régiments de dragons, Louis XV, dans une ordonnance du 9 avril 1757 (pdf), modifiait la position de l'épaulette des dragons. L'aiguillette ayant été supprimée en 1750, elle avait été remplacée par une épaulette qui avait pour autre fonction de maintenir la bandoulière soutenant la cartouche. Le roi décida que cette épaulette d'ornement serait désormais portée à droite pour tenir lieu d'aiguillette. L'épaule gauche fut alors garnie d'un bouton et d'une patte d'épaule faite en drap couvert d'un galon de laine blanc avec une boutonnière permettant de passer la bandoulière soutenant la cartouche.
Les officiers, armés de l'épée, n'avaient pas eu besoin de cette pièce de tissu. L'épée se portait à gauche suspendue à un ceinturon. Les progrès techniques en matière d'armes à feu avaient fait abandonner peu à peu la pique au profit de ces nouvelles armes qui tenaient une place de plus en plus importante dans les régiments. Ainsi, on vit apparaître les compagnies de grenadiers, de fusiliers, de canonniers et de sapeurs. Les officiers commandant ces compagnies ne pouvaient rester en marge de cette évolution. Une ordonnance du 31 octobre 1758 (pdf), concernant l'armement des officiers et des sergents des compagnies des fusiliers et des grenadiers, modifiait leur armement. Désormais, ils devaient comme la troupe, être armés du fusil et de sa baïonnette. D'une facture plus soignée que celui de la troupe, le modèle fut arrêté par le roi afin d'assurer l'uniformité à l'égard des cartouches ou demi-gibernes qui devaient contenir huit cartouches à balles.
Le 9 décembre suivant (pdf), une nouvelle ordonnance complétait la précédente. C'est à cette occasion que les officiers reçurent à leur tour la patte d'épaule destinée à maintenir la bandoulière. Pour se différencier de la troupe, cette épaulette de drap fut couverte d'un galon d'or ou d'argent d'un pouce de large.
La cartouche des officiers des compagnies des fusiliers était ornée d'une fleur de lys d'or ou d'argent suivant la couleur du bouton, celle des officiers des compagnies des grenadiers d'une grenade d'or ou d'argent suivant le même principe. Les officiers supérieurs (colonels, lieutenants-colonels et commandants de bataillon) ne portant ni fusils ni giberne n'avaient pas d'épaulette et continuaient de se servir de l'esponton (pdf).
Par ordonnance du 27 février 1760 (pdf - extrait), le duc de Belle-Îsle réorganisa le corps royal d'artillerie et les compagnies de sapeurs. Il attribua aux officiers, artilleurs, sapeurs et bombardiers de ce nouveau corps, un habit bleu, garni d'une bande, parements, collet, veste, culotte et doublure rouges avec des boutons jaunes. Chaque épaule de l'habit reçut une épaulette formée d'une tresse jaune et terminée par une frange de même couleur, longue d'un pouce et un chapeau bordé d'or.
Les officiers, auxquels le roi avait imposé un habillement identique à celui de la troupe, utilisèrent l'épaulette pour renouer avec leur antique tradition de dentelles, de rubans et de galons d'or ou d'argent. Pour se prévaloir et se distinguer de la troupe, cet ornement fut bien vite l'objet de multiples fantaisies de leur part ce qui ne fut pas du goût du duc de Choiseul. Nommé Secrétaire d'État à la Guerre en février 1761 en remplacement du duc de Belle-Îsle, Choiseul allait être à l'origine d'une multitude de changements au sein des armées. L'épaulette, cette invention française fit partie de ces changements. Pièce de maintien ou d'ornement, elle allait faire l'objet d'une autre destinée et s'imposer dans toutes les armées du monde.
Pour comprendre ce qui poussa le nouveau Secrétaire d'État à la Guerre à entreprendre des réformes aussi profondes, il faut s'intéresser à l'état militaire de la France.
État militaire de la France
L'état militaire de la France connut deux grandes périodes sous le règne de Louis XV. La première bénéficiait encore de la droiture et de la sagesse des mesures imposées par Louvois, mais les grands principes, que ce ministre avait établis, allaient s'effacer peu à peu pour faire place à la corruption et à l'incompétence. Les anciennes rivalités entre le commandement et l'administration ne se révélèrent jamais avec autant de force que sous Louis XV.

La faiblesse du gouvernement et des ministres en fut la cause. Louvois n'était plus là pour imposer l'unité et forcer à l'obéissance. Tous les rouages militaires étaient relâchés. Le luxe et l'oisiveté avaient fait d'inquiétants progrès dans les armées. Les préceptes de Louvois sur la rigueur, la discipline et l'avancement au mérite furent dévoyés. De mesquines intrigues placèrent à la tête des armées des généraux de cour, dont les nominations se décidaient le plus souvent dans les boudoirs des favorites transformés en véritable salle du conseil. Ainsi depuis l'officier général jusqu'au simple soldat et à tous les degrés de la hiérarchie militaire, le goût du bien vivre avait remplacé celui du bien faire.
Avec des officiers généraux présomptueux et peu capables, auxquels il fallait rajouter la pléthore d'officiers supérieurs sans emploi (1), les chances de succès militaires à venir étaient fortement hypothéquées. Ainsi, au début des hostilités avec l'Angleterre en 1755, l'unité et la centralisation de Louvois avaient disparu et la confusion régnait dans les hautes sphères militaires du gouvernement. Cette ignorance doublée de prétention et de suffisance, cette faiblesse intéressée des généraux, peuvent suffire à expliquer nos désastres militaires, nos pertes matérielles et le honteux traité de Paris du 10 février 1763 qui termina la guerre de Sept Ans. La constitution militaire et l'organisation des régiments devaient subir des réformes capitales.
Le comte d'Argenson et le duc de Belle-Île avaient par différents remaniements, oeuvrés pour obtenir une armée de qualité, mais ces mesures avaient été menées dans leurs formes ancestrales et sous l'emprise d'un clientélisme qui avaient donné lieu à de nombreuses ordonnances particulières. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'ordonnance du duc de Belle-Île du 25 février 1760. Ce document de 153 pages sur la solde des troupes est d'une complexité absolue tant les particularités des régiments et les privilèges accordés aux officiers par le roi y sont nombreux. Les régiments étaient toujours levés au nom de leur propriétaire, la hiérarchie comprenait des grades fantaisistes permettant de remployer les officiers des régiments licenciés, les capitaines recevaient toujours des fonds pour les frais de levée de leur troupe, pour leur habillement, leur équipement et autres dépenses. Ils recevaient des gratifications lorsque leur compagnie était complète. Des centaines de soldats surnuméraires étaient entretenus dans les régiments.
Le duc de Choiseul remet de l'ordre
La réorganisation des troupes fut menée par le duc de Choiseul, secrétaire d'État de la Guerre, qui s'y employa avec toute son énergie. Pour mettre fin à ces pratiques et disposer d'une armée solide et homogène, il fallaitla remettre dans les mains du roi.

Une ordonnance du 10 mars 1749 avait déjà retiré aux capitaines et mestres de camp le commandement de leur compagnie ou régiment. Ils en gardaient néanmoins la propriété. Pour soumettre pleinement les régiments à la volonté du pouvoir royal, il prit plusieurs mesures qui allaient être à l'origine d'une nouvelle conception de l'état militaire.
Tout d'abord, Choiseul fixa par arme le nombre de régiments qu'il entendait conserver. Ceux qui étaient supprimés servaient à compléter ceux qui étaient maintenus, tous les officiers et soldats en exédants furent réformés et renvoyés chez eux. Il profita de ce brassage pour retirer aux régiments le nom de leur propriétaire et leur donna un nom de province. Il fit de même avec les brigades auxquelles on retira le nom de leurs mestres de camp pour les désigner sous le vocable de première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième brigade. Il déchargea les capitaines du soin de faire des recrues. Désormais c'est le roi qui s'occupait du recrutement et qui se chargeait de faire compléter les compagnies.
Cette première étape accomplie, Choiseul structura les nouveaux régiments afin de leur donner par arme, une composition et une organisation unique et invariable. Pour y parvenir, il réorganisa la chaîne de commandement en créant un fourrier (2) dans chaque compagnie, un sous-aide-major par bataillon pour seconder le major, un trésorier (3), un quartier-maître (4), un sous-lieutenant et un tambour-major (5) par régiment. Il supprima le grade d'anspessade pour le remplacer par celui d'appointé (6), supprima les prévôtés, supprima les enseignes pour les remplacer par des porte-drapeaux (7). La charge de major devint un grade supérieur à celui de capitaine et commandait le régiment en l'absence du colonel et du lieutenant-colonel. Le grade de lieutenant-colonel devint un grade à part entière (8).
Après avoir réglé les fonctions de chacun, il subdivisa tous les corps suivant un principe unique de sorte que l'on trouvât à chaque subdivision de même niveau, un chef de même rang hiérarchique quelque soit l'arme. La plus petite unité créée fut l'escouade commandée par un caporal pour les armes à pied ou un brigadier pour les armes montées. Cette organisation uniforme permit de conserver le même nombre de régiments en temps de paix comme en temps de guerre. En effet, en cas de conflit on accroissait simplement l'effectif des escouades. Cet astucieux procédé permettait, tout en conservant le même encadrement, d'augmenter le volume des armées pour atteindre l'effectif désiré. Ainsi, plus de régiments formés à la hâte aux capacités guerrières bien souvent médiocres, plus de licenciement de régiments à la fin de la guerre, plus d'officiers à entretenir à la suite de ces licenciements.
(1) Les officiers sans emploi étaient la conséquence de la politique de diminution des effectifs de l'armée en temps de paix. Pour mener une guerre, le roi faisait lever de nouveaux régiments qui venaient grossir ceux qui étaient entretenus en temps de paix. Les frais de ces enrôlements étaient excessifs et la valeur de ces régiments était médiocre dans la mesure où ces corps étaient dépourvus d'expérience militaire. La paix revenue, les corps levés étaient licenciés et on réduisait les effectifs des corps maintenus pour ménager le trésor. Cette mesure, qui nuisait grandement à la solide composition de l'armée, réduisait faiblement les charges du trésor, car les officiers des corps licenciés, désormais sans emploi, continuaient de recevoir leurs appointements.
(2) Cette dénomination dérive du mot fourrage qui lui-même dérive du mot foderagium, qui signifie aliment. Les fourriers étaient subordonnés aux quartiers-maîtres. Ils étaient chargés des détails de subsistance, des distributions, du logement, du campement et de la propreté. C'est pour cette raison qu'ils furent d'abord appelés des sergents d'affaires. Ils avaient rang de dernier sergent.
(3) Le trésorier était chargé d'administrer la caisse du corps. Il établissait des états de recettes et de dépenses qu'il signait avec le major et le commandant du corps.
(4) Le quartier-maître avait rang de sous-lieutenant. Il commandait tous les fourriers et était chargé du logement, du campement et des distributions.
(5) Le tambour-major avait rang de sergent et commandait tous les tambours des compagnies.
(6) Les appointés étaient les plus anciens grenadiers ou fusiliers de la compagnie. Ils remplaçaient les caporaux pendant leur absence.
(7) Le porte-drapeau était tiré du corps des sergents et avait rang de dernier lieutenant.
(8) Lieutenant-colonel était le titre donné au capitaine qui commandait la compagnie colonelle c'est-à-dire la compagnie qui, au sein d'un régiment, restait la propriété du colonel. Il était le lieutenant du colonel et fut appelé, dans ce contexte, capitaine-lieutenant. Le lieutenant du colonel eut à son tour sa compagnie, la lieutenante-colonelle qu'il fit commander par un représentant dans la cavalerie comme dans l'infanterie.
Avant l'ordonnance du 10 décembre 1762, un capitaine passait lieutenant-colonel par le droit de l'ancienneté. Avec cette ordonnance le roi se réserva le choix à cet emploi. Le grade de colonel était souvent donné à des officiers qui n'avaient d'autre titre que la faveur, la place de lieutenant-colonel devint le partage des officiers expérimentés.
Avec un nombre de régiment fixe, Choiseul pouvait désormais imposer à chacun d'entre eux un modèle d'uniforme et ses couleurs de distinction. Pour éteindre définitivement les choix vestimentaires décidés par les propriétaires des compagnies, il enleva aux capitaines l'entretien de leurs soldats. Toutes les dépenses, les profits et les pertes furent mis à la charge de l'État. Cette mesure permit de mettre à la discrétion de tous les ministres qui lui succéderont, toutes les modifications qui seront apportées à l'uniforme.

Les ordonnances s'étaient attachées jusqu'alors à décrire le modèle et les couleurs distinctives des effets pour chaque régiment. Ainsi, le bleu foncé et le rouge vif étaient les couleurs de la maison du roi. Le bleu avait été attribué plus particulièrement au garde du corps, aux gardes-françaises et aux grenadiers à cheval. Le rouge distinguait les Suisses, les gendarmes et les mousquetaires. Dans la troupe de ligne, le rouge garance et le bleu céleste appartenaient aux corps étrangers, tandis que toutes les nuances du gris et du brun avaient été combinées avec des doublures de couleurs voyantes pour caractériser les régiments français. Choiseul imposa à tous les régiments d'infanterie l'habit blanc avec des marques distinctives pour chacun, auquel les colonels devaient se conformer strictement sous peine de sanction.
C'est également à compter de cette époque que la forme de l'habit évolua. Il devint plus dégagé. On l'échancra au niveau de la ceinture afin de mettre à découvert le ceinturon qui fut porté sur la veste. On ajouta des revers de couleur sur la poitrine, des pattes boutonnées sur les épaules. On retroussa à l'aide d'agrafes les pans du vêtement, ils nuisaient au maniement d'armes. On adopta la culotte étroite et les longues guêtres de toile ou de drap qui avaient le défaut de comprimer les muscles des jambes. Le soldat fut alors condamné au port de trois jarretières à chaque jambe, une pour tenir le bas, une autre pour fermer la culotte, la troisième pour arrêter la guêtre. Le col noir et droit fit son apparition. Le cou du soldat fut alors emprisonné dans un étau barbare. On suspendit la giberne, portée avec raison autour de la taille, à un baudrier passant de gauche à droite. Le tricorne reçut aussi une forme plus commode.
Le corps royal de l'artillerie conserve le bleu et le rouge
Ce corps fut augmenté de trois brigades par ordonnance du 5 novembre 1761, afin qu'il fût en mesure d'assurer le service de l'artillerie de terre et celui de l'artillerie de marine. Ces trois brigades, commandées chacune par un chef de brigade, furent installées à Brest, Rochefort et Toulon.
Son uniforme, identique aux autres brigades du corps, fut défini par l'ordonnance du 27 février 1760. Il était composé d'un habit bleu garni d'une bande, parement, collet, culotte et doublure rouges. Pour se différencier, seule la veste bleue avait une doublure blanche. Ils avaient les boutons jaunes, une épaulette formée d'une tresse jaune terminée par une frange de même couleur sur chaque épaule de l'habit et le chapeau bordé d'or.
L'infanterie s'habille de blanc
Suivant l'ordonnance du 10 décembre 1762 (pdf - extrait), les régiments d'infanterie furent mis à un, deux ou quatre bataillons. Les bataillons (1) étaient composés de neuf compagnies (2) dont une de grenadiers et huit de fusiliers. Chaque compagnie fut subdivisée en escouade (3) commandée par un caporal secondé par un appointé. Vingt-trois régiments à un et deux bataillons furent affectés au service de la marine, des colonies et des ports. Tous les régiments furent désignés par un nom de province.

À compter de cette date, toute l'infanterie reçut le justaucorps et la veste de drap gris-blanc, piqué de bleu, doublés de cadis ou serge blanche, la culotte de tricot de même couleur. La distinction entre régiments se fit alors sur les couleurs des parements, revers et collet qui avaient été réglés pour chaque corps, par la forme des poches, sur la quantité et le modèle de bouton fixé pour chaque régiment. Le bouton jaune ou blanc suivant le régiment était de forme plate et portait le numéro du régiment. Les revers, garnis de petits boutons de veste, étaient de dimension identique pour tous les régiments d'infanterie. Les fantassins étaient coiffés du chapeau bordé d'or ou d'argent.
Comme nous l'avons précisé ci-devant, la forme de l'habit fut modifiée. On l'échancra sur le devant afin de mettre à découvert la veste sur laquelle était désormais porté le ceinturon. Les fantassins reçurent les guêtres de toile longues qu'ils mettaient sur les bas afin de protéger leurs jambes du froid et de la pluie. Les ailes du tricorne furent plus resserrées afin de donner moins d'ampleur au chapeau.
Ce fut l'occasion pour le ministre de revenir sur l'épaulette inventée par son prédécesseur. Cette pièce d'habillement devenue l'objet de fantaisie et de bizarrerie de la part des officiers changea de destination. Elle ne servit plus à distinguer les compagnies, mais la qualité et le rang des officiers. Un règlement du 12 janvier 1759 en prescrivit l'emploi, mais ce fut l'ordonnance du 10 décembre 1762 qui mit ce signe distinctif en usage. Ainsi, le colonel dû porter sur chaque épaule une épaulette en or ou argent ornée de franges riches à nœuds de cordelières, le Lieutenant-colonel n'en porta qu'une sur l'épaule gauche, identique à celle du colonel. Le major porta deux épaulettes en or ou en argent, ornées de franges simples, le capitaine n'en porta qu'une. Le lieutenant porta l'épaulette pleine en argent losangée de carreaux de soie jaune ou blanche suivant la couleur du bouton, le sous-lieutenant portait l'épaulette à fond de soie jaune ou blanche avec des carreaux d'or ou d'argent suivant le bouton.
Le roi renouvelait l'interdiction aux officiers de « ne porter, sous nul prétexte que ce soit, un galon, fil d'or ou d'argent à son uniforme ». Ces mesures, qui remettaient de l'ordre dans les uniformes des officiers et permettaient à la troupe de connaître promptement leur position hiérarchique, offensèrent leur orgueil. Pour exprimer tout leur mépris à l'égard de l'épaulette, ils la surnommèrent « la guenille de monsieur Choiseul ».
Avec l'ordonnance du 30 juin 1763, Choiseul appliqua au corps du Royal-Artillerie les principes qu'il venait d'imposer à l'infanterie. L'habit bleu et effet rouge furent maintenus à quelques détails près et les grades furent distingués suivant le même modèle de ceux adoptés pour l'infanterie.
(1) Les commandants de bataillon furent supprimés et cette charge fut assurée par le plus ancien des capitaines du bataillon.
(2) La compagnie était à l'effectif de 70 hommes, officiers compris. Elle était commandée par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant.
(3) L'escouade était à l'effectif de sept hommes, caporal et appointé compris. Le sergent commandé deux escouades.
La cavalerie s'habille de bleu
Une ordonnance du 21 décembre 1762 (pdf - extrait), calquée sur la précédente, réorganisait le corps de la cavalerie suivant les mêmes principes. Les régiments étaient composés de quatre escadrons à deux compagnies chacun. Le titre de cornette fut remplacé par le grade de sous-lieutenant. Il fut créé quatre maréchaux des logis (1), un fourrier dans chaque compagnie, un second aide-major, un sous-aide-major, un trésorier, un quartier-maître (2), un timbalier par régiment, un porte-étendard par escadron. Le major eut autorité sur les capitaines.
C'est à l'occasion de ce remaniement que tous les régiments de cavalerie furent habillés de bleu. L'état des uniformes de chaque régiment avec leurs couleurs distinctives fut décidé par la couronne. Il fut interdit, sous peine de désobéissance, de n'y porter aucune modification. Comme pour l'infanterie la distinction des régiments se fit sur la couleur qu'on leur assigna et que l'on appliqua aux parements, revers et collet. Avec le justaucorps garni de boutons blancs pour les trois premiers régiments et jaunes du n°4 au n°31, les cavaliers portaient le buffle en forme de veste courte et la culotte chamois. Ils étaient coiffés d'un chapeau, bordé d'un galon de laine ou de fil blanc ou aurore, assez haut pour être garni de la calotte en fer. Un manteau de drap gris-blanc, parementé sur le devant d'une serge de la couleur des doublures de l'habit complétait leur uniforme.
Les sous-officiers et cavaliers portaient une épaulette de la couleur du régiment. L'habit uniforme des officiers était semblable à celui des cavaliers hormis la qualité du drap. À l'instar des officiers de l'infanterie, ils reçurent l'épaulette permettant de distinguer leur grade. Le procédé fut identique en tous points à celui de l'infanterie. Les maréchaux des logis, fourriers, brigadiers et carabiniers se distinguaient par des galons de manche.
(1) Les compagnies étaient divisées en escouades. Chaque escouade de cinq hommes était commandé par un brigadier, deux escouades par un maréchal des logis. Les maréchaux des logis avaient les mêmes fonctions que celles des sergents dans l'infanterie, toutefois le roi leur accorda le rang de premier bas-officier (sous-officier).
(2) Le quartier-maître avait rang de sous-lieutenant et commandait tous les fourriers.
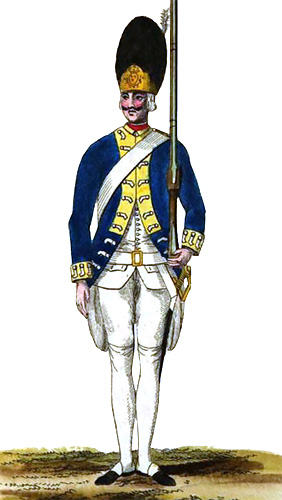
Les grenadiers de France abandonnent le rouge pour le jaune citron
Le régiment des grenadiers de France reçut par ordonnance du 21 décembre 1762 (pdf) le nom de corps des grenadiers de France. Il était divisé en quatre brigades de douze compagnies chacune. Ce corps fut organisé comme l'infanterie. Les grenadiers conservèrent l'habit bleu, mais eurent les revers, le collet, les parements et la doublure couleur citron, avec des agréments blancs sur l'habit. Ils avaient des poches ordinaires garnies de trois gros boutons et autant sur le parement, sept petits au revers et quatre gros dessous. Ils reçurent la veste et la culotte blanches. Ils avaient les boutons blancs et plats avec une rose au milieu.
Ils recevaient à cette occasion le bonnet de peau d'ours (1) orné sur le devant d'une plaque blanche, timbrée de l'écusson aux armes du Roi et garni de cordons et galons de fil blanc. Le derrière était couvert de drap de la couleur du parement. Indépendamment du bonnet, ils recevaient un chapeau. L'uniforme des officiers ne différait que par la qualité du drap.
(1) Le bonnet à poil est une invention du roi de Prusse (le père du grand Frédéric). Les grenadiers prussiens comme les grenadiers français étaient armés du fusil qu'ils portaient en bandoulière pendant le jet des grenades. Les grands chapeaux étaient incommodes pour cette manœuvre, c'est pourquoi le roi de Prusse les remplaça par des bonnets pointus garnis de plaques de cuivre et recouverts d'une peau d'ours. Cette coiffure fut rapportée en France à une époque où l'on ne lançait déjà plus de grenades. Malgré tout, les grenadiers à cheval l'adoptèrent les premiers. Peu à peu, les colonels d'infanterie en donnèrent aux grenadiers de leurs régiments. D'autres trouvèrent préférable le bonnet pointu monté sur une forme de carton sans fourrure.
Les dragons prennent l'habit vert
Les dix-sept régiments de dragons, maintenus par l'ordonnance du 21 décembre 1762 (pdf - extrait), reçurent la même organisation que ceux de la cavalerie. Choiseul imposa le vert pour la couleur du fond d'habit pour tous les régiments, supprima les divers ornements qu'ils s'étaient attribués et enjoignit aux mestres de camp de se conformer strictement aux couleurs distinctives qu'il avait fixé pour chacun d'eux.

L'uniforme était composé d'un justaucorps de drap vert, doublé de cadis ou serge de même couleur, orné de parements, collet et revers dans les couleurs réglées pour chaque régiment. Les poches, revers et parements étaient garnis de boutons jaunes pour les deux premiers, blancs pour les quinze autres. Ils étaient timbrés au numéro du régiment. Ils portaient la veste de drap chamois doublée de blanc avec des poches figurées et la culotte chamois. Ils reçurent pour coiffure le casque. Un manteau de drap gris-blanc, parementé sur le devant de cadis vert, garni de trois doubles brandebourgs en laine, un surtout en étoffe de laine verte croisée pour le pansage des chevaux complétaient leur habillement.
Les fourriers, brigadiers, appointés et dragons portaient l'aiguillette de laine réglée dans la couleur de chaque régiment sur l'épaule droite. Le maréchal des logis portait l'aiguillette en soie blanche. Comme pour l'infanterie, tous, portaient l'épaulette de drap sur l'épaule gauche pour maintenir la bandoulière.
L'uniforme des officiers était semblable à ceux des dragons et ne différait que par la qualité des draps d'Elbeuf et celle des boutons dorés ou argentés.
Les signes distinctifs des grades étaient un peu différents de ceux de la cavalerie. Ainsi, le colonel portait sur l'épaule droite une aiguillette et sur la gauche une épaulette garnie de franges à nœuds de cordelières, de graines d'épinard et de jasmins d'or ou d'argent. Le lieutenant-colonel portait l'aiguillette et l'épaulette garnie que de graines d'épinard et nœuds de cordelières, sans jasmins. Le major portait les mêmes ornements, mais l'épaulette n'était garnie que d'une frange simple. Le capitaine portait l'aiguillette et l'épaulette comme celle du major, mais sans franges. Le lieutenant portait l'aiguillette de soie blanche mêlée de deux tiers d'or ou d'argent et l'épaulette à carreaux de soie, sur un fond de tresse d'or ou d'argent. Le cornette ou sous-lieutenant portait l'aiguillette à deux tiers de soie jaune ou blanche, avec un tiers d'or ou d'argent et l'épaulette en tresse losangée d'or ou d'argent, sur un fond de soie blanche. Les porte-guidons et quartiers-maîtres portaient l'aiguillette de sous-lieutenant et l'épaulette lisérée d'or ou d'argent.
Les maréchaux des logis avaient le parement de leur manche bordé d'un galon d'or ou d'argent fin. Les fourriers portaient à chaque manche, au-dessus du coude, deux bandes de galon d'or ou d'argent. Les brigadiers avaient au parement un double galon de fil ou laine blanche ou jaune suivant la couleur du bouton, les appointés n'en avaient qu'un.
Les hussards abandonnent le bleu céleste pour le vert
Une autre ordonnance du 21 décembre 1762 (pdf - extrait) organisait les régiments de hussards. Les trois régiments existants étaient conservés. Ils étaient composés de douze compagnies formant trois escadrons en temps de paix et six en temps de guerre. Ces formations reçurent la même organisation que la cavalerie. Les officiers et les sous-officiers, similaires à ceux de la cavalerie, eurent le même rang, fonction et prérogatives.
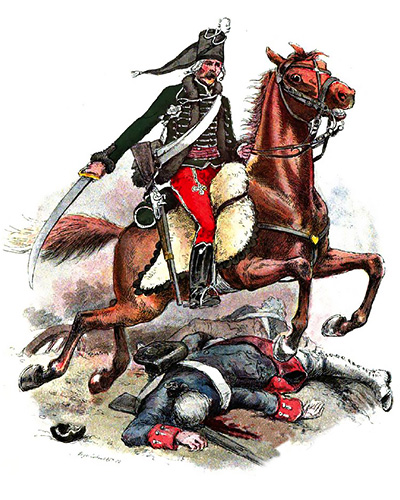
Tous les hussards abandonnèrent le bleu céleste et reçurent l'habit en drap vert, façonné à la hongroise. Ils avaient la pelisse de drap vert bordée d'un galon avec la poche et le retroussis bordés du même galon, garnis de trois rangées de boutons ronds en étain. Les boutonnières étaient faites en cordonnet cousu en forme de trèfle. La doublure était de peau de mouton blanc, bordée d'une peau noire. La veste, plus courte que la pelisse était confectionnée de la même manière et avait le bas garni d'un morceau de peau. L'extrémité de la manche était garnie d'un morceau de drap de la couleur attachée à chaque régiment. La culotte à la Hongroise, était de drap rouge-garance avec les coutures recouvertes d'un cordonnet.
Les bonnets ou schakos en feutre noir étaient doublés et bordés d'un morceau d'étoffe de la couleur du régiment. Ils étaient ornés sur le devant d'une fleur de lys. L'écharpe était composée de laine cordonnée, de couleur rouge-garance et de la couleur du régiment. Le manteau avec le capuchon était de drap vert parementé de cadis ou serge verte et garni de trois agréments en laine de chaque côté.
Les sabretaches en drap rouge étaient ornées d'une fleur de lys de la couleur du régiment.
À cause de leur tenue spéciale, ils ne purent recevoir l'épaulette. La distinction des grades s'appliqua sur l'habit et sur la sabretache. Les maréchaux des logis avaient une broderie de trois cordonnets de soie sur la manche de la pelisse, de la veste et autour des poches de la culotte; la sabretache était bordée de trois cordonnets de même. La bordure de la pelisse était en dos de renard, au lieu d'être, comme celle des fourriers, brigadiers et hussards, de peau de mouton noir. Les Fourriers portaient cette broderie, mais à deux cordonnets, les brigadiers à un cordonnet.
Les habits uniformes des officiers étaient semblables à ceux des hussards sauf pour la qualité du drap. L'ornement distinctif du grade était constitué pour le mestre de camp d'agréments en galons large, avec des cordonnets en argent. Les manches de la pelisse et de la veste, le tour des poches et de la culotte étaient brodés de trois cordonnets d'argent. La sabretache était bordée d'un galon d'argent et ornée d'une frange avec graines d'épinard et nœuds de cordelières.
Le lieutenant-colonel portait les mêmes agréments que le mestre de camp, mais constitués de galons moins larges. Les manches de la pelisse et de la veste étaient bordées de deux cordonnets en argent seulement. La sabretache était ornée d'une frange d'argent sans graine d'épinard ou nœuds de cordelières.
Le major portait le même type de broderie, mais constitué d'un seul cordonnet, la sabretache était sans franges. Les capitaines portaient les mêmes galons que le major, et la sabretache de même, mais sans aucune broderie aux manches, aux poches de culotte et à la sabretache. Les lieutenants portaient les mêmes broderies que le capitaine, mais constitué d'un galon plus étroit et encore plus fin pour les sous-lieutenant.
Les gendarmes conservent l'écarlate
L'ordonnance du 5 juin 1763 réorganisa les dix compagnies d'ordonnances de la gendarmerie qui furent conservées. On compléta leur effectif en leur incorporant les compagnies de chevaux légers supprimées. Chaque compagnie forma un escadron subdivisé en trois brigades. Chaque brigade était divisée en quatre escouades, deux commandées par un brigadier et deux par un sous-brigadier. Les maréchaux-des logis commandaient deux escouades. Il fut créé à l'occasion de cette réorganisation deux sous-aides-majors avec rang de premiers maréchaux-des-logis, de deux fourriers-majors avec rang de derniers maréchaux des logis pour commander les trois fourriers créés dans chaque compagnie et douze places de gendarmes appointés. Les fourriers étaient chargés du logement, du campement, des distributions et autres fonctions relatives à la discipline, aux exercices, aux réparation du matériel, des tenues etc.
La gendarmerie conserva l'habit de drap écarlate avec revers, collet et parements de même drap, bordé d'un galon d'argent et garni de boutons argentés. La doublure, la veste, la culotte et les gants étaient couleur chamois. Les gendarmes perçurent un manteau de drap écarlate, doublé en entier de serge rouge et parementé de couleur chamois. Le chapeau bordé d'un large galon était orné de la cocarde blanche. Les gendarmes portaient la cravate noire, les bas blancs et les souliers à boucle, la bandoulière et l'épaulette constituée d'un galon d'argent mêlé de soie de la couleur affectée à la compagnie sur l'habit et le manteau.
Pour se distinguer, les gendarmes appointés portaient un grand galon de plus sur la manche, les porte-étendards et les fourriers avaient un bout du même galon sur les coutures supérieure et inférieure du parement. Les fourriers-majors avaient les habits galonnés à la bourgogne, avec le bordé et le galon pour les agréments de l'uniforme des maréchaux-des-logis; les coutures supérieure et inférieure du parement étaient aussi galonnées.
L'ordonnance du 1er janvier 1766 (pdf - extrait), réglant l'exercice de l'infanterie, supprima l'esponton (1). Les officiers supérieurs, colonels, majors, aides-majors et sous-aides-majors eurent pour toute arme des épées qu'ils devaient tenir en main toutes les fois qu'ils étaient sous les armes. Les officiers subalternes étaient armés du fusil et de sa baïonnette, de l'épée et de la giberne. Tous les officiers conservaient le hausse-col. Les sous-officiers et les appointés avaient le fusil et le sabre, les soldats uniquement le fusil. Ces armes blanches introduisirent dans la tenue un nouveau modèle de ceinturon que tous les officiers, sous-officiers et soldats devaient porter sur la veste.
(1) L'esponton, de l'italien spuntone, pointu, était une pique dont on avait raccourci le manche de moitié.
C'est à l'occasion de la création de la légion pour servir à Saint-Domingue que fut arrêté un uniforme qui devait prendre en compte le climat du lieu d'emploi. L'ordonnance du 1er avril (pdf - extrait) fixait l'uniforme de la manière suivante : un justaucorps de drap léger bleu appelé petit Lodève bleu. Il était doublé d'une toile gris-blanc, avait les parements bleus, le collet et les revers rouges. Une veste en drap léger blanc, appelé petit Lodève blanc, doublée de toile, sans poches ; une culotte de tricot blanc, avec caleçon de toile séparé. Ils avaient les boutons blancs timbrés d'une ancre et le chapeau bordé de galon blanc.
Les distinctions pour les fourriers et sergents étaient en galon d'argent comme dans les autres corps d'infanterie. Celles pour les caporaux et les appointés, en galon de fil blanc. Les canonniers portaient sur le bras gauche un galon de fil blanc, cousu en chevron.
L'habit des officiers était identique à celui de la troupe sauf pour la qualité du drap. La distinction des grades était la suivante : pour l'inspecteur-commandant : deux épaulettes en tresse d'argent brodée d'une mosaïque en paillettes, garnie de franges en nœuds de cordelières et jasmins. Le major général portait les mêmes épaulettes, mais sans broderie. Les majors particuliers portaient deux épaulettes de tresse d'argent, garnie d'une frange en filet simple, sans nœuds de cordelières et jasmins. Les capitaines et les aides-majors portaient une seule épaulette identique à celle des majors particuliers. Les lieutenants portaient une épaulette à fond de tresse d'argent et mosaïque de soie rouge, garnie d'une frange de filés d'argent et de soie assortie. Les sous-lieutenants portaient l'épaulette à fond de soie rouge, avec une mosaïque en argent et franges mêlées de filés d'argent et de soie. Le quartier-maître portait l'épaulette en fond de soie rouge lisérée d'argent.
Le 25 avril 1767 parut un règlement (pdf - extrait) qui réunissait en un seul livret l'ensemble des règlements concernant l'habillement et l'équipement de l'infanterie, de la gendarmerie, de la cavalerie, des hussards, des dragons et des troupes légères. Cette ordonnance renouvelait en partie les ordonnances précédentes.
Ce règlement introduisait quelques nouveautés, dont l'interaction de l'homme et de l'uniforme. L'uniforme ayant été ajusté au corps de chaque homme, il ne devait pas représenter une entrave et le soldat devait pouvoir se mouvoir avec aisance sans risquer de le déchirer. Il ne s'agissait plus de vêtir des hommes avec un habit uniforme, mais de faire porter avec fierté un uniforme à des soldats. Les maîtres tailleurs reçurent des instructions précises et furent dans l'obligation de reprendre à leurs frais, tout vêtement mal ajusté. La longueur du vêtement devait également être en rapport avec la taille de l'homme, aussi, pour obtenir cette longueur raisonnable, on fixa la distance qui devait séparer le bas de l'habit du sol, le soldat étant à genoux. Ce type de mesure allait se perpétuer pendant plus d'un siècle.
L'uniforme étant ajusté, on se soucia de son entretien. Pour cela on prohiba certains procédés reconnus caustiques et corrosifs et l'on préconisa une série de produits pour l'entretien des tissus et des cuirs.
L'hygiène corporelle individuelle fit également l'objet de prescriptions particulières. Ainsi, les cheveux, dont on n'exigeait pas qu'ils fussent coupés courts (1), durent, soit être retroussés en cadenette (2) sous le chapeau pour l'infanterie, soit liés en queue par une rosette pour la cavalerie. Les cheveux au-dessus des oreilles devaient être roulés sur une lame de plomb ou sur un carton.
La cocarde noire fut abandonnée et chaque soldat dut se fournir d'une cocarde de basin blanc qu'il fixa au chapeau. Cette marque particulière devait se perpétuer et le blanc devint le signe supérieur du commandement militaire par la plume blanche au chapeau des maréchaux de France et par l'aigrette blanche à la coiffure des colonels. Indépendamment du chapeau, chaque soldat reçut un bonnet de police.
(1) Les hommes de toutes armes tenaient pour une marque d'infamie d'être tondus, en un temps où l'on ne tondait que les galériens.
(2) La cadenette était une tresse partant du milieu du crâne et se retroussant sous le chapeau.
L'infanterie
Ainsi, les fantassins retroussèrent leurs cheveux sous le chapeau qui fut orné à cette occasion de la cocarde blanche. Ils reçurent l'épaulette liserée du drap de la couleur de leur compagnie sur l'épaule gauche de leur habit. Les grenadiers (1), y compris les officiers, conservaient, en sus du chapeau, le bonnet de peau d'ours avec, sur le devant, une plaque de cuivre jaune portant l'écusson aux armes du roi et garni de cordons et de fils blancs. Le derrière était recouvert de drap de la couleur du parement.

Pour économiser le chapeau, le bonnet de police fit son apparition au sein des effets réglementaires pour le service intérieur et dans les camps. Il était en forme de pokalem ou bonnet de courrier et comportait sur le devant une fleur de lys en drap blanc cousue sur une pièce de drap de la couleur distinctive du régiment.
Chaque soldat en fut équipé. Ils étaient confectionnés avec les chutes des coupes ou taillés dans les vieux habits. Son tour était rabattable pour couvrir les oreilles.
Les marques distinctives des grades des fourriers, sergents, caporaux et appointés étaient identiques pour toute l'infanterie et se matérialisaient par une série de galons plus ou moins larges sur les manches.

Les soldats reçurent le havresac (2) en peau de veau à poil, doublé d'une toile forte. Jusqu'alors, les havresacs étaient en coutil et ressemblaient à de vulgaires besaces qui ne garantissaient pas de la pluie. Les havresacs en peau garnie de leurs poils permirent de garder au sec les objets transportés et grâce à leur rigidité de donner à ce sac à dos une dimension unique pour toute la troupe. Ce sac fut cloisonné pour recevoir un équipement réglementaire où chaque objet avait sa place (linge de rechange, paire de souliers, pain de munition (3), ustensiles d'entretien, sac à poudre).
Avec le sabre-briquet pour armement en sus du fusil, le ceinturon disparut pour faire place aux bufflèteries en croix sur la poitrine. L'ensemble des cuirs consista alors en deux lanières de cuir blanc. Un baudrier passant sur l'épaule droite et venant soutenir sur le côté gauche le sabre courbe à poignée de cuivre dans son fourreau de cuir noirci et la bandoulière, de même nature, passant sur l'épaule gauche pour soutenir, côté droit, la giberne de cuir noir, propre à recevoir quinze cartouches d'artillerie.
L'habillement des officiers était identique à celui de la troupe sauf pour la qualité du drap. Les officiers d'état-major se distinguaient par le galon d'argent et la cocarde blanche qui ornaient leur chapeau. Toutes fioritures, dentelles, galons ou passepoil étaient formellement interdits. Les marques distinctives des grades des officiers, réalisées par le jeu des épaulettes décidées par l'ordonnance de 1762, furent maintenues. Tous les officiers reçurent à cette occasion le hausse-col en cuivre doré et orné en son milieu d'un médaillon en argent aux armes du roi. Les officiers subalternes étaient armés du fusil et de sa baïonnette, les officiers supérieurs de l'épée.
(1) Le corps des grenadiers de France fut licencié par ordonnance du 4 août 1771 sous le ministère du marquis de Monteynard.
(2) Mot emprunté aux reîtres allemands qui le nommait sac à avoine (de Hafer, avoine et Sack, sac)
(3) En vieux français, le terme de munition s'employait pour désigner tout ce qui était nécessaire à l'approvisionnement des armées. Ainsi parlait-on de munition de bouche pour désigner les vivres destinés à l'armée. Le pain de munition était la ration de pain que l'on distribuait au soldat. Il était composé de farines de seigle et de froment blutées à un pourcentage plus ou moins élevé de son. Suivant les époques, le poids de la ration et le pourcentage de farine de seigle, de froment et de son ont varié. Pour exemple, l'ordonnance du 1er mai 1758 disposait que le pain serait composé d'un tiers de seigle et deux tires de froment. En 1776, Saint-Germain adopta le méteil, moitié blé et moitié seigle avec extraction de vingt livres de son, en 1778 on fixait le seigle pour un quart, mais sans extraction de son.

Le royal artillerie
L'uniforme du corps royal de l'artillerie continua d'être composé d'un habit de drap bleu de roi avec parements, collet et doublures rouges. Ses boutons furent timbrés du numéro 47. Pour distinguer les plus anciens sapeurs, canonniers, artificiers et bombardier, il fut décidé de leur attribuer un galon jaune cousu en chevron qu'ils portaient sur le bras gauche. Ce fut la première utilisation du galon en chevron brisé.
La gendarmerie
L'habit de la gendarmerie était de drap écarlate avec revers, collet et parements de même drap, bordé d'un galon d'argent et garni de boutons argentés. La doublure, la veste, la culotte et les gants étaient couleur chamois. Le manteau de drap écarlate était doublé en entier de serge rouge et parementé de couleur chamois. Le chapeau bordé d'un large galon était orné de la cocarde blanche. Ils portaient la cravate noire.
Les gendarmes à pied avaient les bas blancs et les souliers à boucle, les gendarmes à cheval avaient les bottes fortes à genouillère avec les éperons. La bandoulière blanche était bordée d'un galon d'argent d'un côté et avait son milieu rempli par un galon de soie de la couleur affectée à la compagnie. L'épaulette était constituée d'un galon d'argent mêlé de soie de la couleur de la compagnie.
Les cheveux étaient noués en queue liés par une rosette. La distinction des grades du gendarme appointé au brigadier se faisait par la combinaison de galons, de brandebourgs et d'épaulettes. L'habit des officiers, fait de drap rouge était richement orné de galons à festons et à crêtes, brandebourgs et boutons en argent. Le chapeau était bordé du même galon à festons et à crête. L'uniforme des maréchaux des logis était identique à celui des officiers à l'exception du galon qui était sans crête.
La cavalerie
La cavalerie devait elle aussi subir quelques changements notables. L'uniforme des gradés et cavaliers allait dorénavant être exécuté à la polonaise. Ils recevaient la veste en drap chamois. Indépendamment des effets d'uniforme, il fut introduit dans l'arme le surtout et les gilets destinés à être utilisés à l'intérieur du quartier pour le soin des chevaux. Les culottes, faites en peau descendaient jusqu'au mollet. Ils conservaient le chapeau, mais les cheveux devaient être liés en queue et tenus par une rosette de cuir. Les marques distinctives des fourriers, maréchaux des logis, brigadiers et carabiniers se faisaient à l'aide de bandes de galons cousus sur le haut de la manche et sur le parement.
L'uniforme des officiers était semblable à celui des cavaliers et, comme pour les autres armes, il ne différait que par la qualité du drap. Ils leur étaient interdits de se parer de plumets, dentelles, galons ou boutonnières de fils d'or ou d'argent. Ils avaient obligation de porter en toute occasion l'uniforme au régiment. Les marques distinctives de leur grade étaient assurées par les épaulettes comme définies dans l'ordonnance de 1762. À l'imitation des fantassins qui furent équipés du havresac, les cavaliers reçurent le porte-manteau pour y loger les ustensiles nécessaires à l'entretien du cheval et les effets personnels du cavalier qui faisaient l'objet d'une liste très précise.

Les hussards
Avec ce règlement, les hussards reçurent l'habit de drap vert façonné à la hongroise avec culotte de drap rouge-garance à la hongroise. Les parements et retroussis noirs, le cordonnet et le bordé pour agréments blancs. Le shako de feutre noir, bordé et doublé d'un galon de la même couleur. La sabretache rouge s'orna du chiffre du roi. Les fourriers et maréchaux des logis se distinguaient par la peau de renard accrochée à la bordure de leur pelisse. En sus du galon de manche, la distinction se faisait par des cordonnets cousus en forme de trèfle ou autre sur la culotte.
L'habit des officiers, identique à celui de la troupe, recevait des boutons argentés et des galons et cordonnets en argent. Les pelisses étaient garnies de fourrure de martre et de renard. Les galons de grade de nombre et largeur différente étaient disposés sur les manches de la pelisse et de la veste. Les culottes étaient plus ou moins ornées suivant le grade.
Les dragons
Les dragons conservèrent l'habit et collet de drap vert, avec une doublure de serge ou cadis vert, les parements et revers de drap suivant la couleur affectée au régiment, les poches ordinaires garnies de boutons, la veste de drap chamois doublée de cadis blanc et la culotte de peau. Les boutons blancs godronnés étaient frappés du numéro de régiment. Le casque en cuivre garni de son cimier et de sa crinière noire fut maintenu. Les cheveux étaient liés en queue.
Les marques distinctives des fourriers, maréchaux des logis, brigadiers et appointés étaient de même nature que celles utilisées dans la cavalerie. L'habit des officiers était identique à celui de la troupe excepté la qualité du drap. Les marques distinctives de leur grade se fit de la même manière que celles de la cavalerie avec l'abolition de l'aiguillette prescrite par l'ordonnance de 1763.
Suite à la création de deux cents brigades de maréchaussée supplémentaires en 1768, le roi, dans une ordonnance du 27 décembre 1769 (pdf), apporta un complément d'information sur les différentes dispositions de cette ordonnance. Outre les obligations de son service, ce fut l'occasion, comme il l'avait fait dans ses ordonnances consacrées à l'habillement et équipement de ses troupes, de préciser ceux de la maréchaussée.

L'habit fut maintenu en drap bleu, avec le collet de même couleur, les revers et parements de drap écarlate, doublure de serge ou cadis rouge. Chaque revers fut garni de six agréments en galon d'argent et chaque parement de trois. L'habit était garni de boutons argentés et d'une épaulette en galon d'argent pour le maintien de la bandoulière. La veste était en drap couleur de chamois, le surtout de drap bleu était bordé d'un galon d'argent au parement et au collet et orné d'une épaulette d'argent. Le manteau en drap bleu était parementé de serge ou de cadis rouge. La cocarde noire du chapeau fut remplacée par une cocarde de basin blanc.
Les officiers et cavaliers devaient se lier les cheveux en queue qu'ils maintenaient avec une rosette noire. Ils portaient la cravate noire, la culotte de peau de daim et les gants chamois.
Ils avaient la bandoulière de buffle jaune bordée de chaque côté d'un galon d'argent, les bottes molles de cuir de veau fort avec la genouillère.
L'habit du sous-brigadier, identique à celui du cavalier, comportait un galon d'argent sur chacun des parements, celui du brigadier avait deux galons. L'habit de l'Exempt en drap d'Elbeuf, avait les mêmes agréments que celui du brigadier et comportait un galon de plus.
Comme leurs homologues des autres armes, les officiers de la maréchaussée prirent l'épaulette. Les prévôts généraux, assimilés aux lieutenants-colonels de cavalerie, reçurent, comme eux, une épaulette ornée de franges à graines d'épinard sur l'épaule gauche. Les Lieutenants, assimilés aux capitaines de cavalerie, une épaulette à franges, sans graines d'épinard. Les exempts, une épaulette, fond argent, losangée de soie écarlate, comme les lieutenants. Les brigadiers et sous-brigadiers la portaient en soie écarlate avec lisérée d'argent.
Hélas, la rigueur et la loyauté de Choiseul lui valurent de nombreux ennemis. Les intrigues de palais le poussèrent à démissionner de sa charge de secrétaire d'État de la Guerre en décembre 1770. Il fut remplacé dès janvier 1771 par le marquis de Monteynard.
Au cours de son ministère, le marquis de Monteynard se soucia de conserver dans les rangs de l'armée les anciens soldats. Ils se recrutaient alors par la voie de l'engagement volontaire. Sous Louis XIV la durée de l'engagement fut fixée à trois ans puis à quatre (1). Elle fut portée à six sous Louis XV puis à huit ans (2). Les vieux soldats étaient précieux pour servir d'exemple et stimuler les plus jeunes. Dans les combats ils les menaient, les rassurer.

Cette maîtrise était le résultat d'années d'expérience et d'instruction militaire. Avec l'évolution des armes et des tactiques guerrières, il ne fallait pas moins de quatre ans pour former un cavalier ou un artilleur. Le financement de cette formation était trop important pour rendre le soldat à sa vie civile après son premier engagement. Tandis que les officiers étaient mutés d'un corps à un autre, ces vieux soldats devenaient l'épine dorsale du régiment.
Dans une ordonnance du 16 avril 1771 (pdf), le roi voulut les récompenser et faire connaître à tous leurs mérites. Il attribua aux soldats, cavaliers, hussards et dragons des hautes payes lorsqu'ils contractaient un deuxième ou troisième engagement. Pour les distinguer, il leur accorda le chevron d'ancienneté qui consistait, pour leur deuxième engagement, à disposer sur le bras gauche un galon de laine en chevron à la couleur du régiment, deux chevrons pour le troisième engagement.
Au-delà de 24 ans de service, le roi accordait la vétérance (3). Le récipiendaire recevait du ministre un brevet en parchemin signé de sa main accompagné de la plaque de vétérance, représentant deux épées en sautoir. Le commandant de la troupe attachait cet insigne à la troisième boutonnière sur le côté gauche de la poitrine.
Cette disposition fut également accordée, par ordonnance du 14 avril 1771, aux gardes françaises. Indépendamment du grade auquel les soldats étaient parvenus, elle accordait la haute paie plus ou moins importante aux caporaux, appointés, grenadiers, fusiliers et tambours suivant leurs nombres d'années de service. Le roi leur accordait les chevrons d'ancienneté et les épées en sautoir en laine rouge pour ceux qui comptaient 24 ans de service. Ils pouvaient se retirer soit chez eux, soit aux invalides et emporter avec eux le sabre ou l'épée qu'ils portaient au régiment. Cette mesure fut étendue aux compagnies de grenadiers à cheval par ordonnance du 4 août 1771.
Pour lutter contre l'usage des duels qui faisait de très nombreuses victimes chaque année dans le royaume parmi la noblesse, Louis XIV ordonna aux maréchaux de France et gouverneurs des provinces de commettre en chacun des bailliages et sénéchaussées, un ou plusieurs gentilshommes de qualité et de capacité pour recevoir les arguments de chaque partie dans les conflits du point d'honneur (4). Établies par simple commission, ces charges furent ensuite créées en titre d'office par édit du mois de mars 1693 sous l'appellation de lieutenant de messieurs les maréchaux de France. Ils étaient assistés d'un archer de la Connétablie et Maréchaussée de France créé en titre d'office.

Afin de donner à leur autorité plus de solennité, ils réclamèrent un uniforme. Cette demande fut satisfaite avec l'ordonnance du 15 juin 1771 qui régla les détails de celui que le roi leur attribua. Ses officiers eurent alors une grande et une petite tenue.
La grande tenue était composée d'un habit de drap bleu-de-roi avec le collet, les parements, la veste et la culotte écarlates. Sur le collet, les poches et les parements courait une riche broderie d'or composée d'un bordé et d'une double baguette sur lesquels était appliquée une guirlande de feuilles de chêne en broderie d'or qui serpentait sur la baguette et la dépassait des deux côtés en s'étendant d'un côté jusqu'au bordé et de l'autre sur le drap de l'habit. Le même ornement entourait le collet et il était répété deux fois sur les poches en travers et à écusson et une fois en dessus. Il était également répété deux fois sur les parements ainsi que sur la veste qui avait aussi des poches en travers à écusson. Le devant de l'habit était garni de neuf boutons, il y en avait trois sur le parement et de trois au-dessous de la poche. Ces boutons étaient dorés, entourés d'un bordé d'or et portaient en broderie d'or et d'argent deux épées de connétable croisées en sautoir avec au milieu un bâton de maréchal de France.
Ce riche uniforme, à la fois élégant et militaire était porté qu'en de grandes occasions. Pour le service courant, les lieutenants des maréchaux revêtaient la petite tenue qui ne différait que par la qualité de l'étoffe et par la largeur des broderies. Il était en toile bleu de roi au lieu d'être en drap avec le collet et les parements en étoffe écarlate et l'ensemble de la broderie avait été réduite en largeur dans toutes ses parties.
Pour donner plus de solennité à leur uniforme, quelques lieutenants crurent bon de rajouter une épaulette à leur uniforme. Cette distinction portée arbitrairement fut l'objet de nombreuses critiques de la part des militaires. Pour éviter toutes espèces de plaintes ou de remontrances à ce sujet, le tribunal décida dans un règlement du 18 mars 1782 que les lieutenants des maréchaux ne pourraient porter sur leur uniforme que l'épaulette du grade qu'ils avaient dans les troupes du roi.
(1) Ordonnance du 28 octobre 1666.
(2) Ordonnance du 12 janvier 1763 (article XXI) et du 1er janvier 1768.
(3) Vétéran (veteranus, vieux soldat) du latin vetus (vieux).
(4) La juridiction du point d'honneur
Lorsque Louis XVI devint roi de France en 1774, les forces militaires du pays comptaient 130 400 hommes répartis en 100 000 fantassins, 23 900 cavaliers et 7 400 artilleurs et mineurs. L'infanterie comptait 65 régiments français et 26 régiments étrangers. Ces corps étaient régis par l'ordonnance de 1762. La cavalerie était composée de 30 régiments, les dragons de dix-sept, les hussards de quatre.

L'uniforme dans les armées avait bien évolué sous les règnes précédents et c'est le justaucorps qui, au cours de ces années, avait subi les plus grandes transformations. Initialement porté comme un manteau, les pans avant de sa jupe furent d'abord relevés jusqu'au niveau du ceinturon, puis les pans arrière furent retroussés à leur tour. Les régiments se distinguaient alors par les couleurs de la doublure, du col et des parements. Plus tard, on l'échancra sur le devant afin de mettre à découvert la veste sur laquelle fut désormais porté le ceinturon. On lui ajouta alors des revers de couleur sur la poitrine, sur le col, des pattes boutonnées sur les épaules, de fausses poches de hanche. On le garnit de boutons métalliques en cuivre ou en étain qui furent par la suite argenté ou doré et qui participèrent à la distinction des régiments. Après 1760 les fantassins reçurent les guêtres longues pour protéger leurs jambes. Une paire blanche pour l'été et une paire noire pour l'hiver. Enfin, à compter de 1762, l'épaulette d'or ou d'argent fut imposée comme insigne de grade.
La veste, jusqu'alors cachée par le justaucorps, participa également à distinguer les régiments par sa couleur. Le tricorne, qui était la seule coiffure dans les armées, reçut une forme plus resserrée. D'autres coiffures firent leur apparition, le casque qui équipa dans un premier temps quelques régiments d'infanterie, mais principalement les dragons, le bonnet à poil pour les grenadiers, le shako pour les hussards.
L'habit fut alors beaucoup plus ajusté au corps, et l'on décida d'une couleur de fond unique pour chaque arme. On affecta le blanc à l'infanterie, le bleu à la cavalerie, le vert aux dragons et aux hussards. La distinction des régiments se fit alors sur les couleurs des parements, revers et collet qui avaient été réglés pour chaque corps.
Dans la cavalerie, l'habit éprouva le même changement de coupe que dans l'infanterie. La position du ceinturon sur la veste ne tarda pas à amener l'abandon de l'épée pour le sabre. Suspendu au bout de deux lanières de buffle, il s'attachait plus commodément que l'épée après le ceinturon passé sous l'habit. À la veste de peau fut substitué un gilet du nom de buffle sous lequel se glissait un plastron de plusieurs épaisseurs de toile. La culotte de peau et celle de tricot blanc, le manteau, les bottes longues et la discrète complétèrent l'habillement du cavalier.
Après avoir rétabli en régie l'administration de la masse destinée à l'habillement et l'équipement des troupes, le maréchal Du Muy, ancien menin de Louis XVI et nouveau secrétaire d'État à la Guerre, publia, le 2 septembre 1775, un règlement (pdf - extrait) concernant l'habillement et l'équipement de l'infanterie et des troupes légères.

Ce règlement, qui apportait au précédent plus de précisions sur certains détails de l'habillement et en modifiait quelques autres, mettait davantage l'accent sur l'hygiène et la propreté du soldat. Du Muy n'entendait pas que l'uniforme fût porté avec négligence, comme un simple vêtement sans signification. Il voulait donner à ses soldats une allure générale qui force l'admiration et le respect. Si l'homme était habillé, il devait porter l'uniforme avec fierté, encore fallait-il que ce vêtement soit bien ajusté, bien porté, propre et sans accrocs et que celui qui en était vêtu soit propre et présentable.
C'est ainsi, qu'il fût défendu aux soldats de cirer ou de graisser ses moustaches (1). Cette pratique, décrite comme malpropre, occasionnait des lésions cutanées. On apporta une attention particulière aux cheveux. Ils ne devaient plus être liés en catogan ou en tresse, car reconnu nuisible à la propreté et à l'image du fantassin (2), mais liés en queue par un ruban qui devait être régulièrement lavé afin qu'il n'encrassa pas les habits. La queue ne pouvait dépasser douze à quatorze pouces de long. Les cheveux devaient être coupés court dessus la tête, ceux des tempes roulés en boucle. Ils pouvaient être poudrés les jours de service et de parade seulement. Le soldat devait avoir le visage bien net et porter une tenue parfaitement ajustée suivant les prescriptions imposées dans ce règlement. Ainsi, le col droit et blanc devait couvrir celui de la chemise, la veste devait être entièrement boutonnée et ajustée aux hanches. Le chapeau de feutre noir, orné de sa cocarde de basin blanc, devait être enfoncé sur le sourcil droit, la corne du devant placée au-dessus du sourcil gauche. La culotte devait couvrir le genou, les guêtres envelopper le cou-de-pied et la cheville. Les souliers avec talon et boucle étaient les seuls autorisés sous les armes.
L'image du militaire discipliné et présentable devait également s'imposer au sein des populations. À présent, les soldats ne pouvaient plus sortir du quartier sans s'être présentéd au sous-officier du jour qui jugeait de sa présentation. Ceux qui étaient trouvés dans les rues malpropres ou avec une tenue mal ajustée étaient ramenés au quartier et sanctionnés.
Pour l'entretien et la conservation de l'habillement et de l'équipement, ce règlement rappelait les instructions données dans les précédentes ordonnances. Il renouvelait l'interdiction d'utilisercertains procédés de nettoyage reconnus caustiques et corrosifs et par conséquent préjudiciables à la durée des vêtements. Pour économiser le chapeau, le casque, le bonnet à poil et le schako, le bonnet de police fut maintenu au sein des effets réglementaires pour le service intérieur et dans les camps.
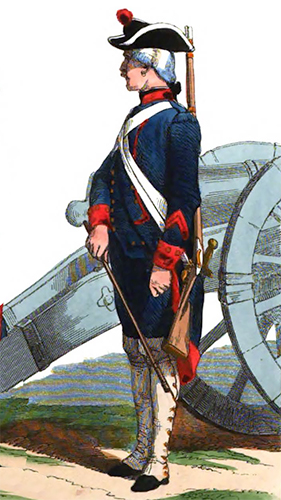
Toutes ces instructions firent apparaître un petit équipement réglementaire pour permettre au soldat d'être toujours présentable. À cet effet, chaque soldat perçut, entre autres choses, un ruban de queue, un sac à poudre et sa houppe, un peigne à retaper, un peigne à décrasser, des plombs pour les boucles des cheveux, une brosse pour l'habit et chapeau, deux brosses pour les souliers, une petite brosse pour nettoyer le cuivre, un pinceau pour blanchir la bufflèterie, un dé à coudre, du fil, des aiguilles, un tire-bouton, un tire-bourre, une épinglette, un tourne-vis, des morceaux de vieux drap pour frotter les taches de son habit et du vieux linge pour nettoyer son arme.
La paye du soldat étant absolument nécessaire à sa subsistance, le maréchal Du Muy créa une masse particulière qu'il appela masse de propreté. Celle-ci était destinée à financer les frais de la propreté et de la tenue du soldat. On vit apparaître à cette occasion des petits magasins d'approvisionnement, préfigurant ce qui deviendra plus tard les économats militaires. Cette fonction fut dévolue aux fourriers qui, au moyen de la masse de propreté, devaient continuellement s'approvisionner en savon, cire pour les gibernes, de noir composé pour les guêtres, de la terre à détacher, du blanc de céruse, de la terre de pipe pour les parties de buffle, de l'huile et de la poudre pour les cheveux.
Avec ce règlement, toute l'infanterie fut en drap blanc, avec culotte et doublure blanches et le collet droit. Les poches de l'habit étaient liserées de la couleur du parement. Quelques régiments eurent aussi le parement liseré. Le dessous du parement et l'avant-bras étaient fermés par des petits boutons. Les revers et les poches étaient ornés de gros boutons. Tous étaient empreints du numéro du régiment. Les casques furent retirés aux fantassins et remplacés par des chapeaux. Ils étaient bordés d'un galon d'argent pour les sous-officiers et de fil blanc pour la troupe.
Les grenadiers conservaient le chapeau et le bonnet de peau d'ours orné de sa plaque de cuivre jaune timbrée de l'écusson aux armes du roi. Les hussards gardaient le schako et les dragons le casque. Le royal artillerie conservait l'habit, l'épaulette et la veste bleu de roi avec le parement, collet et doublure rouge.
(1) moustache du grec mustax, poil de la lèvre.
(1) Suivant les époques, la mode imposa les cheveux longs ou courts. Au temps des Gaules, les Celtes les portaient long. Cette particularité lui vaudra le nom de Gaule chevelue. Cette coutume fut reprise par les premiers rois de France et les princes de leur sang qui avaient droit de chevelure, c'est-à-dire de porter les cheveux longs. Ils ont joui de ce droit jusque vers le milieu du XIIe siècle. Avec l'évolution de la société, cet usage disparut et la mode fut aux cheveux courts. Ainsi depuis des siècles, les Français portaient les cheveux courts. La mode des cheveux mi-longs reparue avec François I
Dans un second règlement du 2 septembre 1775 (pdf - extrait), le maréchal Du Muy régla l'uniforme des généraux, des commissaires ordonnateurs et des commissaires des guerres. Les lieutenants généraux et maréchaux des camps et armées reçurent l'habit uniforme de drap bleu y compris les parements fermés en bottes et le collet.

Il était garni de boutons de métal jaune gravés d'un motif en rosace. Il y en avait 12 sur l'habit, autant sur la veste, 3 sur chaque parement et chaque poche. Ils conservaient la veste écarlate doublée de serge blanche et la culotte de même couleur. L'habit, dont le collet était brodé, était parcouru sur son pourtour d'une broderie de filés d'or passé. Les lieutenants généraux avaient une double broderie au parement et quatre rangs aux poches. La veste était également bordée de la même broderie que l'habit et garnie de douze boutons sur le devant et trois sur chaque poche.
Ces officiers reçurent un grand et un petit uniforme. Les deux étaient identiques, à l'exception de la broderie dont le dessin était réduit de moitié sur le petit uniforme. L'uniforme des maréchaux de camp était semblable à celui des lieutenants généraux, mais ne comportait pas la double broderie sur les parements et les poches.
Les officiers généraux avaient un chapeau bordé d'un galon d'or. Ceux qui commandaient un régiment ou un corps particulier avaient le plumet blanc. Les lieutenants généraux et les maréchaux de camp portaient une redingote de couleur bleu-de-roi, accompagnée d'une rotonde brodée du galon de leur rang sur le devant, le collet et les poches. Leur manteau était également de couleur bleu-de-roi.
La nouvelle organisation des troupes
Le maréchal Du Muy mourut le mois suivant la publication de cette ordonnance. Il fut remplacé par le comte de Saint-Germain qui fut nommé secrétaire d'État à la Guerre en octobre 1775. Saint-Germain, par une série d'ordonnances publiées le 25 mars 1776, poursuivit le travail d'uniformisation des régiments engagé par son prédécesseur. En effet, Du Muy, dans une ordonnance du 26 avril 1775, avait commençait à mettre la plupart des régiments d'infanterie, dont le nombre de bataillons variait de un à quatre, à deux bataillons. Saint-Germain appliqua aux régiments restants la même composition excepté celui du roi qui, par faveur spéciale, demeura à quatre bataillons. Chaque bataillon était composé de quatre compagnies de fusiliers. On créa dans chaque régiment une compagnie de grenadier, une de chasseur et une d'auxiliaires (de réserve). Désormais de même force et de même composition, les régiments présentaient l'avantage d'être engagés indifféremment sans tenir compte de leurs spécificités.

L'infanterie
La nouvelle composition des régiments d'infanterie entraîna une réorganisation hiérarchique. Pour chaque régiment, il fut créé un colonel en second, un armurier, un quartier-maître-trésorier et un adjudant sous-officier. Le quartier-maître-trésorier, avec rang de lieutenant, était chargé de tenir le registre des recettes et des dépenses du régiment. L'adjudant, avec rang de premier sergent-major, avait autorité sur tous les sergents-majors des compagnies. Il remplissait toutes les fonctions que les aides-majors et sous-aides-majors remplissaient.
Il fut créé dans chaque compagnie un sergent-major et un fourrier-écrivain. Le sergent-major était chargé de tous les détails du service et de la discipline. Ils avaient autorité sur les cinq sergents et les dix caporaux de la compagnie. La fonction du fourrier-écrivain était d'être l'économe et l'écrivain de la compagnie. Plusieurs fois supprimé puis rétabli, leur rang a varié. Ils ont été établis sous les sergents et peu de temps après la dénomination de sergent fourrier fut donnée au premier sous-officier de chaque compagnie. En 1776, ils prirent rang entre le sergent-major et les autres sergents.
Les chefs de bataillon, les aides-majors, sous-aides-majors, le quartier-maître, les fourriers et les appointés furent supprimés. Les hautes-payes versées aux vétérants et à l'ancienneté étaient supprimées et remplacées par des primes de réengagement.
La cavalerie
La cavalerie fut réduite à vingt-quatre régiments. Les sept autres excédant ce nombre furent réunis aux dix-sept régiments de dragons pour porter cette arme à vingt-quatre régiments. Les hussards formèrent quatre régiments.
Chaque régiment de cavalerie fut composé de cinq escadrons, dont quatre de cavalerie et un de chevaux légers. Chaque escadron était composé d'une compagnie. Un escadron d'auxiliaires était rattaché au régiment en temps de guerre. Il fut créé dans chaque régiment de cavalerie un mestre de camp en second, un quartier-maître-trésorier, un adjudant, un maître-maréchal, un maître-sellier, un armurier et dans chaque compagnie ou escadron un maréchal des logis en chef, un second maréchal des logis et un maréchal-ferrant. Le maître-sellier et le maître-armurier avaient le rang de seconds maréchaux des logis. L'armurier et les maréchaux-ferrants de chaque escadron avaient le rang de cavalier.
Les aides-majors, sous-aides-majors, le quartier-maître, un porte-étendard sur trois, le timbalier et les timbales, les fourriers et les carabiniers furent supprimés. Les places de capitaines-lieutenants (1) des compagnies des régiments colonel-général, de mestre de camp-général, de commissaire général, les sous-lieutenants et cornettes furent également supprimés.
Les hussards, dans une ordonnance qui leur était consacrée, recevaient une organisation identique à celle de la cavalerie avec les mêmes créations et suppressions d'emplois.
Les régiments de dragons furent composés comme la cavalerie de cinq escadrons, dont quatre de dragons et un de chasseur à cheval. L'escadron d'auxiliaires n'était formé qu'en temps de guerre. Les emplois d'officiers et de sous-officiers furent soumis aux mêmes créations et suppressions.
Après avoir donné une composition identique à tous les régiments de cavalerie et à tous les régiments d'infanterie, Saint-Germain les regroupa en division. Dans un règlement du 25 mars 1776 (pdf), la France fut partagée en 16 divisions militaires, chacune correspondant à l'aire géographique d'une, deux ou trois provinces. Chaque division comprenait un nombre variable de bataillons d'infanterie, d'artillerie et d'escadron de cavalerie, de dragons, de hussards et de cuirassiers.

Saint-Germain supprima, dans une ordonnance (pdf) du même jour, les charges d'inspecteurs généraux d'infanterie, de cavalerie, de troupes-légères et celle d'inspecteur des hussards. Afin de permettre aux généraux de conserver et d'améliorer leur aptitude à commander, il plaça à la tête de chacune de ces divisions un lieutenant-général secondé par trois maréchaux de camp. Ces officiers furent chargés de veiller à l'exécution des ordonnances, d'assurer dans toute l'étendue de leur commandement l'unité du service, le maintien du bon ordre, de la subordination et de la discipline. Ils demeuraient subordonnés aux gouverneurs, mais ils rendaient compte directement au secrétaire d'État de la guerre de tout ce qui intéressait les troupes qui leur étaient confiées.
À la suite de ces restructurations, parut l'ordonnance du 25 mars 1776 (pdf - extrait) portant sur l'administration de tous les corps tant d'infanterie, que de cavalerie, dragons et hussards. Elle traitait de l'habillement, des remontes, de la discipline, de la subordination, de la police intérieure, des punitions, des récompenses, de la nomination aux emplois vacants, de la formation des troupes en divisions, des congés, des revues des commissaires des guerres et celles des officiers généraux.
Le ministre ordonna la suppression de la régie qu'il remplaça par un conseil d'administration qui fut créé dans chaque régiment de cavalerie, d'infanterie, de dragons et de hussards. Cette ordonnance précisa quelques points de détails pour l'habillement. Ainsi, pour réfréner le zèle des officiers, elle établissait une liste des sous-vêtements que le soldat devait avoir en sa possession, les objets nécessaires à sa propreté.
Avec cette ordonnance, les soldats et chasseurs à pied percevaient trois paires de guêtres, une noire pour l'hiver et deux blanches pour l'été et les parades. Elle en supprimait l'usage pour les cavaliers, chasseurs à cheval, dragons et hussards qui chaussaient les bottes avec les éperons et dont on exigeait désormais qu'ils eussent les cheveux peignés et mis dans une bourse en crapaud (2) et frisés sur les côtés d'une boucle uniforme.
Elle confirmait la suppression des hautes-payes accordées aux rengagés (3) et les remplaçait par des primes. Les chevrons d'ancienneté étaient maintenus.
(1) Voir note n°8 section "État militaire de la France".
(2) Le crapaud était un petit sac d'étoffe de laine noire.
(3) Ordonnance du 16 avril 1771
Après avoir réglé tous les sujets liés à l'administration des corps, Saint-Germain, dans un règlement du 31 mai 1776 (pdf - extrait), prescrit avec plus de détails les nouvelles modifications concernant l'habillement, l'équipement, le harnachement et l'armement pour l'infanterie, la cavalerie, les dragons, les hussards et les généraux. Ce règlement qui précisait les quantités de chaque espèce de fournitures nécessaire à la confection de chacune des parties de l'habillement, comprenait également des instructions précises pour les différents chefs tailleurs. Pour s'assurer de l'uniformité de l'habillement chaque régiment reçu un modèle confectionné.
L'infanterie

L'infanterie conservait l'habit blanc. Dans ses nouveaux effets, elle recevait une ceinture de laine croisée blanche dont la longueur était ajustable à l'aide de boutons, une redingote façonnée en drap réglé de la couleur distinctive de l'uniforme. Cette redingote ou capote était parementée sur le devant d'une bande couleur blanche. Le devant était garni, côté gauche, d'une rangée de six boutonnières et, côté droit, de deux rangées parallèles de six boutons, permettant au soldat de la porter plus ou moins flottante. Elle avait une poche côté droit, côté gauche, la poche était figurée. Elle était garnie, de chaque côté d'une épaulette identique à celles de l'habit-veste. La culotte, en tricot blanc ou bleu pour le corps royal, était à pont-levis. Elle était maintenue au niveau de la ceinture par une rangée de petits boutons qui venaient s'attacher dans des boutonnières façonnées dans le gilet. L'habit-veste conservait les revers et parements de la couleur tranchante réglée pour chaque régiment. Désormais les parements n'étaient plus formés par le retroussis de la manche, mais par l'ajout d'une bande de drap de la couleur distinctive. Les basques furent ornées d'une fleur-de-lys ou d'une grenade pour les grenadiers. Chaque épaule était garnie d'une épaulette doublée ou liserée de la couleur distinctive de l'uniforme.
Les casques qui équipaient certains régiments furent supprimés. Les sous-officiers et soldats reçurent le chapeau de feutre d'un nouveau modèle. Il était à quatre cornes. Celles de devant et de derrière avaient été fortement relevées, celles côté gauche et côté droit restaient horizontales pour l'écoulement de l'eau. Il était bordé d'un galon de laine noire et garni d'un panache blanc. Les grenadiers, auxquels on retirait le casque et le bonnet à poil (1), avaient au chapeau un panache mêlé de plumes rouges et blanches, celui des chasseurs était de plumes blanches et vertes. Les cheveux étaient tenus dans un crapaud.
Les créations et suppressions d'emplois entraînèrent de nouvelles marques distinctives de grade. Le sergent-major portait un double bordé de galon d'argent fin, l'un cousu sur le parement de l'habit-veste et de la redingote, l'autre sur l'avant-bras au-dessus du parement. Les sergents portaient un simple bordé sur l'avant-bras, les fourriers-écrivains portaient deux bandes de galons d'argent, cousues en travers, sur le haut du bras. Les caporaux avaient deux galons de laine placés au-dessus et parallèlement au parement. Ils étaient bleus pour ceux qui avaient l'habit blanc et blanc pour ceux qui avaient l'habit bleu ou rouge.
L'habit des officiers ne différait de celui du soldat que par la qualité des draps. Les marques distinctives des grades des officiers par le jeu des épaulettes étaient maintenues selon l'ordonnance de 1762. Les nouveaux emplois de colonel en second, capitaine en second, lieutenant en second se distinguaient des officiers en premiers par leurs épaulettes traversées de deux cordons de soie couleur de feu. Les officiers du grade de brigadier des armées portaient sur l'épaulette, une étoile d'or ou d'argent en opposition à la couleur de l'épaulette. Le quartier-maître trésorier portait la même épaulette que le lieutenant en second. L'adjudant portait l'épaulette à fond de soie couleur de feu traversée dans son milieu par deux cordons de tresse d'or ou d'argent suivant la couleur du bouton.
Cavalerie et dragon
L'habit-veste fut maintenu en drap bleu de roi pour tous les régiments de cavalerie et en drap vert foncé pour les dragons. Ils recevaient, comme l'infanterie la ceinture en tricot blanc, un gilet de drap blanc avec une série de boutonnières dans sa partie inférieure afin de maintenir, grâce à des petits boutons, le pont-levis de la culotte. Les revers et parements de l'habit-veste conservaient les couleurs tranchantes décidées pour chaque régiment.

L'habit-veste se fermait à l'aide d'un bouton situé près du col et par une série de crochets et d'œillets répartis sur la longueur des revers. Ces agrafes se substituaient aux boutons qui étaient supprimés afin de ne pas gêner la mise en place du plastron-cuirasse dont tous les cavaliers étaient désormais équipés. Les dragons conservaient le système de fermeture par boutons. Les manches étroites étaient ouvertes à leur extrémité et se fermaient à l'aide de quatre petits boutons, deux sur la manche et deux sur le parement.
L'habit-veste était orné dans la partie inférieure de ses basques d'une fleur-de-lys et possédait sur chaque épaule une épaulette doublée et liserée du drap de la couleur distinctive du revers. Le manteau de drap gris-blanc piqué de bleu était maintenu dans sa forme.
Pour les travaux d'écurie, chaque cavalier et dragon était pourvu d'une culotte à la marinière et d'un palteau de treillis. Les chapeaux et les casques de dragons furent supprimés pour être remplacés par le chapeau de feutre à 4 cornes identique à celui de l'infanterie. Les cheveux des cavaliers et dragons devaient être serrés dans un sac de veau noirci appelé crapaud.
Les marques distinctives des maréchaux des logis en chef, des maréchaux des logis en second, des fourriers écrivains et des brigadiers étaient similaires à celles de l'infanterie. Le maréchal-ferrant se distinguait par un fer à cheval en galon de fil ou de laine blanc ou jaune en fonction de la couleur du bouton cousu sur le haut de chaque bras.
L'habit des officiers ne différait de celui du soldat que par la qualité des draps. Ils avaient un panache de plumes blanches à leur chapeau. Les marques distinctives des grades des officiers par le jeu des épaulettes étaient maintenues selon l'ordonnance de 1762. Comme pour l'infanterie, les mestres de camp, capitaines et lieutenants en second portaient l'épaulette traversée dans le milieu par deux cordons de soie couleur de feu. Les officiers du grade de brigadier des armées se distinguaient par l'étoile d'or ou d'argent qu'ils portaient sur l'épaulette.
Les hussards
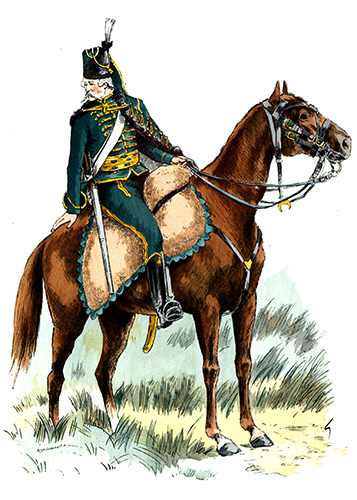
Le drap vert, qui avait été donné aux régiments de hussards par l'ordonnance du 21 décembre 1762, ne fut conservé que pour le régiment de Conflans. Celui de Bercheny reprenait le bleu céleste, celui de Chamborant optait pour le brun-marron et celui d'Estherazy pour le gris-de-fer. L'habit, coupé à la hongroise, était composé d'une pelisse de drap, doublée d'une peau de mouton blanc, bordée de mouton noir, d'un dolman et d'une culotte de drap de la même couleur que la pelisse.
Les galons et agréments de toute espèce, étaient supprimés, seules les ganses nécessaires pour les boutonnières étaient conservées. Ils avaient l'écharpe de laine jaune, la sabretache de cuir noir orné du chiffre du Roi, en cuivre jaune. Ils conservaient le manteau de drap vert.
Pour le soin des chevaux, les hussards reçurent un palteau en gilet long et d'une longue culotte de treillis écru. Les surtouts et les gilets de tricot, dont ils se vêtaient pour accomplir cette tâche furent supprimés. Les bottes étaient à la Hongroise en cuir noir.
Ils avaient les cheveux retroussés en queue raccourcie à la longueur de deux ou trois pouces; les bonnets et schakos de feutre noir avec une cocarde ou aigrettes blanches. Les cheveux sur les tempes étaient noués à la Hongroise, c'est-à-dire mis en tresse et lovés. Les shakos de feutre noir étaient bordés d'un galon de laine noire et ornés d'une aigrette blanche.
Les marques distinctives du premier maréchal des logis consistaient en un double chevron en galon d'argent cousu sur l'avant-bras, le second maréchal-des-logis n'en portait qu'un. Le fourrier-écrivain portait un galon d'argent cousu en biais sur la manche près de l'épaule. Les brigadiers portaient au-dessus du parement une double bande de fil blanc. L'habillement des officiers ne différait que par la qualité du drap. Leur sabretache en maroquin noirci était ornée du chiffre du roi en métal doré.
La distinction des grades, constitué jusqu'alors par la combinaison d'agréments en galons appliqués sur les manches de la pelisse, de la veste, des poches et la culotte et de l'ornement de la sabretache constitué d'un galon d'argent et d'une frange avec graines d'épinard et nœuds de cordelières fut supprimé. Les différents grades des officiers étant similaires à ceux de la cavalerie, les officiers prirent l'épaulette suivant les mêmes dispositions que la cavalerie.
(1) Le bonnet à poil leur sera rendu en 1778
Dans la grande ordonnance du 28 avril 1778 (pdf - extrait), qui détaillait toutes les parties de son service, le roi entendait donner à l'arme une hiérarchie équivalente à celle des militaires pour permettre l'avancement dans ce corps. Jusqu'alors, les emplois de prévôt, lieutenant et exempt de la maréchaussée étaient des offices du royaume. À ce titre, chacun de ces officiers exerçait la charge pour laquelle il avait payé une finance.

L'arme fut partagée en six divisions (pdf - extrait) à la tête desquelles fut placé un inspecteur général. Les grades d'exempts et de sous-brigadiers furent supprimés et on créa à leur place les grades de sous-lieutenant et de maréchal des logis. Le titre d'archer fut remplacé par celui de cavalier.
L'uniforme fut composé (pdf - extrait) d'un habit à la française bleu-de-roi avec parements, revers et collet de drap écarlate, d'une veste couleur chamois doublée de serge blanche et d'une culotte de peau, couleur naturelle. Son renouvellement fut fixé tous les deux ans. L'habit était garni de treize gros boutons et de seize petits en métal blanc, portant un écusson à trois fleurs-de-lys, environnées de branches de laurier et d'olivier. L'épaule droite fut ornée d'une épaulette de drap bleu liserée d'écarlate, l'épaule gauche reçut l'aiguillette de soie blanche qui avait été abandonnée en 1756. Les maréchaux des logis, brigadiers et cavaliers reçurent en complément un manteau de drap gris-blanc, piqué de bleu, à collet montant avec une rotonde en drap bleu, bordée d'un galon d'argent pour les chefs de brigade. Ils chaussaient les bottes des dragons.
Les sous-officiers et cavaliers reçurent le chapeau aux ailes fortement relevées bordé d'un galon d'argent. L'aile gauche était ornée d'un gros bouton d'uniforme auquel s'attachait une ganse en fil d'argent et de la cocarde de basin blanc. Les cheveux étaient liés en queue et ceux des tempes ne devaient présenter qu'une seule boucle.
Les maréchaux des logis étaient distingués par deux galons d'argent cousus sur le parement, les brigadiers n'en portaient qu'un.
Les inspecteurs généraux, assimilés aux mestres de camp, portaient de chaque côté, une épaulette de tresse en argent ornée de franges à graine d'épinard, nœuds de cordelière et cordes à puits. Les Prévôts généraux, assimilés aux lieutenants-colonels de cavalerie, portaient à droite une seule épaulette. Les lieutenants portaient une épaulette en argent, ornée de franges comme celle des capitaines de cavalerie. Les sous-lieutenants portaient l'épaulette losangée de carreaux de soie écarlate, comme celle des lieutenants de cavalerie. Les prévôts généraux, lieutenants et sous-lieutenants, portaient sur l'épaule gauche l'aiguillette en fil d'argent, ou en argent et soie, comme les épaulettes attribuées à leur grade.
La gestion de l'habillement voulu par le comte de Saint-Germain s'étant révélée catastrophique pour le trésor, le roi, dans une ordonnance du 21 février 1779 (extrait), arrêta un nouveau règlement pour y mettre fin. La gestion en régie fut rétablie et l'on s'appliqua d'obtenir un habillement moins coûteux en réduisant au mieux les tissus de différentes qualités et couleur entrant dans leur confection, en ramenant l'uniforme de chaque arme à un modèle standard unique et en créant des effets utilisables dans toutes les armes. L'habit à la française remplaça l'habit-veste (1).
Les ordonnances précédentes distinguaient les régiments entre eux par la combinaison de différentes couleurs appliquées aux collets, aux parements, aux revers, à la couleur du liseré de la patte de poche, à son inclinaison, aux nombres de boutons, à leur couleur. Cette profusion de couleurs et de combinaisons, que le ministre Montbarrey qualifiait de « vaines parures »fut ramenée à des proportions beaucoup plus modestes. Pour atteindre ce but, les régiments furent regroupés en série et on affecta à chacune d'entre-elle une couleur. Cette simplification permit, non seulement de réduire grandement les quantités d'étoffes de couleurs entant dans la confection des uniformes, mais permit également aux généraux d'armée de reconnaître plus facilement les différents régiments qu'ils avaient sous leur commandement.
Infanterie
Ainsi, l'infanterie, toute de blanc vêtue, fut rangée, par ordre d'ancienneté, en dix séries de six régiments, sauf les régiments royaux et ceux des princes.
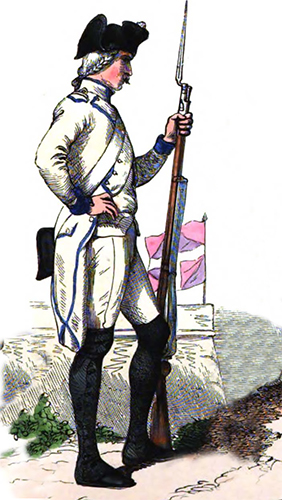
Chaque série fut subdivisée en deux divisions de trois régiments chacune. On affecta à chaque série une des couleurs distinctives suivantes : bleu céleste, panne noire, violet, gris de fer, rose, jonquille, cramoisi, gris argentin, aurore et vert foncé. Pour caractériser les divisions, on donna à la première de chaque série les boutons jaunes et les poches en travers et à la seconde les boutons blancs avec les poches en long. Pour différencier les régiments dans une même division, on agrémenta de la couleur distinctive le parement et le revers du premier régiment, uniquement le revers du deuxième et uniquement le parement du troisième.
Les revers ou parements des deuxième et troisième régiments, qui n'étaient pas agrémentés de la couleur distinctive, étaient détachés, comme les pattes des poches, par un passe-poil de la couleur tranchante. Les revers étaient ornés de petits boutons d'uniforme placés sur toute leur longueur. Les sous-officiers et soldats portaient une épaulette et une contre-épaulette liserées de la couleur distinctive ornée d'un petit bouton. Celles des grenadiers étaient en drap rouge et blanc, celles des chasseurs en drap vert et blanc. Les collets de couleur furent supprimés, seul fut maintenu le collet droit de basin blanc. Les retroussis des fusiliers étaient garnis d'une fleur-de-lys, ceux des grenadiers d'une grenade et ceux des chasseurs d'un cor-de-chasse. Les boutons étaient en cuivre ou en étain.
La durée des habits, vestes et gilets, fut à nouveau fixée à trois ans.
Les bonnets à poil des grenadiers furent supprimés. Comme les chasseurs et fusiliers, ils coiffèrent le chapeau coupé rond bordé d'un galon de laine noire. L'aile côté gauche était maintenue relevée par une ganse noire attachée à un petit bouton uniforme. Il était orné d'une cocarde de basin blanc. Les grenadiers et leurs sous-officiers portaient au-dessus de la cocarde une houppe ronde de laine rouge. Les chasseurs et fusiliers n'en portaient pas. Les cheveux furent liés en catogan couvert d'une corne noircie.
Les marques distinctives des grades de sous-officiers étaient maintenues telles qu'ils avaient été définis par le règlement du 31 mai 1776. Ils furent toutefois garnis d'un passepoil de la couleur du régiment pour les rendre plus apparents. Les chevrons des soldats rengagés étaient maintenus.
L'habit des officiers était identique à celui de la troupe. Il ne différait que par la qualité des matières. Les marques distinctives des grades, définis par le règlement du 31 mai 1776, furent conservées.
Cavalerie
Les régiments de cavalerie furent à leur tour divisés, suivant leur ancienneté, en huit classes de trois régiments chacune. On affecta à chaque classe une des couleurs suivantes : écarlate, jonquille, cramoisie, aurore, rose, gris-argentin et bleu-céleste. La couleur de distinction fut appliquée sur les parements et revers suivant le même principe que pour l'infanterie. Tous les régiments reçurent le bouton blanc sauf les régiments de la première classe dans laquelle se trouvait le régiment du colonel-général, qui eurent les boutons jaunes.

Les cavaliers conservaient l'habit en drap bleu-de-roi, la veste en drap chamois, la culotte de peau de couleur naturelle, le manteau de drap gris-blanc piqué de bleu et percevaient un surtout de tricot sous lequel ils portaient le gilet. Les cavaliers coiffèrent le même chapeau à trois cornes que celui de l'infanterie, mais légèrement plus haut pour y glisser la discrète. Leurs cheveux étaient liés en queue couverte de ruban noir. Ils chaussaient des bottes demie-forte en cuir de vache souple et percevaient une paire de guêtres noires, identiques à celle de l'infanterie, pour effectuer le service à pied.
L'habillement des officiers ne différait que par la qualité du drap. Les marques distinctives de grades des officiers et sous-officiers étaient inchangées. L'habillement des sous-officiers et cavaliers était composé d'un habit à la française, doublé des couleurs distinctives de chaque régiment, d'une veste et d'une culotte de peau. La durée de l'habit et de la veste fut fixée à six ans. Un surtout fait en frac garni de huit gros boutons et le manteau de drap gris-blanc piqué de bleu complétaient l'habillement.
Chevaux légers
Les six régiments de chevaux légers furent vêtus d'un habit à la française en drap bleu-naturel. Chaque régiment reçut une des couleurs distinctives qui avaient été retenues pour la cavalerie. Ils eurent les boutons blancs timbrés d'un cheval monté. Ils reçurent l'aiguillette plate blanche losangée de la couleur du régiment sur l'épaule gauche.
Dragons
Les régiments de dragons furent partagés en fonction de leur ancienneté en six classes ayant chacune une couleur distinctive. Ils étaient vêtus de l'habit vert-foncé, de la veste et de la culotte blanche. Chaque classe comportait deux divisions à deux régiments sauf la première qui en comportait trois. La première division avait des boutons godronnés et timbrés jaunes, la seconde les avait blancs. Ceux qui avaient les boutons jaunes avaient les poches en travers ; ceux qui avaient les boutons blancs avaient les poches en long. Le premier régiment de chaque division avait les revers et parements de la couleur de la classe, le second, le revers seulement.
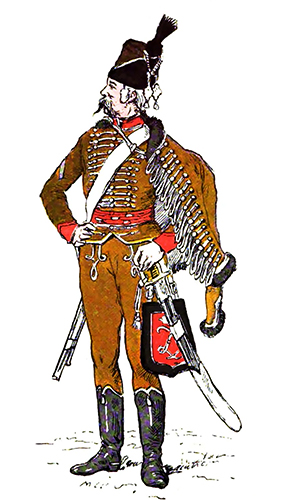
Ils conservaient les bottes molles en cuir de veau et percevaient une paire de guêtres noire identique à celle de l'infanterie, pour effectuer le service à pied. Les dragons, officiers compris, continuaient de porter le casque en cuivre jaune.
Chasseurs à cheval
Comme les dragons, les chasseurs à cheval avaient l'habit en drap vert-foncé, mais sans poche. Ils avaient la veste de drap chamois, la culotte de peau. Les six régiments reçurent une couleur distinctive et les boutons blancs timbrés d'un cor de chasse et du numéro de chaque régiment. La couleur de distinction s'appliquait pour les six régiments sur les revers et les parements. L'habit fut garni sur l'épaule gauche d'une épaulette à fond blanc, losangée de la couleur du régiment.
Hussards
Les quatre régiments de hussards conservaient l'uniforme coupé à la hongroise en drap de la couleur affecté à chaque corps. Pelisse et veste en drap bleu-céleste foncé pour le premier régiment, brun-marron pour le deuxième, vert pour le troisième avec boutons blancs et gris-argentin pour le dernier avec boutons jaunes. Cet habillement était composé d'une pelisse de drap, doublée d'une peau de mouton blanc, bordée de mouton noir; d'un dolman de drap de couleur pareille à la pelisse et d'une culotte de drap de la couleur de l'uniforme.
On simplifia l'uniforme en supprimant les galons et agréments de toute espèce. Seules les ganses en laine ou fil de couleur nécessaires pour les boutonnières furent conservées avec trois rangs de boutons de métal. Une ganse identique à celle des boutonnières couvrait les coutures du dolman, de la pelisse et les ouvertures de la culotte. Les hussards portaient le schako de feutre noir, façonné à la Hongroise et bordé d'un galon. Ils avaient les cheveux retroussés en queue raccourcie à la longueur de deux ou trois pouces. Leur uniforme particulier imposa l'abandon de l'épaulette pour des marques distinctives de grades particulières (1).
Indépendamment des parties d'habillement, toutes ces formations montées reçurent un surtout et un gilet supplémentaires. Les neufs étaient réservés à la parade, les usés aux travaux d'écuries, corvées et manoeuvres.
Régiments particuliers
On attacha aux régiments royaux, formant une série de sept, le bleu de roi, aux régiments des princes, formant une série de dix, l'écarlate. Les troupes provinciales eurent l'habit blanc à revers bleus et les régiments coloniaux l'habit bleu.
Le corps royal d'artillerie conservait son habit de drap bleu-de-roi avec parements et doublure rouge. L'habillement de la gendarmerie fixé par le règlement du 18 février 1772 et celui de la maréchaussée réglé par l'ordonnance du 28 avril 1778 étaient maintenu.
(1) L'habit-veste avait des basques amples et le plus souvent doublées. Pour faciliter la marche, les basques tombant sur le devant des cuisses furent relevées et attachées sur les côtés. Cela permettait également de faire apparaître la couleur de la doublure qui entrait dans la distinction des régiments. Sous Louis XVI la partie des basques couvant le devant des cuisses fut supprimée. Ce nouvel habit prit le nom d'habit à la française.
(2) Marques distinctives de grade:
Avec le règlement du 1er octobre 1786, le marquis de Ségur, nouveau secrétaire d'État, élabora un texte qui reprit l'ensemble des dispositions qui avaient été prises sur l'habillement et l'équipement des troupes et apporta de nombreuses précisions sur des détails qui avaient fait l'objet de polémique. Cette grande ordonnance devait être la dernière élaborée par l'ancien régime sur l'uniforme dans les armées. Elle n'allait pas s'effacer immédiatement, mais allait devenir un texte de référence pour l'élaboration des règlements qui lui succéderont.
Les officiers généraux
Ce règlement (pdf - extrait) conservait aux lieutenants-généraux et maréchaux de camp leurs grand et petit uniformes tels que décrits dans le règlement du 2 septembre 1775, mais il mit officiellement en vigueur l'usage des étoiles.

Les uniformes étaient composés chacun d'un habit de drap bleu-de-roi avec les parements fermés en botte et le collet droit de même couleur, mais sans revers, d'une veste et d'une culotte de drap écarlate.
L'habit de grand uniforme était orné d'une large broderie de filés d'or passé et fermant par une seule rangée de douze boutons. La veste était bordée de la même broderie que l'habit et garnie sur le devant de douze boutons. L'habit et la veste de petit uniforme étaient exécutés et bordés comme pour le grand uniforme à la différence que la broderie était réduite de moitié. Le grand uniforme avec chapeau bordé d'or n'était porté qu'à la Saint Louis et aux grandes cérémonies ou occasions de parade. Le petit uniforme devait seul être en usage à l'armée dans les garnisons ou les camps et porté avec veste et culotte blanches, chapeau uni à plumet noir.
Distinction des grades.
Les lieutenants-généraux avaient deux rangs de broderie sur les parements de l'habit et quatre rangs aux poches, dont deux au-dessous et trois rangs à la poche de la veste. L'habit et la veste des maréchaux de camp étaient semblables à ceux des lieutenants généraux, mais sans double broderie aux parements et aux poches de l'habit.
Les officiers généraux qui étaient commandants de régiments ou attachés à un corps particulier pouvaient en porter l'uniforme. Ils se distinguaient alors en mettant un plumet blanc à leur chapeau, et en rajoutant aux épaulettes de mestre de camp-commandant, trois étoiles pour les lieutenants généraux et deux pour les maréchaux-de-camp. Ces étoiles, en or ou en argent, étaient en opposition avec la couleur or ou argent de la tresse de l'épaulette.
L'épaulette de mestre de camp-commandant, ornée d'une seule étoile, fut réservée aux mestres de camp et aux lieutenants-colonels qui avait le grade de brigadier.
Le chapeau des Officiers généraux était bordé d'un galon d'or semblable à celui ornant l'habit. Ils ne pouvaient porter le plumet blanc que sur le chapeau uni. Leur manteau bleu-de-roi était bordé de la même broderie, double pour les lieutenants généraux et simple pour les maréchaux de camp.
L'épée des lieutenants généraux et les maréchaux de camp était ornée d'une dragonne en galon d'or avec une frange en or à graine d'épinard et cordes de puits. Trois étoiles en argent étaient brodées sur le gland des dragonnes des lieutenants généraux et deux étoiles pour les maréchaux de camp.
Troupes à pied
L'infanterie conservait son habit blanc aux poches figurées sur les basques par un passepoil de la couleur distinctive. Les revers furent élargis dans leur partie haute pour suivre le contour du collet et se terminer au bord de l'épaulette. Les parements, serrés aux poignets, étaient ouverts sur le côté et se fermaient à l'aide de deux boutons. Les habits, dont les parements et les revers étaient de la couleur du fond, étaient détachés par un passepoil de couleur tranchante. Les sous-officiers et soldats des compagnies de fusiliers portaient une épaulette et une contre-épaulette en drap du fond de l'habit, liserées de la couleur tranchante avec un petit bouton. Celles des grenadiers étaient en drap écarlate lisérées de blanc auxquelles on retira la houppe. Il en fut de même pour les chasseurs qui les avaient verte liserées de blanc. Les retroussis des habits des fusiliers conservaient la fleur-de-lys, ceux des grenadiers la grenade et ceux des chasseurs le cor-de-chasse. Les boutons étaient de cuivre ou d'étain, suivant l'uniforme affecté à chaque régiment. Les gilets furent supprimés, la culotte à pont-levis conservée. La durée des habits et des vestes fut fixée à trois ans.
Le chapeau de feutre à trois cornes bordé d'un galon de laine noire et de sa cocarde de basin blanc fut conservé. Celui des grenadiers fut orné au-dessus de la cocarde d'une houppe de laine écarlate, celui des chasseurs d'une houppe verte, celui des fusiliers, d'une houppe de la couleur de leur compagnie, celle des adjudants était blanche. Ils conservaient le bonnet de police en forme de pokalem orné d'une fleur-de-lys pour les fusiliers, d'une grenade pour les grenadiers et d'un cor pour les chasseurs.

Les marques distinctives de grade.
Les adjudants conservaient l'épaulette à fond de soie couleur de feu, traversée, dans le milieu de sa longueur, de deux cordons de tresse d'or ou d'argent, suivant la couleur du bouton. Le double bordé d'argent fin des sergents-majors sur le parement fut remplaçait par deux galons d'argent placés obliquement sur l'avant-bras. Les sergents n'en portaient qu'un. Les fourriers conservaient les deux galons d'argent cousus en travers sur le haut du bras. Les caporaux eurent les galons de laine placés comme les sergents-majors. Ils étaient bleus pour les régiments qui avaient l'habit blanc, et de fil blanc pour les régiments qui avaient l'habit, soit bleu, soit rouge. Les appointés (1) n'en portaient qu'un. Les soldats-charpentiers se distinguaient par deux haches en sautoirs cousus sur le haut du bras, les hommes rengagés, continuaient de porter le chevron ou le double chevron.
L'habillement des officiers était identique à celui des soldats hormis la qualité des matières. Ils portaient en été des vestes et des culottes de basin blanc et en hiver, des culottes et des bas de laine noire (1). Leurs chaussures étaient ornées d'une boucle en argent. Ils devaient avoir les cheveux liés en catogan. Les marques distinctives de leur grade continuaient d'être réglées conformément aux prescriptions du règlement de 1779. Cependant, de nouveaux emplois avaient été créés. Ainsi, après le mestre de camp commandant et le mestre de camp en second, on vit apparaître le mestre de camp à la suite. Pour le distinguer, on lui donna les épaulettes du mestre de camp-commandant, mais coupées dans leur milieu par deux cordons de soie couleur de feu. Il en fut de même avec l'emploi de capitaine de remplacement qui s'ajouta aux capitaines-commandants et capitaine en second. Ils portaient l'épaulette des capitaines-commandants sur l'épaule gauche traversée en son milieux par deux cordons de soie tressée couleur de feu. On créa également les sous-lieutenants de remplacement qui portaient l'épaulette des sous-lieutenants, mais traversée, dans son milieu, par un cordon d'or ou d'argent tressé. Les quartiers-maîtres-trésoriers, qui suivant le rang qu'ils avaient obtenu dans le régiment, pouvaient porter l'épaulette des lieutenants en premier ou en second. Le hausse-col de cuivre doré, orné d'un médaillon en argent aux armes du roi, fut maintenu.
L'entretien de l'équipement et l'hygiène corporelle furent renforcés. La moustache fut interdite sauf pour les grenadiers qui avaient toujours interdiction de les graisser. Les cheveux furent liés en catogan et enveloppés dans un cuir noirci. Le soldat devait être bien peigné, son habit bien ajusté et entièrement boutonné. Les couleurs affectées aux régiments suivant leur classe étaient conservées.
L'habillement du Corps Royal de l'artillerie, façonné exactement dans les mêmes formes et proportions que celui de l'infanterie, était toujours de drap bleu de roi, avec doublure rouge pour l'habit et blanche pour la veste. Le collet et les épaulettes étaient de drap bleu, les parements de drap écarlate, les poches en travers étaient figurées et détachées du fond de l'habit, comme les revers, par un liseré de drap écarlate, les boutons jaunes numérotés. Les marques distinctives pour les sous-officiers étaient de galon d'or, celles des caporaux et appointés, de galon de laine jaune. Les chevrons en laine jaune étaient destinés aux soldats de 1re et de 2e classe et les chevrons en laine rouge aux rengagements.
(1) Le grade d'appointé supprimé par l'ordonnance du 25 mars 1776, fut rétabli par celle du 12 juillet 1784.
(2)La tenue d'hiver se portait du 1er octobre au 1er avril.
Les troupes montées
L'habillement de la gendarmerie demeura tel qu'il fut fixé par les règlements particuliers des 18 février 1772 et 4 avril 1781. Celui de la maréchaussée demeura conforme à l'ordonnance du 28 avril 1778 à l'exception des manteaux qui furent en drap bleu parementé d'écarlate.
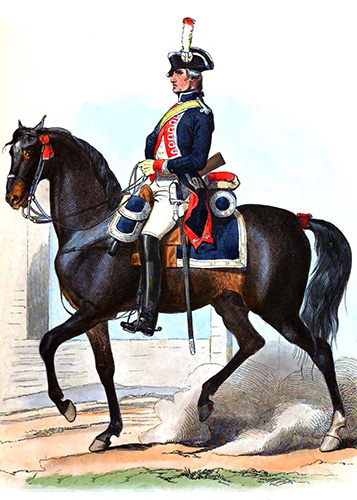
L'habit et la veste des régiments de cavalerie et de dragons furent réalisés sur le même modèle que ceux de l'infanterie. La veste ne comportait ni parement ni collet de la couleur de distinction. Tous les régiments de cavalerie portaient l'habit en drap bleu-de-roi, avec poches en travers, la veste en drap blanc, la culotte de peau blanchie et le surtout de drap bleu. La culotte uniforme était de peau de daim. Les régiments de dragons portaient l'habit en drap vert foncé, la veste en drap blanc, la culotte de peau blanchie et le surtout de drap vert. Les sous-officiers et cavaliers percevaient un surtout et un gilet taillé dans des étoffes usagées. Le surtout, façon frac, était garni de boutons, de l'épaulette et de la contre-épaulette. Un manteau de drap gris-blanc piqué de bleu orné de brandebourgs complétait l'habillement. Celui des dragons avait un capuchon.
La cavalerie coiffait le chapeau semblable à celui de l'infanterie, mais plus haut pour y glisser la discrète. La cocarde était identique à celle de l'infanterie. Ils avaient les cheveux liés en queue couverte de ruban noir. Les dragons conservaient le casque en cuivre jaune avec cimier et rosette de même métal, garni d'une crinière noire et recouvert d'une fourrure de peau de chien marin. Ils avaient les cheveux liés en catogan, avec un ruban noir noué en rosette. Les quatre compagnies de chaque régiment reçurent une couleur unique suivant leur numéro d'ordre. Chaque compagnie se distinguait par une houppe ronde en laine portée au-dessus de la cocarde dans la cavalerie, au-dessus de la rosette gauche pour le casque des dragons. Elle était écarlate pour la première compagnie, bleu céleste pour la seconde, rose pour la troisième et souci pour la quatrième. Les deux adjudants, le maître-maréchal, le maître-sellier et l'armurier portaient la houppe blanche. Le bonnet de police, façonné à la dragonne, fut conservé.
Les sous-officiers, cavaliers et dragons portaient des marques distinctives relatives à leur grade, emploi ou ancienneté. Les adjudants portaient l'épaulette à fond de soie couleur de feu, traversée, dans le milieu de sa longueur, de deux cordons de tresse d'or ou d'argent, suivant la couleur du bouton. Pour les maréchaux des logis en chef, le double bordé de galon fut remplacé par deux galons d'argent fin placé obliquement sur l'avant-bras. Les fourriers, dont le rang avait été fixé après celui des maréchaux en chef, portaient les deux mêmes bandes d'argent fin, mais placées sur le haut du bras. Les maréchaux des logis portaient un seul galon d'argent sur l'avant-bras. Les brigadiers portaient sur l'avant-bras deux galons de fil blanc, les appointés n'en portaient qu'un. Les cavaliers ou dragons Gentilshommes portait l'épaulette sans frange. Les maréchaux-ferrants portaient sur le haut du bras de chaque manche un fer à cheval en galon de fil blanc. Les hommes rengagés continuaient de porter le chevron ou le double chevron en galon de fil blanc.
L'habillement des officiers de cavalerie et des dragons ne différait de celui de la troupe que par la qualité du drap. Les officiers de cavalerie étaient coiffés du même chapeau que celui des cavaliers, garnis d'une cocarde de basin blanc et d'une houppe en poil de chèvre de la couleur affectée à leur compagnie. Celle des officiers de l'état-major était blanche. Les officiers de dragons avaient le chapeau et portaient lecasque en service. Les manteaux des officiers de cavalerie étaient de drap bleu, ceux des dragons étaient verts. Les officiers de cavalerie et de dragons devaient toujours être en tenue au régiment. Les marques distinctives des grades étaient similaires à celles de l'infanterie. Les couleurs affectées aux régiments suivant leur classe étaient conservées.

L'habillement des sous-officiers et hussards était coupé à la hongroise, en drap des couleurs affectées à chaque régiment. Il était composé d'une pelisse, d'un dolman et d'une culotte. La pelisse et le dolman étaient garnis de trente-six agréments ou boutonnières, formés avec des ganses carrées de laine ou de fil des couleurs affecté à chaque régiment. Les coutures étaient recouvertes d'une ganse plate de la même couleur que celle réglée pour les boutonnières. La doublure de la pelisse était de peau de mouton blanc bordée de mouton noir, avec au collet un gros cordon et un bouton en olive de la même couleur que les agréments. Les hussards avaient l'écharpe de laine cordonnée de couleur cramoisie, le manteau avec capuchon, un surtout et un gilet. Ils étaient coiffés d'un bonnet ou schako de feutre noir, façonné à la hongroise, doublé d'étoffe de laine des couleurs affectées à chaque régiment et bordé d'un galon. Ils avaient pour seconde coiffure le bonnet de police façonné à la dragonne.
Les marques distinctives consistaient pour les adjudants à porter trois chevrons d'argent sur le bras, deux pour les maréchaux des logis en chef et un pour les maréchaux des logis. Les fourriers avaient deux galons d'argent cousus en travers sur la manche, les brigadiers, deux galons de fil blanc cousus au-dessus du parement, les appointés un seul. Les maréchaux-ferrand et les rengagés avaient les mêmes insignes que dans la cavalerie.
L'habillement des Officiers était identique à celui des Hussards et ne différait que par la qualité des draps. Lorsqu'ils étaient vêtus du surtout, ils portaient les épaulettes réglées pour les officiers de cavalerie. Lorsqu'ils ne le portait pas, les marques distinctives des grades consistaient pour le mestre de camp-commandant et le mestre de camp en second à porter à l'ouverture de la culotte et au parement, cinq galons, deux larges et trois fins, placés en chevron brisé. Le lieutenant-colonel en portait quatre, deux fins et deux larges. Le major en portait également quatre, trois fins et un large, les capitaines-commandants quatre fins, les lieutenants en premier et en second, deux galons fins, les sous-lieutenants ne portaient qu'un bordé fin au retroussis du parement. Le quartier-maître-trésorier portait les deux galons fins des lieutenants.
Par une décision du 24 novembre 1788, le comte de Brienne, secrétaire d'État de la Guerre, supprima les catogans dans toute l'armée, seules furent autorisées les queues de 10 pouces liées par une lanière de cuir comme celle de la cavalerie.
Les réformes de 1788
À la suite de l'ordonnance de 1786, ce ne sont pas moins de quarante ordonnances qui furent publiées entre le 30 septembre 1787 et le 14 mai 1788. Ces ordonnances portaient sur la compositions des corps existants, la création et la suppression d'unités et leur administration en général. Le comte de Brienne présidait le conseil de Guerre qui est à l'origine de ces ordonnances. Nous allons exposer succinctement les grandes lignes de cette réforme en nous appuyant sur une partie de ces ordonnances.
L'infanterie
Le complet de l'infanterie fut fixé à soixante-dix-neuf régiments français et vingt-trois étrangers. Chaque régiment était à deux bataillons. Le premier était constitué de quatre compagnies de fusiliers et une de grenadier, le second, de quatre compagnies de fusiliers et une de chasseur. Les emplois de mestre de camp en second dans tous les régiments d'infanterie et de cavalerie étaient supprimés et l'onGrenadier - 1788 créa le grade de major en second. Les emplois de capitaines et de sous-lieutenants dits de remplacement, ainsi que les officiers dits attachés ou à la suite étaient également supprimés.

La dénomination de bas-officier ne comprenait que les sergents-majors, les fourriers, les sergents et tambours-majors. Le caporal faisait partie du rang. Le titre de colonel fut substitué à celui de mestre de camp (1). Le grade de brigadier des armées était supprimé. Ceux qui en étaient revêtus le conservait jusqu'à extinction. Les colonels, lieutenants-colonels ou majors qui se distinguaient à la guerre par une action d'éclat recevaient une lettre de commandement qui leur permettait d'exercer sur tous les officiers de leur grade. Ils étaient distingués par une étoile d'or ou d'argent sur l'épaulette et sur le cordon de la dragonne de leur grade.
Le nombre de lieutenants-généraux fut fixé à 160. Celui des maréchaux de France fut fixé à 12.
L'expérience ayant prouvé la nécessité d'avoir des unités autonomes et indépendantes pour éclairer la progression des troupes, on créa des formations spéciales que l'on désigna sous la dénomination d'infanterie légère. Pour donner à ces unités la consistance nécessaire à leur autonomie, il fut créé douze bataillons de chasseurs. Ils étaient tous à quatre compagnies, commandées chacune par un capitaine commandant, un capitaine en second, un lieutenant en premier, un lieutenant en second, deux sous-lieutenants, un sergent-major, un fourrier, quatre sergents, huit caporaux et huit appointés. Les bataillons étaient commandés par un lieutenant-colonel secondé par un major. Ces bataillons n'avaient pas de compagnie de grenadiers.
Les chasseurs continuaient de porter l'uniforme prescrit par le règlement de 1786. Ils avaient l'habit, la veste et la culotte vert foncé avec les revers et les parements de la couleur affectée à chaque bataillon. Les retroussis des chasseurs à pied ou à cheval étaient ornés d'un cor de chasse. La culotte des chasseurs à pied fut faite en pantalon, c'est-à-dire qu'elle descendait jusqu'à la cheville. Celle des chasseurs à cheval était faite à la hongroise. Ils reçurent le surtout et le gilet de drap identiques à ceux de la cavalerie et le manteau de drap vert. Ils coiffèrent le chapeau à visière puis reçurent le casque en cuir bouilli à chenille noire. Les compagnies se distinguaient par la houppe de couleur au chapeau. Comme la cavalerie, les adjudants, le maître-maréchal, le maître-sellier et l'armurier portaient la houppe blanche. Le bonnet de police, façonné à la dragonne, leur fut également donné. Les marques distinctives de grade étaient identiques à celles de l'infanterie pour les chasseurs à pied et identiques à celles des cavaliers et dragons pour les chasseurs à cheval. Les chasseurs à pied disparaîtront sous l'empire.
Les troupes montées
À cette époque, l'organisation de la cavalerie avait atteint son point culminant. Issue des compagnies d'ordonnance créées par Charles VII, elle a tiré successivement de ses rangs les dragons, qui eux-mêmes ont donné naissance aux chasseurs. Les hussards, de leur côté, ont paru et se sont développés. Elle ne comprenait plus désormais sous ce vocable que la grosse cavalerie, la cavalerie de ligne, avec ses cuirassiers, ses carabiniers et la cavalerie légère qui était définitivement constituée.
Ainsi, le complet des troupes à cheval fut fixé à vingt-quatre régiments de cavalerie, dix-huit régiments de dragons, douze régiments de chasseurs et six régiments de hussard. Les régiments de cavalerie et de dragons furent réduits de quatre à trois escadrons. Les escadrons étaient formés de deux compagnies. Chaque compagnie était commandée par un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant. Les régiments de hussards étaient composés de quatre escadrons et chaque escadron de deux compagnies. Une ordonnance du 8 août 1784 avait créé six régiments de chasseurs comprenant chacun un bataillon de chasseurs à pied. Une ordonnance du 17 mars 1788 sépara les six bataillons de chasseurs à pied des six régiments de chasseurs à cheval. Les six bataillons, complétés par six autres bataillons tirés de l'infanterie, formèrent les douze bataillons de chasseurs à pied (voir leur constitution ci-dessus dans le paragraphe infanterie). Les six régiments de chasseur à cheval, complété par six autres régiments tirés des dragons formèrent un corps de douze régiments de cavalerie légère. La composition de ces régiments était identique à celle des hussards.

Les escadrons furent placés sous le commandement d'un chef d'escadron. Le chef d'escadron était un officier subalterne dont le rang fut fixé entre celui de capitaine et celui de major en second. Comme pour l'infanterie, il fut créé un emploi de major en second qui avait autorité sur tous les chefs d'escadron. Il était subordonné au major qui devait rendre compte au lieutenant-colonel et ce dernier au colonel. Il portait pour marques distinctives, les épaulettes de major tranchées dans leur milieu d'un cordon de soie couleur de feu. Le titre de colonel fut substitué à celui de mestre de camp.
Le corps des bas-officiers ne comprenait que les maréchaux des logis en chef et les maréchaux des logis. Les adjudants avaient le rang de premier maréchal des logis en chef. Les porte-étendard avaient rang de sous-lieutenant, le quartier-maître-trésorier avait rang de sous-lieutenant s'il avait servi comme bas-officier et rang de lieutenant s'il était tiré des porte-étendard ou des sous-lieutenants. Le maître-maréchal, le maître-tailleur et maître-sellier avaient rang de maréchaux des logis, les autres maîtres-ouvriers avaient rang de brigadier. Les brigadiers et appointés faisaient partie du rang.
La solde fut payée à chaque fin de mois et non plus sur la base de trente jours comme cela se pratiquait jusqu'alors.
Les officiers supérieurs des troupes à pied et à cheval étaient tirés des régiments de leur arme. Le changement d'arme leur était interdit afin d'assurer aux régiments d'être commandés par des officiers qui connaissaient l'arme. Les colonels parvenaient au grade de maréchal de camp au bout de seize ans de service, les lieutenants-colonels au bout de vingt ans. Les maréchaux de camp n'étaient plus faits lieutenants généraux par le seul droit de l'ancienneté, mais au choix.
Les quatre compagnies des gardes du corps du roi furent réduites chacune à un escadron. Cela entraîna la suppression de 400 chevaux. Les huit compagnies d'hommes d'armes des ordonnances formant le corps de la gendarmerie étaient supprimées.
L’embrigadement et l’endivisionnement permanents des troupes furent définitivement adoptés. Tous les régiments d'infanterie et des troupes à cheval étaient formés en brigade commandée par un maréchal de camp. Chaque brigade était composée de deux régiments, chacun commandé par un colonel. L'ensemble des troupes était partagée en 21 divisions territoriales, comprenant 48 brigades d’infanterie (218 bataillons) et 32 brigades de cavalerie (200 escadrons). Toutes les divisions, mixtes ou pas, étaient commandées par un lieutenant général. Les divisions furent réparties en 17 grands commandements placés sous l'autorité d'un commandant en chef qui, suivant l'importance des troupes en présence, était soit un maréchal de France, soit un lieutenant général. Il était secondé par un commandant en second du grade de lieutenant général ou maréchal de camp.
(1) À l'origine, le mestre de camp était un aide attaché au colonel général de l'infanterie pour les détails du service et du commandement. Après la création des régiments (1561) leurs commandants furent par habitude et improprement appelés mestres de camp. Dans l'infanterie, ils étaient subordonnés au colonel général ou à un des colonels généraux de l'arme. Sous Louis XIV quand le grade de colonel général de l'infanterie fut supprimé, les mestres de camp d'infanterie prirent le titre de colonels (28 juillet 1661). Le 5 avril 1780, la charge de colonel général de l'infanterie ayant été rétablie pour le prince de Condé, les chefs de corps reprirent le titre de mestre de camp qu'ils portèrent jusqu'en 1788.
Textes de référence
L'organisation militaire après la révolution
Jusqu'alors le peuple avait fourni les soldats et la noblesse les officiers. Cette disposition fut changée par un décret du 1er février 1790. Chacun eut sa part aux emplois militaires et une armée véritablement nationale constitua la force militaire de la France. Par décret du 5 octobre 1790, l'assemblée constituante remplaça les trois états-majors de l'armée par des adjudants généraux (1). Une loi du 14 octobre suivant fixait à 30 leur nombre, dont 17 avec le grade de colonel et 13 avec celui de lieutenant colonel. Leurs fonctions consistaient dans les reconnaissances militaires, la direction des travaux topographiques, les mémoires relatifs au plan général des opérations de la guerre offensive et défensive, la transmission aux différents corps de toutes armes des ordres verbaux ou par écrit des généraux. Le 30 août 1792, leur nombre fut porté à 40.

Dans une loi du 29 octobre 1790, concernant l'avancement militaire, l'Assemblée nationale revint sur la dénomination de sous-officiers. Ce corps comprenait pour l'infanterie, les sergents-majors, les sergents, les caporaux-fourriers et les caporaux et dans les troupes à cheval, les maréchaux des logis en chef, les maréchaux des logis, les brigadiers-fourriers et les brigadiers. Les adjudants formaient un corps à part. Les emplois d'officiers comprenaient le grade de sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, lieutenant-colonel, colonel, maréchal-de-camp, lieutenant-général, maréchal de France. Le grade de major était supprimé. Ceux qui en étaient revêtus prenaient le grade de lieutenant-colonel. Les charges de colonels généraux, de mestres de camp généraux, de commissaires-généraux, celles de maréchaux généraux des logis, des maréchaux des camps et armées, et de lieutenants des maréchaux de France furent également supprimées.
Ce décret établit cinq armes dans l'armée française : l'infanterie, la cavalerie, l'infanterie légère, l'artillerie et le génie.
Une loi du 1er janvier 1791 fixa la composition de l'infanterie. C'est à cette occasion qu'on prescrivit la suppression des noms portés par les régiments et qu'on leur attribua un numéro distribué suivant leur ordre d'ancienneté. Un décret du 28 janvier suivant appela sous les drapeaux, cent mille volontaires nationaux, destinés à compléter les rangs de l'infanterie de ligne.
Le 4 mars, une loi réduisait à six le nombre des maréchaux de France et à 30 celui des lieutenants généraux en activité. La compagnie de la prévôté de l'hôtel était supprimée le 10 mai et incorporée dans le corps de la gendarmerie nationale nouvellement créé. Elle était plus particulièrement affectée à la protection du corps législatif, de la haute cour nationale, du tribunal de cassation et du ministre de la Justice.
Les 28 et 29 mai suivant, une loi abolissait tous les titres de propriété de régiments de toutes les armes.
Le 31 juin, une loi imposa que le premier drapeau, étendard et guidon (2) de tous les régiments d'infanterie, de cavalerie et des dragons fût désormais aux trois couleurs nationales. Les autres drapeaux étaient aux couleurs affectées à l'uniforme de chaque régiment.
Une loi du 21 octobre relative à la composition de l'armée fixa l'effectif de l'infanterie à 110 590 hommes et 30 040 cavaliers, non compris l'artillerie et le génie. Le nombre des officiers généraux fut fixé à 94.
(1) Le terme de général ayant été abusivement utilisé pour qualifier certaines fonctions militaires, un arrêté consulaire du 27 messidor an XIII (16 juillet 1800) prescrit qu'il sera uniquement réservé pour désigner les officiers généraux. Les adjudants généraux reçurent alors la dénomination d'adjudant commandant. Ils conserveront ce titre jusqu'en 1815, date à laquelle ils prendront celui de colonel chef d'état-major.
(2) Les drapeaux, étendards et guidons en usage dans les armées font aussi partis des uniformes. L'institution de ces trophées remonte aux temps les plus reculés. Les drapeaux sont affectés aux troupes à pied (l'infanterie), les étendards aux troupes à cheval (cavalerie et hussards), les troupes mixtes avaient un guidon (dradons et chasseurs).
Le 10 vendémiaire an I (1er octobre 1792), la convention nationale autorisait le Conseil exécutif à diviser les forces armées de la République, en huit armées qui furent celles du Nord, des Ardennes, de la Moselle, des Voges, des Alpes, des Pyrénées et de l'intérieur.
Dans son décret du 3 ventôse an I de la république (pdf) (21 février 1793), elle consacrait le principe qu'il n'existait plus aucune différence entre les corps d'infanterie, appelés régiments de ligne et les volontaires nationaux. L'arme était organisée en demi-brigade composée chacune d'un bataillon des régiments de lignes et de deux bataillons de volontaires. Chaque bataillon était composé de neuf compagnies, dont une de grenadiers et huit de fusiliers. Quatre demi-brigades formaient une division. Le complet d'une demi-brigade en officiers, sous-officiers et soldat était à deux mille quatre cent trente-sept hommes.
La chaîne de commandement fut réorganisée pour s'adapter à ce remaniement. La dignité de maréchal de France, et les dénominations de lieutenant-colonel et de major furent supprimées. Les lieutenants-colonels d'infanterie reçurent le titre de chef de bataillon et ceux de cavalerie celui de chefs d'escadron. Les appellations de lieutenant-général, de maréchal de camp et de colonel, furent remplacées par celles de général de division, général de brigade et de chef de brigade. Le titre de général d'armée fut changé en celui de général en chef. Ces derniers ne pouvaient exercer leur commandement que sur commission temporaire. Les divisions furent placées sous le commandement d'un général divisionnaire, ayant sous ses ordres deux généraux de brigade, un adjudant général, deux adjoints et un commissaire des guerres.
La convention, qui avait conservé les adjudants généraux, les désigna sous la dénomination d'adjudant général chef de brigade et adjudant général chef de bataillon. Il y eut dans chaque état-major un chef d'état-major qui prit le titre de brigadier général.
Les bas-officiers furent appelés sous-officiers. Ce corps comprenait pour toutes les armes, les adjudants sous-officiers et les fourriers, auxquels s'ajoutait pour l'infanterie, les sergents-majors, les sergents et caporaux et pour la cavalerie, les maréchaux des logis chef, les maréchaux des logis et les brigadiers (1).
(1) Les caporaux et brigadiers cesseront de faire partie des sous-officiers en 1818 en vertu des lois Gouvion Saint-Cyr.
Pour marquer le changement de régime au sein des forces armées, une des premières décisions de la convention nationale concernant l'uniforme, fut de décréter le 13 vendémiaire an I de la République (24 octobre 1792) que les boutons de toutes les troupes de la République devraient désormais porter la légende République Françoise et qu'ils seraient ornés en leur milieu d'un faisceau surmonté du bonnet de la liberté.

Deux jours plus tard, le 15 vendémiaire (6 octobre), elle décidait de mettre à la disposition du ministre de la Guerre une somme de vingt millions de livres pour « être employé à tout ce qui concerne l'habillement et l'équipement des troupes ». Des ateliers de confection pour l'habillement, étaient alors créés tant à Paris que dans les villes de garnison.
Avec le décret du 3 ventôse an I de la République (pdf) (21 février 1793), l'habit blanc des fantassins devait disparaître au profit de l'habit dit aux couleurs nationales(1). C'était un habit bleu national aux longues basques battant sur les talons, avec doublure blanche, boutons jaunes, passepoil écarlate, parements et collet écarlates, passepoil blanc, revers blanc et passepoil écarlate, manches ouvertes à trois petits boutons, l'agrafe du retroussi écarlate. Les fantassins reçurent aussi à cette époque la longue guêtre de drap noir boutonnant jusqu'au-dessus du genou et donnant plus de solidité à la marche. Une culotte blanche et des souliers de cuir épais complétaient ce costume.
Les deux larges courroies de cuir blanc croisant sur la poitrine furent conservées. L'une supportait la giberne et la baïonnette sur le dos, l'autre était destinée à soutenir le sabre-briquet (2) sur le flanc gauche avec un sac de peau de chèvre. Le havresac fut conservé pour l'infanterie et le porte-manteau pour la cavalerie. Les cheveux longs pendaient en crinière sur les deux oreilles et étaient liés en queue par-derrière dans un ruban de fil noir qui les emprisonnait jusqu'à la nuque. Selon les corps, les soldats avaient pour coiffure un casque de cuir solide surmonté d'une chenille de crins noirs ou bien un chapeau de feutre à bords retroussés orné d'une cocarde tricolore et d'un pompon de forme allongée dit carotte.
L'uniforme vert fut laissé aux bataillons de chasseurs ainsi que le casque à chenille rabattue jusque sur la visière. Au lieu d'être en cuir bouilli, il fut en feutre verni, ce qui le rendit plus léger. Les chasseurs à cheval, qui ne portaient pas l'habit, conservaient le caraco.
Comme il était précisait dans l'article 1er du décret du 21 février, le changement d'habillement devait s'opérer au fur et à mesure que l'administration serait obligée de le renouveler. Cependant, la question de l'uniforme national souleva de nombreuses réticences dans le corps des officiers. Pour les y contraindre, la convention nationale prit, le 25 avril 1793, l'arrêté suivant : « Il est défendu à tout officier d'infanterie de quelque grade que ce soit de se pourvoir désormais d'habits neufs autres que celui décrété pour l'uniforme national et il est enjoint à tous ceux d'un grade supérieur à celui de lieutenant de s'habiller de cet uniforme national dans le courant du mois. Les supérieurs des corps, les officiers généraux de division et généraux en chef sont tenus, sous leur responsabilité et à peine de destitution, de faire exécuter rigoureusement le présent arrêté ». Les officiers s'exécutèrent, mais leur obéissance aux ordres de la Convention fut lente.
(1) Par décrets impériaux des 25 avril et 24 juillet 1806, Napoléon voulu faire reprendre l'habit blanc aux régiments d'infanterie avec collet, parements et passepoil aux couleurs tranchantes pour les différencier, mais une décision impériale du 26 juin 1807 abrogea ces textes et ordonna que tous les corps d'infanterie de ligne continuent de porter l'habit bleu et qu'aucun régiment de cette arme ne devra à l'avenir être habillé en drap blanc (journal militaire 1807 - seconde partie, p. 118).
(2) Un décret impérial du 7 octobre 1807 supprima cette arme pour les voltigeurs et tous les soldats de l'infanterie légère et étrangère (journal militaire 1807 - seconde partie, p. 113).
Le 4 avril 1793, la Convention nationale décida que l'uniforme national serait donné aux officiers généraux et chargea le Comité militaire de proposer les signes distinctifs des grades.

Un arrêté du comité de salut public du 26 prairial an II (pdf) (14 juin 1794) leur donna l'habit de drap bleu national doublé d'étoffe de la même couleur avec les revers de la même pièce que les devants de l'habit. Chaque côté de l'habit était garni de six gros boutons correspondant à six boutonnières. Le collet n'était plus droit, mais renversé. Il était de trois pouces de haut en drap écarlate. Les parements écarlates avaient des pattes de drap blanc garni chacun de trois boutons. Les poches en travers étaient également garnies de trois boutons. Le collet et les parements étaient liserés de drap bleu, les poches et les pattes des parements étaient liserées en drap écarlate. Le collet, les parements et les pattes des parements étaient ornés d'une broderie d'or. L'habit était orné de deux gros boutons aux hanches et deux gros au bas des plis.
Les gilets et culottes écarlates furent remplacés par des gilets et culottes blancs. Le gilet fermait par une série de douze petits boutons, la culotte en avait six à chaque côté.
Les généraux prirent le chapeau de feutre noir bordé d'un galon d'or de douze lignes de largeur. Il était orné d'une cocarde surmontée d'un panache de plumes tricolores.
Les généraux de division se distinguaient par une double broderie d'or sur le collet, les parements et pattes de parements. Le général en chef portait en plus un ruban façonné en broderie d'or en dessus et en dessous des revers.
L'habillement des généraux comprenait aussi la redingote bleu nationale, avec collet et parements écarlates, les pattes blanches et le même ruban cousu en bordé comme sur l'habit. Le manteau bleu national avait la même broderie sur le collet et au bas de la rotonde.
Les officiers généraux ne portaient pas l'épaulette.
Les adjudants généraux, bien qu'appartenant au corps des officiers supérieurs, reçurent un habit d'uniforme semblable à celui des officiers généraux. Cet habit avait deux boutonnières en fil d'or à chaque bout du collet, deux à chaque parement et le galon avec baguette dentelée. Une redingote pareille à celle des officiers généraux avec deux boutonnières à chaque bout du collet et deux à chaque parement, le manteau bleu national garni de la baguette dentelée sur le collet et la rotonde.
Leur chapeau était bordé d'un galon d'or de huit lignes de large et garni d'une ganse de fil d'or de six lignes de largeur.
Les adjudants généraux portaient l'épaulette en fil d'or du grade dont ils étaient pourvus.
Sous le directoire, les troupes ne furent guerre mieux vêtue que sous le consulat. L'heure n'était pas encore venue pour envisager de modifier l'uniforme en profondeur et l'on s'efforçait de réparer les existants ou de remplacer ceux qui tombaient en lambeaux. Nous pouvons constater ce minimalisme dans une loi du 7 germinal an V concernant le mode d'admission et d'avancement dans le nouveau corps de la gendarmerie. Cette loi lui conservait son ancien uniforme et lui imposait simplement l'aiguillette aux trois couleurs. La principale préoccupation était de verser les soldes, d'abonder les différentes masses nécessaires à l'entretien des troupes, l'achat et l'entretien des chevaux, l'achat de l'armement, des poudres, etc. en bref tous les éléments permettant de maintenir une armée d'environ 500 000 hommes (1) sur le pied de guerre.
La misère vestimentaire dans laquelle était tombée l'armée ne résultait pas uniquement des problèmes d'approvisionnement en tissus et autres matières, de ceux liés à leur confection, à leur transport, elle avait un puissant allié qui était l'absence de sens moral. Ainsi par exemple, certains fabricants peu scrupuleux profitèrent du désordre pour expédier dans les magasins de la république des effets de très mauvaise qualité. Les conseils d'administration des corps de toutes les armes s'en étaient fréquemment plaints auprès du ministre de la guerre qui diligenta une enquête. Hélas, on ne pu remonter aux auteurs de ces fournitures fautes de signes qui puissent les désigner. Pour faire cesser l'abus, le ministre, dans une lettre du 28 ventôse an V, enjoignit au bureau central de l'habillement de ne recevoir à l'avenir aucun effet qui ne porta le timbre du fournisseur auquel il rajouta la marque du magasin dans lequel ces effets seraient réceptionnés.
(1) L'arrêté prit par le directoire le 18 nivôse an IV (8 janvier 1796) sur l'organisation des armées, fixe sa force à 563 603 hommes. L'historien Philippe Henri de Griomard, dans son livre Recherche sur la force de l'armée française (1806), estime que ce chiffre n'a jamais été atteint.
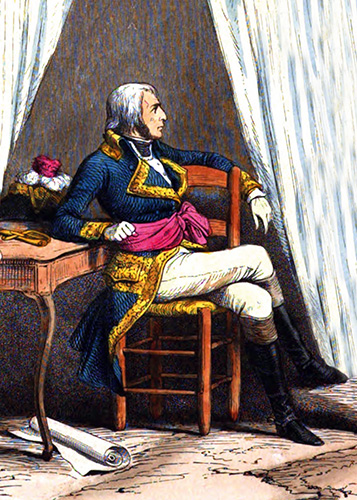
Dans le tumulte des guerres menées par la république, un arrêté du directoire exécutif du 10 pluviôse an IV (pdf) (30 janvier 1796), relatif aux uniformes des officiers généraux et officiers des états majors des armées, modifia l'arrêté du 26 prairial an II. L'uniforme des officiers généraux restait dans son ensemble identique à celui de l'arrêté précédent, mais comportait quelques différences.
L'habit était désormais sans revers et boutonnait droit. Il était orné du galon d'or dans toute sa longueur pour les généraux en chef. Les généraux de rang inférieur n'avaient la broderie que sur le collet, les parements et les poches, avec un double rang pour les généraux de division et un simple rang pour les généraux de brigade.
Une ceinture rouge et blanche ornée d'une frange en or ceignait la taille des généraux en chef qui portaient à leur chapeau un panache rouge élevé au-dessus de trois follettes tricolores.
- Le général de division portait une ceinture écarlate ornée d'une frange tricolore et avait à son chapeau trois follettes ponceau (rouge vif) surmontées d'un panache tricolore.
- Le général de brigade portait une ceinture bleu ciel ornée d'une frange tricolore et avait à son chapeau trois follettes tricolores surmontées d'un panache aux mêmes couleurs.
Sous le directoire, toute l'infanterie fut vêtue misérablement en raison d'une activité de guerre permanente, de l'éparpillement des corps, du désordre des finances, de la dépréciation des assignats, mais surtout de l'absence de tout principe. Les régiments dissous étaient versés dans diverses armes, ainsi amalgamés les bataillons étaient composés de soldats aux uniformes bigarrés. L'An VIII permit d'apporter une légère amélioration à cette situation, mais l'embellie fut de courte durée. Le désordre persista et il fallut attendre le règlement du 1er vendémiaire an XII pour rendre à l'Armée tout son lustre.
L'uniforme ne cessa de subir de très nombreuses variations consécutives aux évènements politiques, à l'amélioration des matières, à l'évolution technologique des armes, à l'installation de troupes dans des contrées aux différents climats, aux nouvelles stratégies développées sur les champs de bataille, etc. Il ne fut jamais abandonné et fut l'un des moyens les plus efficaces pour maintenir le respect de la dignité militaire dans les rangs de l'armée, car l'esprit de corps ne souffre jamais que l'uniforme soit déshonoré par celui qui le porte. Il permit également de supprimer de ces vêtements toutes distinctions de luxe ou fantaisie afin que l'autorité de chaque grade puisse s'exercer pleinement sans risque d'être humiliée et méconnue par l'éclat de la fortune.