
Le Maroc se situe dans la partie occidentale de l'Afrique du Nord autre fois désignée sous le nom de Berbérie eu égard à la majorité de ses habitants les Berbères et appelée par les Arabes « Maghreb » (île de l'occident). Les caprices de la nature ont divisé ce pays en quatre grandes régions que sont la région côtière, depuis Tanger jusqu'à Mogador ; la région montagneuse avec ses trois subdivisions le Rif, le Moyen Atlas et le Grand Atlas ; la région du Sous qui jouxte l'Anti-Atlas et le Maroc oriental.
Le sultan Moulay-Mohammed-Ben-Ali est l'un des pères fondateurs de la dynastie alaouite à laquelle appartient le roi actuel, sa majesté Mohammed VI. Il est à l'origine de l'unification du pays alors morcelé en plusieurs petits états indépendants. Son œuvre sera poursuivie par son frère Moulay-Ismaïl, le Louis XIV de cette époque et ses descendants. Dans la seconde partie du XIXe siècle, le pays en proie à de nombreuses dissensions était devenu un objet de convoitise pour plusieurs puissances européennes et un véritable souci pour la France alors établie en Algérie et en Tunisie. En 1908, Moulay Abdelhafid destitue son frère le sultan Moulay Abdelaziz avec l'aide financière de puissances étrangères. Mais son pouvoir est contesté et des soulèvements populaires éclatent dans le pays. Pour se sortir de cette mauvaise situation, le nouveau sultan fit appel à la France qui établira sur le pays son protectorat.

Après la bataille de Taguin (1) ( Algérie ) qui se conclue par la prise de la smala d'Abd el-Kader par le duc d'Aumale le 16 mai 1843, la France entrait en contact avec le Maroc en 1844 à la poursuite de l'émir Abd-el-Kader qui y avait cherché refuge. Ce dernier reçut le soutien du sultan Abd-en-Rhaman qui déclara à son tour la guerre à la France. Il fut défait à la bataille d'Isly (frontière algéro-marocaine) le 14 août 1844 par le maréchal Bugeaud.

En 1845 était signé le traité de Lalla-Marnia qui fixait les frontières entre l'Algérie et le Maroc. Cette frontière imprécise dans le sud fut à l'origine de nouveaux conflits quant aux droits des deux parties sur leurs ressortissants. En 1901 un nouveau traité entre la France et le Maroc venait compléter celui de 1845 et le Maroc confiait à la France le soin de maintenir l'ordre dans l'est du pays.
L'animosité allemande envers la France poussa l'empereur Guillaume II à débarquer en 1905 à Tanger et à se poser en défenseur du Maroc. Cette nouvelle provocation allemande imposa la réunion des puissances européennes qui tranchèrent le litige en faveur de la France. Au cours de cette conférence internationale qui se tint à Algésiras, les plénipotentiaires se préoccupèrent en priorité d'assurer la stabilité du pays en y rétablissant l'ordre et en le développant dans la région. L'acte fut ratifié par le sultan Moulay Abd-el-Aziz le 18 juin 1906.
Parmi les mesures prises, il fut créé les tabors de police. Placés sous l'autorité du sultan, ils assuraient le maintien de l'ordre et la sécurité des ressortissants dans les grandes villes et les huit ports ouverts. Ils avaient pour mission de mettre un terme à la contrebande d'armes sources des désordres et à celle des différents trafics de marchandises qui s'opéraient au détriment du fisc chérifien.
L'installation de l'administration française dans cette région ne se fit pas sans heurt.

Les émeutes étaient fréquentes et le sultan n'était pas toujours en mesure de se faire obéir par tous les chefs de tribu. Le mécontentement des populations indigènes allait grandissant jusqu'à ce 31 juillet 1907 qui vit l'assassinat par une foule hostile de huit ouvriers du port de Casablanca dont trois Français. Cette révolte nécessita l'envoie le 7 août 1907, de 3000 hommes sous les ordres du général Drude qui débarquèrent à Sidi-Belyout pour dégager la ville et devait poursuivre leurs opérations de maintien de l'ordre dans toute la Chaouïa.
Les tribus environnantes s'étant entre temps soulevées, une mehalla conduite par Moulay-Hafid, frère du sultan s'apprêta à intervenir et il fut bientôt nécessaire de débarquer de nouvelles troupes au Maroc. Ainsi apparut la force publique dans ce pays qui devait y remplir le rôle dévolu par le règlement des armées en campagne. Pour ces opérations, l'effectif des gendarmes fut scindé en deux forces publiques différentes et rattachées aux colonnes expéditionnaires.
1) La force publique du Maroc occidental, qui débarqua à Casablanca le 20 septembre 1907 était composée de 1 maréchal des logis, 1 brigadier et 14 gendarmes venant de la 19e légion.
2) la force publique du Maroc oriental dans la région d'Oujda formée le 7 décembre 1907 était composée de 1 maréchal des logis-chef et 8 gendarmes venant de la 4e compagnie de la 19e légion. Elle sera placée sous le commandement du capitaine Bot, de Tlemcen le 27 décembre et sera renforcée de 20 gradés et gendarmes pour accompagner les différentes colonnes effectuant des opérations de police et de pacification dans la région d'Oujda.

Dès le commencement de l'année 1908, le général d'Amade, qui avait succédé au général Drude, mit en mouvement des colonnes qui commencèrent à sillonner la Chaouïa. La force publique détacha aux différentes colonnes des hommes qui remplirent effectivement le rôle de la gendarmerie en campagne faisant le coup de feu au combat et assurant l'ordre dans les camps.
La création des premiers postes de gendarmerie eut lieu en mai 1908 dans la région de la Chaouïa. Ces créations furent bientôt suivies de plusieurs autres. Le rôle de la force publique dans ces postes restait nettement prévôtal ; il était d'ailleurs difficile d'effectuer d'autres services, car toute la vie européenne était concentrée autour des camps. Il n'existait pas encore de colons et l'on ne sortait des postes que pour marcher au combat ou organiser, en arrière, des convois auxquels étaient adjoints des transfèrements de prisonniers.
Le capitaine Marchal, venu de la 19e légion, prit le commandement de la force publique le 9 octobre 1908. D'autres prévôtés furent formées en 1910 pour accompagner les colonnes opérant en pays zaër. Au mois de mai 1911 des brigades furent créées à Rabat et à Salé. En juin, la gendarmerie s'installait à demeure à Fès.
À la suite d'une nouvelle provocation militaire de l'Allemagne qui envoya une canonnière à Agadir, esquissant ainsi une attaque indirecte contre l'intégrité du Maroc, des négociations extrêmement laborieuses eurent lieu et aboutirent à l'établissement du Protectorat français dans l'Empire chérifien. Il fut signé le 30 mars 1912 à Fez par le diplomate Eugène Regnault représentant la France et le sultan Moulay Hafid. Cette entente franco-marocaine fut de courte durée. Le 17 avril suivant éclatait l'émeute sanglante de Fès où les tabors se révoltant massacraient leurs officiers français. 17 officiers, 40 hommes de troupe et 68 Européens étaient tués, 240 militaires blessés. La gendarmerie, comme les autres troupes, était affectée aux tranchées et fut chargée d'organiser la prison militaire. Le conseil de guerre siégeait en permanence.
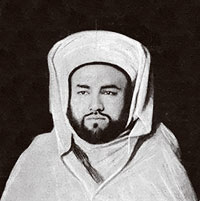
Le 28 avril, le général Lyautey été nommé commissaire résident général.
L'agitation de Fès avait gagné les tribus avoisinantes qui marchaient sur la ville; le sultan devenait hostile à la France. Le 24 mai, le jour même de l'arrivée à Fès du général Lyautey, la ville était attaquée. Le général trouvait le sultan Moulay-Hafid impuissant à se faire obéir. Des milliers de Berbères descendaient des montagnes pour anéantir à la fois les Français et les troupes chérifiennes. Ils étaient plus de 20 000, et une population fanatisée croyant à la ruine de notre faible garnison était prête à se joindre à eux. Il y eut quatre jours de combats pied à pied dans un dédale de rues où tout devenait coupe-gorge et guet-apens. Le colonel Gouraud parvint à dégager la ville.
Le 12 juin le sultan sous la pression des événements abdiquait et son frère Moulay-Youssef lui succéda. Ce fut dans ces circonstances que le lieutenant Auguernon prenait le commandement de la compagnie de gendarmerie de Fès. Cette même année furent créés les postes de gendarmerie de Mogador, Oued-Zem, Maaziz, Mechra-ben-Abbou et Mazagan.
Le 16 mai 1914, les troupes du Maroc occidental et celles du Maroc Oriental effectuaient leur jonction. Le 1er janvier 1916, la force publique du Maroc oriental fut rattachée(2) à celle du Maroc occidental. Depuis leurs arrivées au Maroc, ces deux forces entièrement autonomes remplissaient un double rôle, celui de force publique et celui du service de gendarmerie. En raison des événements, l'effectif de ces deux forces fut en constante augmentation et à la veille de leur réunion, la force publique du Maroc occidental était composée de 1 officier supérieur, 4 officiers subalternes, 49 chefs de brigade, 203 gendarmes (total 257), celle du Maroc oriental : de 1 officier subalterne, 12 chefs de brigade, 41 gendarmes (total 54). Le 1er avril suivant, elles étaient réunies(3) sous le commandement unique d'un officier supérieur, elle était composée de 5 officiers subalternes, 305 chefs de brigade et gendarmes.
Les progrès de la pacification nécessitèrent l'installation de postes en arrière des troupes d'opérations qui étaient chargés de la surveillance et de la police judiciaire, de procéder aux transfèrements, en un mot d'y remplir le rôle de la gendarmerie aux colonies. Avec la mise en place de ces postes, le service prévôtal attaché aux colonnes expéditionnaires fut réduit d'année en année pour ne plus nécessiter en 1924 que 20 à 30 hommes sauf au cours des années 1925 et 1926, où les opérations menées dans le Riff ont nécessité la constitution d'unités prévôtales ayant atteint 106 gradés et gendarmes en 1925 et 81 en 1926.
Ce fut le 1er janvier 1928 que la force publique du Maroc fut transformée en « légion de gendarmerie du Maroc(4)», dont la composition était la suivante :

Les brigades de Khémisset, Had-Kourt et Bou-Denib étaient créées la même année. L'effectif des gradés et gendarmes fut porté de 308 à 348 puis en 1929 à 358 dont 63 auxiliaires marocains avec la création de la section de Mazagan. En 1932, il atteignait 390 gradés et gendarmes.
(1) Bataille inscrite sur le drapeau de la gendarmerie.
(2) Circulaire N° 63 du 21 décembre 1915.
(3) Décision ministérielle du 18 mars 1915.
(4) Décret du 25 novembre 1927.
À la création de la légion, le personnel était réparti sur l'ensemble du territoire du protectorat en 60 postes à l'effectif variant de 3 à 5 gendarmes pour le « bled » et atteignant 35 gradés et gendarmes dans les villes de Casablanca et de Rabat. Cette installation nécessita l'emploi d'un auxiliaire marocain par poste pour faciliter le service par la compréhension de la langue arabe.

L'implantation de ces postes avait été faite à la suite de la progression des armées. Par manque d'infrastructure, on ne put bien souvent procéder à leur installation là où cela eût été nécessaire. Jusqu'en 1926, les gendarmes étaient installés dans des lieux aussi divers que de vieux baraquements militaires, de vieilles masures ou disséminés dans des maisons particulières. En 1926, le protectorat prit à sa charge toutes les dépenses du casernement, mais compte tenu de sa situation budgétaire sa construction ne progressa que très lentement.
L'effectif restreint de ces unités avait été fixé en fonction des besoins qui justifiaient leur création, mais au fur et à mesure des progrès de la pacification et de l'organisation territoriale et administrative du pays, ils furent bien vite insuffisants. Le ressort territorial de ces postes fut étendu peu à peu, leur activité s'amplifia, les dahirs et règlements à faire appliquer devinrent plus nombreux.
Un dahir (loi) du 21 décembre 1927 plaçait la gendarmerie dans les attributions du commissaire résident général, en ce qui concerne la police administrative ; du procureur général près la cour d'appel de Rabat, en ce qui concerne la police judiciaire ; du général commandant supérieur des troupes d'occupation qui avait la légion sous ses ordres. Les relations particulières de la gendarmerie de la zone française de l'Empire chérifien avec les autorités de contrôle au sujet des infractions relevaient des juridictions maghzen et des tribunaux français définies par l'article 2 de ce même dahir. Faute d'une administration inexistante ou insuffisante, de nombreuses fonctions dévolues en France à des fonctionnaires spécialisés étaient assurées par les gendarmes.

La colonisation, le commerce, l'extension du réseau routier et l'augmentation de la circulation automobile s'accrurent dans des proportions considérables pourtant la gendarmerie n'avait été dotée d'aucun moyen de transport rapide jusqu'en 1927. La circonscription des brigades était beaucoup plus étendue, certaines étaient équivalentes et parfois supérieures à un département français. Les 60 postes de cette époque étaient distants de 150 kilomètres et plus.
Ce n'est qu'en 1928 que les officiers furent dotés de voitures automobiles afin de pouvoir inspecter les diverses unités placées sous leur commandement ; en 1929 une voiture spéciale est affectée à la première compagnie pour le service de surveillance de la circulation automobile ; une seconde voiture ne fut livrée que sept ans plus tard en 1936 pour équiper la deuxième compagnie pour les besoins de la police de la route.
Compte tenu de l'étendue de leur circonscription, la mise en place de motocyclettes dans les brigades commencée en 1931 fut activement poussée pendant les années suivantes. En 1936, 49 postes étaient motorisés, mais il faudra attendre 1938 pour qu'ils le soient tous.
Après la Seconde Guerre mondiale, la gendarmerie au Maroc fut, comme en France, équipée de machines ayant servi pendant la guerre. De fabrication américaine, c'étaient des Indians, d'une cylindrée de 500 cm³ qui atteignaient péniblement les 100 km/heure ce qui ne leur permettait pas de rivaliser avec les puissantes voitures américaines, très nombreuses au Maroc et pouvant circuler facilement à des vitesses très élevées de l'ordre de 150 km/heure.

Penché sur sa canne qui ne le quitte jamais, mon camarade Alfred, le corps meurtri par la vieillesse, mais l'esprit toujours vif et brillant me raconte cette époque où, jeune gendarme, il fut affecté au début des années 1950 à la brigade motocycliste de Casablanca.
« [À mon arrivée à Casablanca], la brigade motocycliste n'était pas encore constituée et autonome : le matériel nécessaire, motocyclettes et véhicules équipés pour la police de la route n'étant pas encore en place. En attendant, on m'affecta à la brigade territoriale. Patrouille sur la route, enquêtes en ville, remise de pièces le tout à bicyclette. Il m'a fallu pour cela louer un vélo dans une boutique indigène, n'ayant pas les moyens d'en acheter un neuf. »
« [...] Un jour enfin, les nouvelles machines nous furent livrées au nombre de six ainsi que deux breaks Chevrolet et une Jeep. Les motocyclettes Harley-Davidson flambant neuves étaient aux couleurs de la police USA c'est-à-dire blanc et noir. [...] La route principale n°1 reliant Casablanca à Rabat surnommée « La route rouge » à cause des très nombreux accidents allait désormais changer de couleur, et les délinquants de comportement » (1).
 (1) Alfred JABALOYAS. « Une période heureuse, enfin... ». In : Mémoires au crépuscule. Toulouse : Messages, novembre 2016.
(1) Alfred JABALOYAS. « Une période heureuse, enfin... ». In : Mémoires au crépuscule. Toulouse : Messages, novembre 2016.